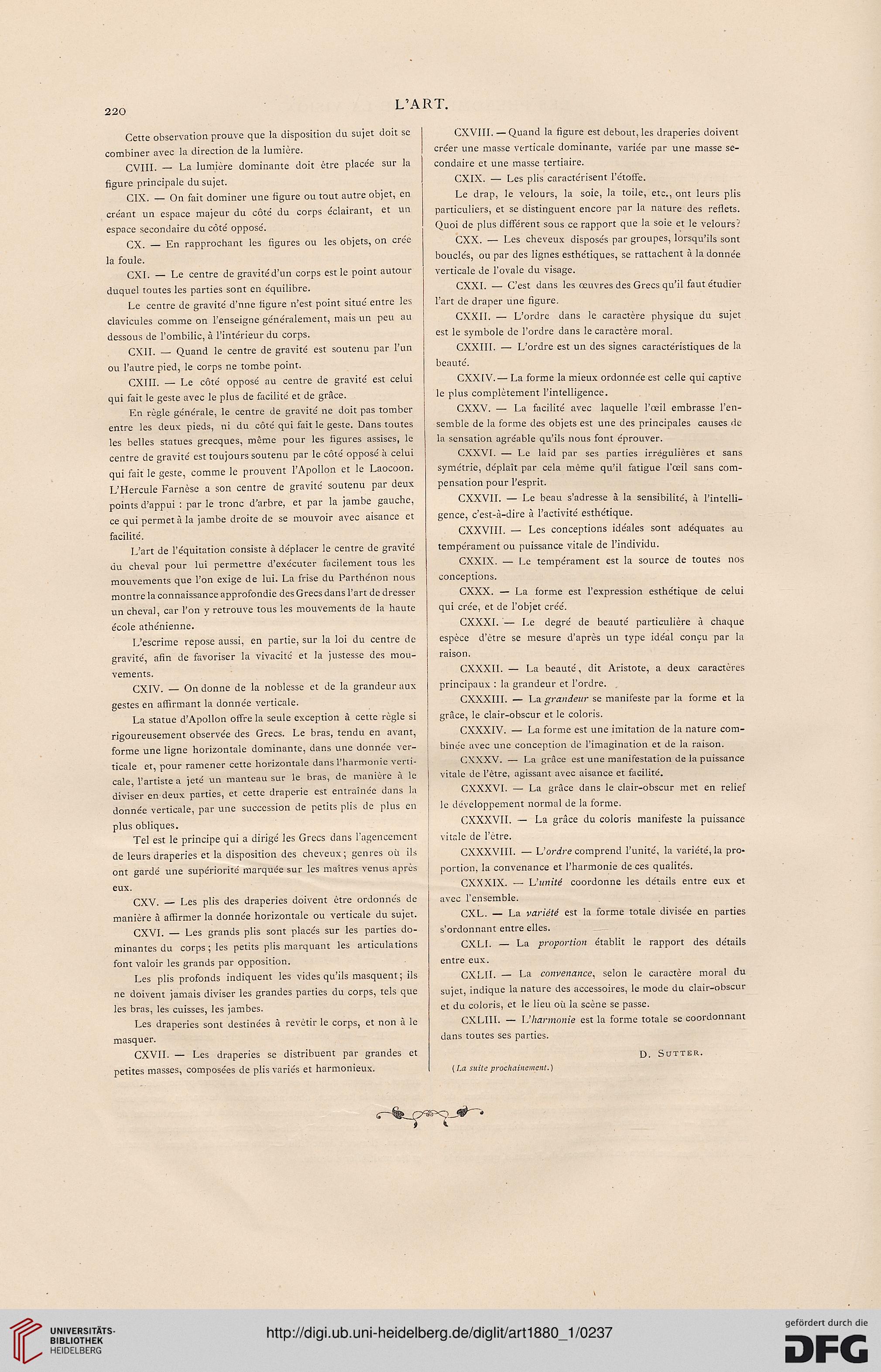L'ART.
220
Cette observation prouve que la disposition du sujet doit se
combiner avec la direction de la lumière.
CVIII. — La lumière dominante doit être placée sur la
figure principale du sujet.
C1X. — On fait dominer une figure ou tout autre objet, en
créant un espace majeur du côté du corps éclairant, et un
espace secondaire du côté opposé.
CX. — En rapprochant les figures ou les objets, on crée
la foule.
CXI. — Le centre de gravité d'un corps est le point autour
duquel toutes les parties sont en équilibre.
Le centre de gravité d'nne figure n'est point situé entre les
clavicules comme on l'enseigne généralement, mais un peu au
dessous de l'ombilic, à l'intérieur du corps.
CX1I. — Quand le centre de gravité est soutenu par l'un
ou l'autre pied, le corps ne tombe point.
CXIII. — Le côté opposé au centre de gravité est celui
qui fait le geste avec le plus de facilité et de grâce.
En règle générale, le centre de gravité ne doit pas tomber
entre les deux pieds, ni du côté qui fait le geste. Dans toutes
les belles statues grecques, même pour les figures assises, le
centre de gravité est toujours soutenu par le côté opposé à celui
qui fait le geste, comme le prouvent l'Apollon et le Laocoon.
L'Hercule Farnèse a son centre de gravité soutenu par deux
points d'appui : par le tronc d'arbre, et par la jambe gauche,
ce qui permet à la jambe droite de se mouvoir avec aisance et
facilité.
L'art de l'équitation consiste à déplacer le centre de gravité
du cheval pour lui permettre d'exécuter facilement tous les
mouvements que l'on exige de lui. La frise du Parthénon nous
montre la connaissance approfondie des Grecs dans l'art de dresser
un cheval, car l'on y retrouve tous les mouvements de la haute
école athénienne.
L'escrime repose aussi, en partie, sur la loi du centre de
gravité, afin de favoriser la vivacité et la justesse des mou-
vements.
CXIV. — On donne de la noblesse et de la grandeur aux
gestes en affirmant la donnée verticale.
La statue d'Apollon offre la seule exception à cette règle si
rigoureusement observée des Grecs. Le bras, tendu en avant,
forme une ligne horizontale dominante, dans une donnée ver-
ticale et, pour ramener cette horizontale dans l'harmonie verti-
cale, l'artiste a jeté un manteau sur le bras, de manière à le
diviser en deux parties, et cette draperie est entraînée dans la
donnée verticale, par une succession de petits plis de plus en
plus obliques.
Tel est le principe qui a dirigé les Grecs dans l'agencement
de leurs draperies et la disposition des cheveux; genres où ils
ont gardé une supériorité marquée sur les maîtres venus après
eux.
CXV. — Les plis des draperies doivent être ordonnés de
manière à affirmer la donnée horizontale ou verticale du sujet.
CXVI. — Les grands plis sont placés sur les parties do-
minantes du corps; les petits plis marquant les articulations
font valoir les grands par opposition.
Les plis profonds indiquent les vides qu'ils masquent ; ils
ne doivent jamais diviser les grandes parties du corps, tels que
les bras, les cuisses, les jambes.
Les draperies sont destinées à revêtir le corps, et non à le
masquer.
CXVII. — Les draperies se distribuent par grandes et
petites masses, composées de plis variés et harmonieux.
CXVIII. — Quand la figure est déboutées draperies doivent
créer une masse verticale dominante, variée par une niasse se-
condaire et une masse tertiaire.
CXIX. — Les plis caractérisent l'étoffe.
Le drap, le velours, la soie, la toile, etc., ont leurs plis
particuliers, et se distinguent encore par la nature des reflets.
Quoi de plus différent sous ce rapport que la soie et le velours?
CXX. — Les cheveux disposés par groupes, lorsqu'ils sont
bouclés, ou par des lignes esthétiques, se rattachent à la donnée
verticale de l'ovale du visage.
CXXI. — C'est dans les œuvres des Grecs qu'il faut étudier
l'art de draper une figure.
CXXI1. — L'ordre dans le caractère physique du sujet
est le symbole de l'ordre dans le caractère moral.
CXXIII. — L'ordre est un des signes caractéristiques de la
beauté.
CXXIV.— La forme la mieux ordonnée est celle qui captive
le plus complètement l'intelligence.
CXXV. — La facilité avec laquelle l'oeil embrasse l'en-
semble de la forme des objets est une des principales causes de
la sensation agréable qu'ils nous font éprouver.
CXXVI. — Le laid par ses parties irrégulières et sans
symétrie, déplaît par cela même qu'il fatigue l'œil sans com-
pensation pour l'esprit.
CXXVII. — Le beau s'adresse à la sensibilité, à l'intelli-
gence, c'est-à-dire à l'activité esthétique.
CXXVIII. — Les conceptions idéales sont adéquates au
tempérament ou puissance vitale de l'individu.
CXXIX. — Le tempérament est la source de toutes nos
conceptions.
CXXX. — La forme est l'expression esthétique de celui
qui crée, et de l'objet créé.
CXXXI. — Le degré de beauté particulière à chaque
espèce d'être se mesure d'après un type idéal conçu par la
raison.
CXXXII. — La beauté, dit Aristote, a deux caractères
principaux : la grandeur et l'ordre.
CXXXIII. — La grandeur se manifeste par la forme et la
grâce, le clair-obscur et le coloris.
CXXXIV. — La forme est une imitation de la nature com-
binée avec une conception de l'imagination et de la raison.
CXXXV. — La grâce est une manifestation de la puissance
vitale de l'être, agissant avec aisance et facilité.
CXXXV1. — La grâce dans le clair-obscur met en relief
le développement normal de la forme.
CXXXVII. — La grâce du coloris manifeste la puissance
vitale de l'être.
CXXXVIII. — L'ordre comprend l'unité, la variété, la pro>
portion, la convenance et l'harmonie de ces qualités.
CXXXIX. — L'unité coordonne les détails entre eux et
avec l'ensemble.
CXL. — La variété est la forme totale divisée en parties
s'ordonnant entre elles.
CXLI. — La proportion établit le rapport des détails
entre eux.
GXLII. — La convenance, selon le caractère moral du
sujet, indique la nature des accessoires, le mode du clair-obscur
et du coloris, et le lieu où la scène se passe.
CXLIII. — L'harmonie est la forme totale se coordonnant
dans toutes ses parties.
D. Sutter.
{La suite prochainement.)
220
Cette observation prouve que la disposition du sujet doit se
combiner avec la direction de la lumière.
CVIII. — La lumière dominante doit être placée sur la
figure principale du sujet.
C1X. — On fait dominer une figure ou tout autre objet, en
créant un espace majeur du côté du corps éclairant, et un
espace secondaire du côté opposé.
CX. — En rapprochant les figures ou les objets, on crée
la foule.
CXI. — Le centre de gravité d'un corps est le point autour
duquel toutes les parties sont en équilibre.
Le centre de gravité d'nne figure n'est point situé entre les
clavicules comme on l'enseigne généralement, mais un peu au
dessous de l'ombilic, à l'intérieur du corps.
CX1I. — Quand le centre de gravité est soutenu par l'un
ou l'autre pied, le corps ne tombe point.
CXIII. — Le côté opposé au centre de gravité est celui
qui fait le geste avec le plus de facilité et de grâce.
En règle générale, le centre de gravité ne doit pas tomber
entre les deux pieds, ni du côté qui fait le geste. Dans toutes
les belles statues grecques, même pour les figures assises, le
centre de gravité est toujours soutenu par le côté opposé à celui
qui fait le geste, comme le prouvent l'Apollon et le Laocoon.
L'Hercule Farnèse a son centre de gravité soutenu par deux
points d'appui : par le tronc d'arbre, et par la jambe gauche,
ce qui permet à la jambe droite de se mouvoir avec aisance et
facilité.
L'art de l'équitation consiste à déplacer le centre de gravité
du cheval pour lui permettre d'exécuter facilement tous les
mouvements que l'on exige de lui. La frise du Parthénon nous
montre la connaissance approfondie des Grecs dans l'art de dresser
un cheval, car l'on y retrouve tous les mouvements de la haute
école athénienne.
L'escrime repose aussi, en partie, sur la loi du centre de
gravité, afin de favoriser la vivacité et la justesse des mou-
vements.
CXIV. — On donne de la noblesse et de la grandeur aux
gestes en affirmant la donnée verticale.
La statue d'Apollon offre la seule exception à cette règle si
rigoureusement observée des Grecs. Le bras, tendu en avant,
forme une ligne horizontale dominante, dans une donnée ver-
ticale et, pour ramener cette horizontale dans l'harmonie verti-
cale, l'artiste a jeté un manteau sur le bras, de manière à le
diviser en deux parties, et cette draperie est entraînée dans la
donnée verticale, par une succession de petits plis de plus en
plus obliques.
Tel est le principe qui a dirigé les Grecs dans l'agencement
de leurs draperies et la disposition des cheveux; genres où ils
ont gardé une supériorité marquée sur les maîtres venus après
eux.
CXV. — Les plis des draperies doivent être ordonnés de
manière à affirmer la donnée horizontale ou verticale du sujet.
CXVI. — Les grands plis sont placés sur les parties do-
minantes du corps; les petits plis marquant les articulations
font valoir les grands par opposition.
Les plis profonds indiquent les vides qu'ils masquent ; ils
ne doivent jamais diviser les grandes parties du corps, tels que
les bras, les cuisses, les jambes.
Les draperies sont destinées à revêtir le corps, et non à le
masquer.
CXVII. — Les draperies se distribuent par grandes et
petites masses, composées de plis variés et harmonieux.
CXVIII. — Quand la figure est déboutées draperies doivent
créer une masse verticale dominante, variée par une niasse se-
condaire et une masse tertiaire.
CXIX. — Les plis caractérisent l'étoffe.
Le drap, le velours, la soie, la toile, etc., ont leurs plis
particuliers, et se distinguent encore par la nature des reflets.
Quoi de plus différent sous ce rapport que la soie et le velours?
CXX. — Les cheveux disposés par groupes, lorsqu'ils sont
bouclés, ou par des lignes esthétiques, se rattachent à la donnée
verticale de l'ovale du visage.
CXXI. — C'est dans les œuvres des Grecs qu'il faut étudier
l'art de draper une figure.
CXXI1. — L'ordre dans le caractère physique du sujet
est le symbole de l'ordre dans le caractère moral.
CXXIII. — L'ordre est un des signes caractéristiques de la
beauté.
CXXIV.— La forme la mieux ordonnée est celle qui captive
le plus complètement l'intelligence.
CXXV. — La facilité avec laquelle l'oeil embrasse l'en-
semble de la forme des objets est une des principales causes de
la sensation agréable qu'ils nous font éprouver.
CXXVI. — Le laid par ses parties irrégulières et sans
symétrie, déplaît par cela même qu'il fatigue l'œil sans com-
pensation pour l'esprit.
CXXVII. — Le beau s'adresse à la sensibilité, à l'intelli-
gence, c'est-à-dire à l'activité esthétique.
CXXVIII. — Les conceptions idéales sont adéquates au
tempérament ou puissance vitale de l'individu.
CXXIX. — Le tempérament est la source de toutes nos
conceptions.
CXXX. — La forme est l'expression esthétique de celui
qui crée, et de l'objet créé.
CXXXI. — Le degré de beauté particulière à chaque
espèce d'être se mesure d'après un type idéal conçu par la
raison.
CXXXII. — La beauté, dit Aristote, a deux caractères
principaux : la grandeur et l'ordre.
CXXXIII. — La grandeur se manifeste par la forme et la
grâce, le clair-obscur et le coloris.
CXXXIV. — La forme est une imitation de la nature com-
binée avec une conception de l'imagination et de la raison.
CXXXV. — La grâce est une manifestation de la puissance
vitale de l'être, agissant avec aisance et facilité.
CXXXV1. — La grâce dans le clair-obscur met en relief
le développement normal de la forme.
CXXXVII. — La grâce du coloris manifeste la puissance
vitale de l'être.
CXXXVIII. — L'ordre comprend l'unité, la variété, la pro>
portion, la convenance et l'harmonie de ces qualités.
CXXXIX. — L'unité coordonne les détails entre eux et
avec l'ensemble.
CXL. — La variété est la forme totale divisée en parties
s'ordonnant entre elles.
CXLI. — La proportion établit le rapport des détails
entre eux.
GXLII. — La convenance, selon le caractère moral du
sujet, indique la nature des accessoires, le mode du clair-obscur
et du coloris, et le lieu où la scène se passe.
CXLIII. — L'harmonie est la forme totale se coordonnant
dans toutes ses parties.
D. Sutter.
{La suite prochainement.)