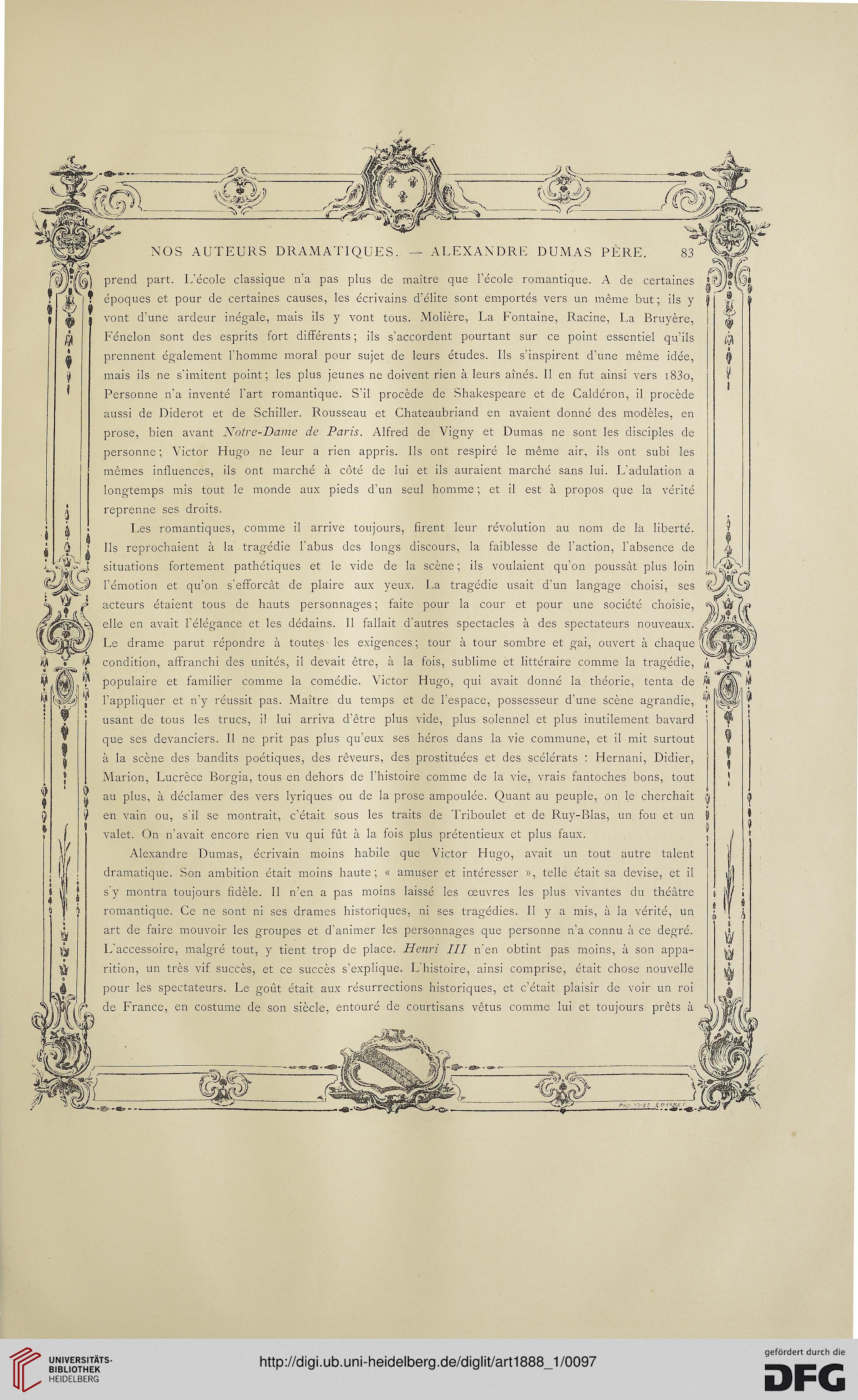NOS AUTEURS DRAMATIQUES
ALEXANDRE DUMAS PÈRE.
prend part. L'école classique n'a pas plus de maître que l’école romantique. A de certaines
époques et pour de certaines causes, les écrivains d’élite sont emportés vers un même but; ils y
vont d’une ardeur inégale, mais ils y vont tous. Molière, La Fontaine, Racine, La Bruyère,
Fénelon sont des esprits fort différents; ils s’accordent pourtant sur ce point essentiel qu’ils
prennent également l’homme moral pour sujet de leurs études. Ils s’inspirent d’une même idée,
mais ils ne s’imitent point; les plus jeunes ne doivent rien à leurs aînés. Il en fut ainsi vers i83o,
Personne n’a inventé l’art romantique. S’il procède de Shakespeare et de Caldéron, il procède
aussi de Diderot et de Schiller. Rousseau et Chateaubriand en avaient donné des modèles, en
prose, bien avant Notre-Dame de Paris. Alfred de Vigny et Dumas ne sont les disciples de
personne ; Victor Hugo ne leur a rien appris. Ils ont respiré le même air, ils ont subi les
mêmes influences, ils ont marché à côté de lui et ils auraient marché sans lui. L'adulation a
longtemps mis tout le monde aux pieds d’un seul homme ; et il est à propos que la vérité
reprenne ses droits.
Les romantiques, comme il arrive toujours, firent leur révolution au nom de la liberté.
Ils reprochaient à la tragédie l'abus des longs discours, la faiblesse de l’action, l'absence de
situations fortement pathétiques et le vide de la scène ; ils voulaient qu’on poussât plus loin
l’émotion et qu’on s’efforçât de plaire aux yeux. La tragédie usait d'un langage choisi, ses
acteurs étaient tous de hauts personnages ; faite pour la cour et pour une société choisie,
elle en avait l’élégance et les dédains. 11 fallait d’autres spectacles à des spectateurs nouveaux.
Le drame parut répondre à toutes les exigences; tour à tour sombre et gai, ouvert à chaque
condition, affranchi des unités, il devait être, à la fois, sublime et littéraire comme la tragédie,
populaire et familier comme la comédie. Victor Hugo, qui avait donné la théorie, tenta de M
l’appliquer et n'y réussit pas. Maître du temps et de l’espace, possesseur d'une scène agrandie,
usant de tous les trucs, il lui arriva d’être plus vide, plus solennel et plus inutilement bavard
que ses devanciers. Il ne prit pas plus qu’eux ses héros dans la vie commune, et il mit surtout
à la scène des bandits poétiques, des rêveurs, des prostituées et des scélérats : Hernani, Didier,
Marion, Lucrèce Borgia, tous en dehors de l’histoire comme de la vie, vrais fantoches bons, tout
au plus, à déclamer des vers lyriques ou de la prose ampoulée. Quant au peuple, on le cherchait
en vain ou, s’il se montrait, c’était sous les traits de Triboulet et de Ruy-Blas, un fou et un
valet. On n’avait encore rien vu qui fût à la fois plus prétentieux et plus faux.
Alexandre Dumas, écrivain moins habile que Victor Hugo, avait un tout autre talent
dramatique. Son ambition était moins haute; « amuser et intéresser », telle était sa devise, et il
s’y montra toujours fidèle. Il n’en a pas moins laissé les oeuvres les plus vivantes du théâtre
romantique. Ce ne sont ni ses drames historiques, ni ses tragédies. Il y a mis, à la vérité, un
art de faire mouvoir les groupes et d’animer les personnages que personne n’a connu à ce degré.
L’accessoire, malgré tout, y tient trop de place. Henri III n’en obtint pas moins, à son appa-
rition, un très vif succès, et ce succès s’explique. L'histoire, ainsi comprise, était chose nouvelle
pour les spectateurs. Le goût était aux résurrections historiques, et c’était plaisir de voir un roi
de France, en costume de son siècle, entouré de courtisans vêtus comme lui et toujours prêts à
ALEXANDRE DUMAS PÈRE.
prend part. L'école classique n'a pas plus de maître que l’école romantique. A de certaines
époques et pour de certaines causes, les écrivains d’élite sont emportés vers un même but; ils y
vont d’une ardeur inégale, mais ils y vont tous. Molière, La Fontaine, Racine, La Bruyère,
Fénelon sont des esprits fort différents; ils s’accordent pourtant sur ce point essentiel qu’ils
prennent également l’homme moral pour sujet de leurs études. Ils s’inspirent d’une même idée,
mais ils ne s’imitent point; les plus jeunes ne doivent rien à leurs aînés. Il en fut ainsi vers i83o,
Personne n’a inventé l’art romantique. S’il procède de Shakespeare et de Caldéron, il procède
aussi de Diderot et de Schiller. Rousseau et Chateaubriand en avaient donné des modèles, en
prose, bien avant Notre-Dame de Paris. Alfred de Vigny et Dumas ne sont les disciples de
personne ; Victor Hugo ne leur a rien appris. Ils ont respiré le même air, ils ont subi les
mêmes influences, ils ont marché à côté de lui et ils auraient marché sans lui. L'adulation a
longtemps mis tout le monde aux pieds d’un seul homme ; et il est à propos que la vérité
reprenne ses droits.
Les romantiques, comme il arrive toujours, firent leur révolution au nom de la liberté.
Ils reprochaient à la tragédie l'abus des longs discours, la faiblesse de l’action, l'absence de
situations fortement pathétiques et le vide de la scène ; ils voulaient qu’on poussât plus loin
l’émotion et qu’on s’efforçât de plaire aux yeux. La tragédie usait d'un langage choisi, ses
acteurs étaient tous de hauts personnages ; faite pour la cour et pour une société choisie,
elle en avait l’élégance et les dédains. 11 fallait d’autres spectacles à des spectateurs nouveaux.
Le drame parut répondre à toutes les exigences; tour à tour sombre et gai, ouvert à chaque
condition, affranchi des unités, il devait être, à la fois, sublime et littéraire comme la tragédie,
populaire et familier comme la comédie. Victor Hugo, qui avait donné la théorie, tenta de M
l’appliquer et n'y réussit pas. Maître du temps et de l’espace, possesseur d'une scène agrandie,
usant de tous les trucs, il lui arriva d’être plus vide, plus solennel et plus inutilement bavard
que ses devanciers. Il ne prit pas plus qu’eux ses héros dans la vie commune, et il mit surtout
à la scène des bandits poétiques, des rêveurs, des prostituées et des scélérats : Hernani, Didier,
Marion, Lucrèce Borgia, tous en dehors de l’histoire comme de la vie, vrais fantoches bons, tout
au plus, à déclamer des vers lyriques ou de la prose ampoulée. Quant au peuple, on le cherchait
en vain ou, s’il se montrait, c’était sous les traits de Triboulet et de Ruy-Blas, un fou et un
valet. On n’avait encore rien vu qui fût à la fois plus prétentieux et plus faux.
Alexandre Dumas, écrivain moins habile que Victor Hugo, avait un tout autre talent
dramatique. Son ambition était moins haute; « amuser et intéresser », telle était sa devise, et il
s’y montra toujours fidèle. Il n’en a pas moins laissé les oeuvres les plus vivantes du théâtre
romantique. Ce ne sont ni ses drames historiques, ni ses tragédies. Il y a mis, à la vérité, un
art de faire mouvoir les groupes et d’animer les personnages que personne n’a connu à ce degré.
L’accessoire, malgré tout, y tient trop de place. Henri III n’en obtint pas moins, à son appa-
rition, un très vif succès, et ce succès s’explique. L'histoire, ainsi comprise, était chose nouvelle
pour les spectateurs. Le goût était aux résurrections historiques, et c’était plaisir de voir un roi
de France, en costume de son siècle, entouré de courtisans vêtus comme lui et toujours prêts à