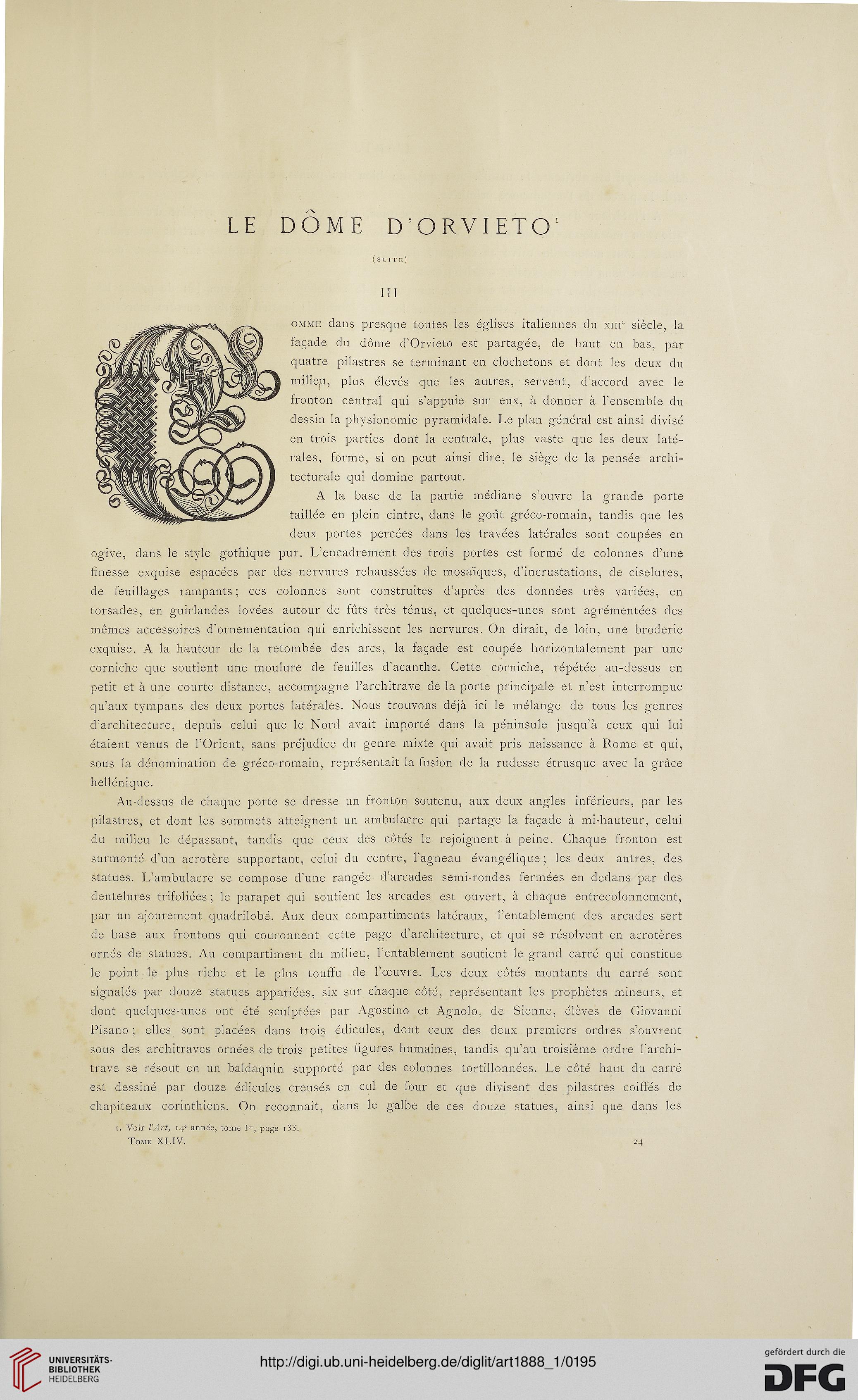I
LE DOME D’ORVIETO
(suite)
III
omme dans presque toutes les églises italiennes du xme siècle, la
façade du dôme d’Orvieto est partagée, de haut en bas, par
quatre pilastres se terminant en clochetons et dont les deux du
milieu, plus élevés que les autres, servent, d’accord avec le
fronton central qui s’appuie sur eux, à donner à l’ensemble du
dessin la physionomie pyramidale. Le plan général est ainsi divisé
en trois parties dont la centrale, plus vaste que les deux laté-
rales, forme, si on peut ainsi dire, le siège de la pensée archi-
tecturale qui domine partout.
A la base de la partie médiane s'ouvre la grande porte
taillée en plein cintre, dans le goût gréco-romain, tandis que les
deux portes percées dans les travées latérales sont coupées en
ogive, dans le style gothique pur. L'encadrement des trois portes est formé de colonnes d’une
finesse exquise espacées par des nervures rehaussées de mosaïques, d’incrustations, de ciselures,
de feuillages rampants ; ces colonnes sont construites d’après des données très variées, en
torsades, en guirlandes lovées autour de fûts très ténus, et quelques-unes sont agrémentées des
mêmes accessoires d’ornementation qui enrichissent les nervures. On dirait, de loin, une broderie
exquise. A la hauteur de la retombée des arcs, la façade est coupée horizontalement par une
corniche que soutient une moulure de feuilles d’acanthe. Cette corniche, répétée au-dessus en
petit et à une courte distance, accompagne l’architrave de la porte principale et n’est interrompue
qu’aux tympans des deux portes latérales. Nous trouvons déjà ici le mélange de tous les genres
d’architecture, depuis celui que le Nord avait importé dans la péninsule jusqu’à ceux qui lui
étaient venus de l’Orient, sans préjudice du genre mixte qui avait pris naissance à Rome et qui,
sous la dénomination de gréco-romain, représentait la fusion de la rudesse étrusque avec la grâce
hellénique.
Au-dessus de chaque porte se dresse un fronton soutenu, aux deux angles inférieurs, par les
pilastres, et dont les sommets atteignent un ambulacre qui partage la façade à mi-hauteur, celui
du milieu le dépassant, tandis que ceux des côtés le rejoignent à peine. Chaque fronton est
surmonté d’un acrotère supportant, celui du centre, l’agneau évangélique; les deux autres, des
statues. L’ambulacre se compose d’une rangée d’arcades semi-rondes fermées en dedans par des
dentelures trifoliées ; le parapet qui soutient les arcades est ouvert, à chaque entrecolonnement,
par un ajourement quadrilobé. Aux deux compartiments latéraux, l’entablement des arcades sert
de base aux frontons qui couronnent cette page d’architecture, et qui se résolvent en acrotères
ornés de statues. Au compartiment du milieu, l’entablement soutient le grand carré qui constitue
le point le plus riche et le plus touffu de l’œuvre. Les deux côtés montants du carré sont
signalés par douze statues appariées, six sur chaque côté, représentant les prophètes mineurs, et
dont quelques-unes ont été sculptées par Agostino et Agnolo, de Sienne, élèves de Giovanni
Pisano ; elles sont placées dans trois édicules, dont ceux des deux premiers ordres s’ouvrent
sous des architraves ornées de trois petites figures humaines, tandis qu’au troisième ordre l’archi-
trave se résout en un baldaquin supporté par des colonnes tortillonnées. Le côté haut du carré
est dessiné par douze édicules creusés en cul de four et que divisent des pilastres coiffés de
chapiteaux corinthiens. On reconnaît, dans le galbe de ces douze statues, ainsi que dans les
i. Voir l’Art, 140 année, tome I01', page 133.
Tome XLIV.
24
LE DOME D’ORVIETO
(suite)
III
omme dans presque toutes les églises italiennes du xme siècle, la
façade du dôme d’Orvieto est partagée, de haut en bas, par
quatre pilastres se terminant en clochetons et dont les deux du
milieu, plus élevés que les autres, servent, d’accord avec le
fronton central qui s’appuie sur eux, à donner à l’ensemble du
dessin la physionomie pyramidale. Le plan général est ainsi divisé
en trois parties dont la centrale, plus vaste que les deux laté-
rales, forme, si on peut ainsi dire, le siège de la pensée archi-
tecturale qui domine partout.
A la base de la partie médiane s'ouvre la grande porte
taillée en plein cintre, dans le goût gréco-romain, tandis que les
deux portes percées dans les travées latérales sont coupées en
ogive, dans le style gothique pur. L'encadrement des trois portes est formé de colonnes d’une
finesse exquise espacées par des nervures rehaussées de mosaïques, d’incrustations, de ciselures,
de feuillages rampants ; ces colonnes sont construites d’après des données très variées, en
torsades, en guirlandes lovées autour de fûts très ténus, et quelques-unes sont agrémentées des
mêmes accessoires d’ornementation qui enrichissent les nervures. On dirait, de loin, une broderie
exquise. A la hauteur de la retombée des arcs, la façade est coupée horizontalement par une
corniche que soutient une moulure de feuilles d’acanthe. Cette corniche, répétée au-dessus en
petit et à une courte distance, accompagne l’architrave de la porte principale et n’est interrompue
qu’aux tympans des deux portes latérales. Nous trouvons déjà ici le mélange de tous les genres
d’architecture, depuis celui que le Nord avait importé dans la péninsule jusqu’à ceux qui lui
étaient venus de l’Orient, sans préjudice du genre mixte qui avait pris naissance à Rome et qui,
sous la dénomination de gréco-romain, représentait la fusion de la rudesse étrusque avec la grâce
hellénique.
Au-dessus de chaque porte se dresse un fronton soutenu, aux deux angles inférieurs, par les
pilastres, et dont les sommets atteignent un ambulacre qui partage la façade à mi-hauteur, celui
du milieu le dépassant, tandis que ceux des côtés le rejoignent à peine. Chaque fronton est
surmonté d’un acrotère supportant, celui du centre, l’agneau évangélique; les deux autres, des
statues. L’ambulacre se compose d’une rangée d’arcades semi-rondes fermées en dedans par des
dentelures trifoliées ; le parapet qui soutient les arcades est ouvert, à chaque entrecolonnement,
par un ajourement quadrilobé. Aux deux compartiments latéraux, l’entablement des arcades sert
de base aux frontons qui couronnent cette page d’architecture, et qui se résolvent en acrotères
ornés de statues. Au compartiment du milieu, l’entablement soutient le grand carré qui constitue
le point le plus riche et le plus touffu de l’œuvre. Les deux côtés montants du carré sont
signalés par douze statues appariées, six sur chaque côté, représentant les prophètes mineurs, et
dont quelques-unes ont été sculptées par Agostino et Agnolo, de Sienne, élèves de Giovanni
Pisano ; elles sont placées dans trois édicules, dont ceux des deux premiers ordres s’ouvrent
sous des architraves ornées de trois petites figures humaines, tandis qu’au troisième ordre l’archi-
trave se résout en un baldaquin supporté par des colonnes tortillonnées. Le côté haut du carré
est dessiné par douze édicules creusés en cul de four et que divisent des pilastres coiffés de
chapiteaux corinthiens. On reconnaît, dans le galbe de ces douze statues, ainsi que dans les
i. Voir l’Art, 140 année, tome I01', page 133.
Tome XLIV.
24