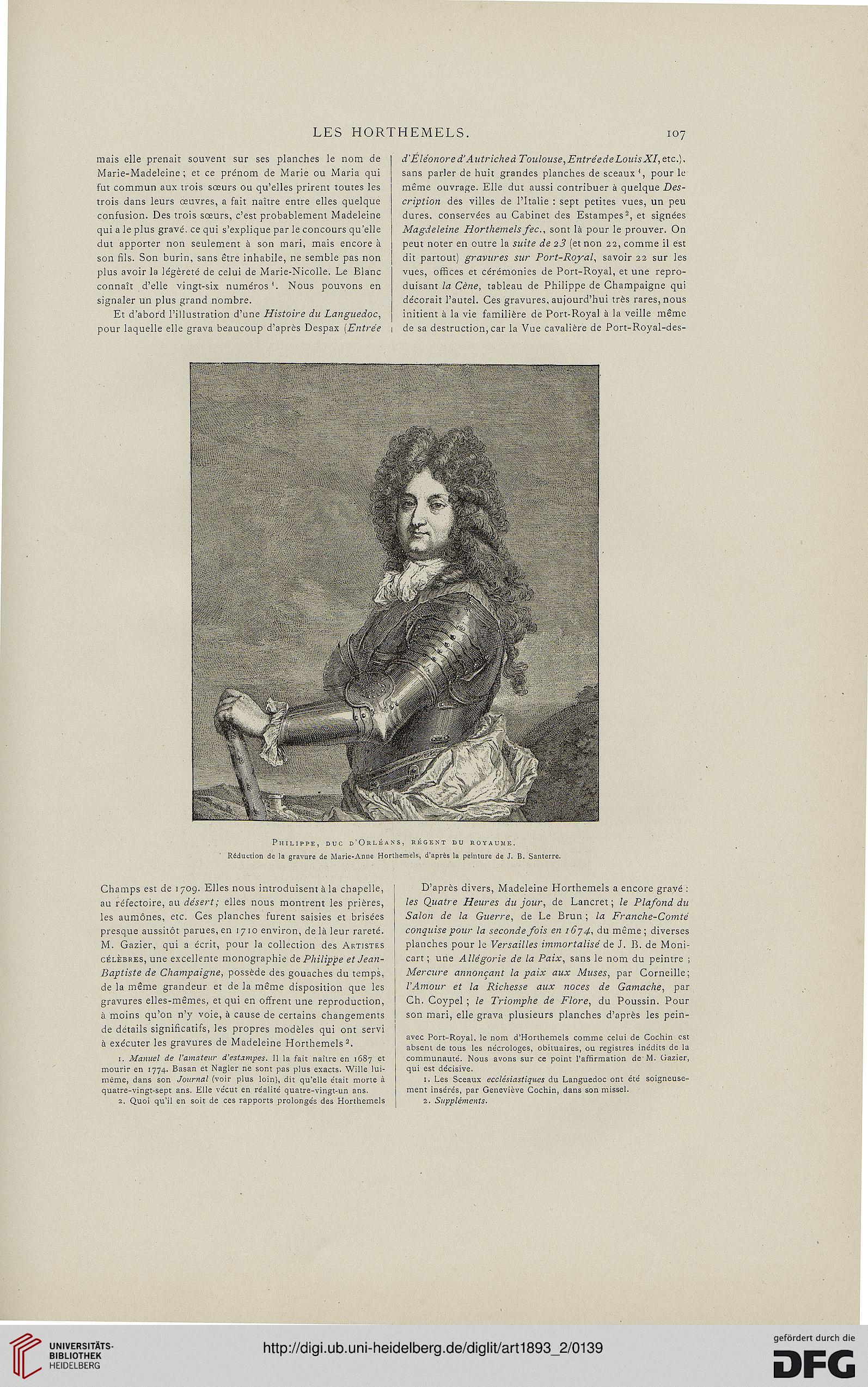LES HORTHEMELS.
107
mais elle prenait souvent sur ses planches le nom de
Marie-Madeleine ; et ce prénom de Marie ou Maria qui
fut commun aux trois sœurs ou qu'elles prirent toutes les
trois dans leurs œuvres, a fait naître entre elles quelque
confusion. Des trois sœurs, c'est probablement Madeleine
qui a le plus gravé, ce qui s'explique par le concours qu'elle
dut apporter non seulement à son mari, mais encore à
son fils. Son burin, sans être inhabile, ne semble pas non
plus avoir la légèreté de celui de Marie-Nicolle. Le Blanc
connaît d'elle vingt-six numéros1. Nous pouvons en
signaler un plus grand nombre.
Et d'abord l'illustration d'une Histoire du Languedoc,
pour laquelle elle grava beaucoup d'après Despax (Entrée
d'Eléonore d'Autricheà Toulouse, EntréedeLouisXI, etc.),
sans parler de huit grandes planches de sceaux'1, pour le
même ouvrage. Elle dut aussi contribuer à quelque Des-
cription des villes de l'Italie : sept petites vues, un peu
dures, conservées au Cabinet des Estampes2, et signées
Magdeleine Horthemels fec, sont là pour le prouver. On
peut noter en outre la suite de 23 (et non 22, comme il est
dit partout) gravures sur Port-Royal, savoir 22 sur les
vues, offices et cérémonies de Port-Royal, et une repro-
duisant la Cène, tableau de Philippe de Champaigne qui
décorait l'autel. Ces gravures, aujourd'hui très rares, nous
initient à la vie familière de Port-Royal à la veille même
de sa destruction, car la Vue cavalière de Port-Royal-des-
Champs est de 1709. Elles nous introduisent à la chapelle,
au réfectoire, au désert; elles nous montrent les prières,
les aumônes, etc. Ces planches furent saisies et brisées
presque aussitôt parues, en 1 7 10 environ, de là leur rareté.
M. Gazier, qui a écrit, pour la collection des Artistes
célèbres, une excellente monographie de Philippe et Jean-
Baptiste de Champaigne, possède des gouaches du temps,
de la même grandeur et de la même disposition que les
gravures elles-mêmes, et qui en offrent une reproduction,
à moins qu'on n'y voie, à cause de certains changements
de détails significatifs, les propres modèles qui ont servi
à exécuter les gravures de Madeleine Horthemels2.
1. Manuel de l'amateur d'estampes. Il la fait naître en 1687 et
mourir en 1774. Basan et Nagler ne sont pas plus exacts. Wille lui-
même, dans son Journal (voir plus loin), dit qu'elle était morte à
quatre-vingt-sept ans. Elle vécut en réalité quatre-vingt-un ans.
2, Quoi qu'il en soit de ces rapports prolongés des Horthemels
D'après divers, Madeleine Horthemels a encore gravé :
les Quatre Heures du jour, de Lancret ; le Plafond du
Salon de la Guerre, de Le Brun ; la Franche-Comté
conquise pour la seconde fois en 16 y4, du même ; diverses
planches pour le Versailles immortalisé de J. B. de Moni-
cart ; une Allégorie de la Paix, sans le nom du peintre ;
Mercure annonçant la paix aux Muses, par Corneille;
l'Amour et la Richesse aux noces de Gamache, par
Ch. Coypel ; le Triomphe de Flore, du Poussin. Pour
son mari, elle grava plusieurs planches d'après les pein-
avec Port-Royal, le nom d'Horlhemels comme celui de Cochin est
absent de tous les nécrologes, obituaires, ou registres inédits de la
communauté. Nous avons sur ce point l'affirmation de M. Gazier,
qui est décisive.
1. Les Sceaux ecclésiastiques du Languedoc ont été soigneuse-
ment insérés, par Geneviève Cochin, dans son missel.
2. Suppléments.
107
mais elle prenait souvent sur ses planches le nom de
Marie-Madeleine ; et ce prénom de Marie ou Maria qui
fut commun aux trois sœurs ou qu'elles prirent toutes les
trois dans leurs œuvres, a fait naître entre elles quelque
confusion. Des trois sœurs, c'est probablement Madeleine
qui a le plus gravé, ce qui s'explique par le concours qu'elle
dut apporter non seulement à son mari, mais encore à
son fils. Son burin, sans être inhabile, ne semble pas non
plus avoir la légèreté de celui de Marie-Nicolle. Le Blanc
connaît d'elle vingt-six numéros1. Nous pouvons en
signaler un plus grand nombre.
Et d'abord l'illustration d'une Histoire du Languedoc,
pour laquelle elle grava beaucoup d'après Despax (Entrée
d'Eléonore d'Autricheà Toulouse, EntréedeLouisXI, etc.),
sans parler de huit grandes planches de sceaux'1, pour le
même ouvrage. Elle dut aussi contribuer à quelque Des-
cription des villes de l'Italie : sept petites vues, un peu
dures, conservées au Cabinet des Estampes2, et signées
Magdeleine Horthemels fec, sont là pour le prouver. On
peut noter en outre la suite de 23 (et non 22, comme il est
dit partout) gravures sur Port-Royal, savoir 22 sur les
vues, offices et cérémonies de Port-Royal, et une repro-
duisant la Cène, tableau de Philippe de Champaigne qui
décorait l'autel. Ces gravures, aujourd'hui très rares, nous
initient à la vie familière de Port-Royal à la veille même
de sa destruction, car la Vue cavalière de Port-Royal-des-
Champs est de 1709. Elles nous introduisent à la chapelle,
au réfectoire, au désert; elles nous montrent les prières,
les aumônes, etc. Ces planches furent saisies et brisées
presque aussitôt parues, en 1 7 10 environ, de là leur rareté.
M. Gazier, qui a écrit, pour la collection des Artistes
célèbres, une excellente monographie de Philippe et Jean-
Baptiste de Champaigne, possède des gouaches du temps,
de la même grandeur et de la même disposition que les
gravures elles-mêmes, et qui en offrent une reproduction,
à moins qu'on n'y voie, à cause de certains changements
de détails significatifs, les propres modèles qui ont servi
à exécuter les gravures de Madeleine Horthemels2.
1. Manuel de l'amateur d'estampes. Il la fait naître en 1687 et
mourir en 1774. Basan et Nagler ne sont pas plus exacts. Wille lui-
même, dans son Journal (voir plus loin), dit qu'elle était morte à
quatre-vingt-sept ans. Elle vécut en réalité quatre-vingt-un ans.
2, Quoi qu'il en soit de ces rapports prolongés des Horthemels
D'après divers, Madeleine Horthemels a encore gravé :
les Quatre Heures du jour, de Lancret ; le Plafond du
Salon de la Guerre, de Le Brun ; la Franche-Comté
conquise pour la seconde fois en 16 y4, du même ; diverses
planches pour le Versailles immortalisé de J. B. de Moni-
cart ; une Allégorie de la Paix, sans le nom du peintre ;
Mercure annonçant la paix aux Muses, par Corneille;
l'Amour et la Richesse aux noces de Gamache, par
Ch. Coypel ; le Triomphe de Flore, du Poussin. Pour
son mari, elle grava plusieurs planches d'après les pein-
avec Port-Royal, le nom d'Horlhemels comme celui de Cochin est
absent de tous les nécrologes, obituaires, ou registres inédits de la
communauté. Nous avons sur ce point l'affirmation de M. Gazier,
qui est décisive.
1. Les Sceaux ecclésiastiques du Languedoc ont été soigneuse-
ment insérés, par Geneviève Cochin, dans son missel.
2. Suppléments.