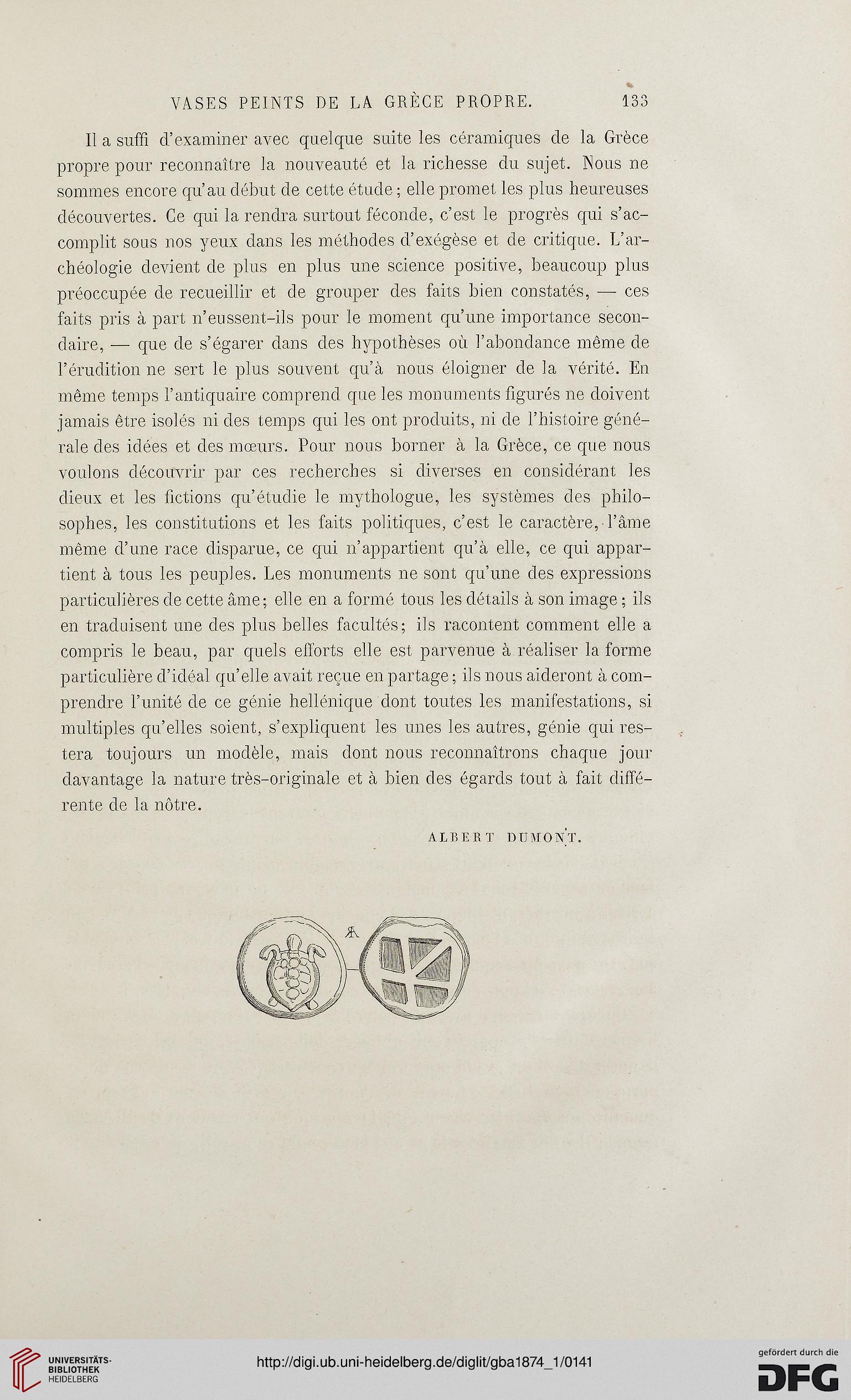VASES PEINTS DE LA GRÈGE PROPRE.
133
Il a suffi d’examiner avec quelque suite les céramiques de la Grèce
propre pour reconnaître la nouveauté et la richesse du sujet. Nous ne
sommes encore qu’au début de cette étude ; elle promet les plus heureuses
découvertes. Ce qui la rendra surtout féconde, c’est le progrès qui s’ac-
complit sous nos yeux dans les méthodes d’exégèse et de critique. L’ar-
chéologie devient de plus en plus une science positive, beaucoup plus
préoccupée de recueillir et de grouper des faits bien constatés, — ces
faits pris à part n’eussent-ils pour le moment qu’une importance secon-
daire, — que de s’égarer dans des hypothèses où l’abondance même de
l’érudition ne sert le plus souvent qu’à nous éloigner de la vérité. En
même temps l’antiquaire comprend que les monuments figurés ne doivent
jamais être isolés ni des temps qui les ont produits, ni de l’histoire géné-
rale des idées et des mœurs. Pour nous borner à la Grèce, ce que nous
voulons découvrir par ces recherches si diverses en considérant les
dieux et les fictions qu’étudie le mythologue, les systèmes des philo-
sophes, les constitutions et les faits politiques, c’est le caractère, l’âme
même d’une race disparue, ce qui n’appartient qu’à elle, ce qui appar-
tient à tous les peuples. Les monuments ne sont qu’une des expressions
particulières de cette âme; elle en a formé tous les détails à son image ; ils
en traduisent une des plus belles facultés; ils racontent comment elle a
compris le beau, par quels efforts elle est parvenue à réaliser la forme
particulière d’idéal qu’elle avait reçue en partage ; ils nous aideront à com-
prendre l’unité de ce génie hellénique dont toutes les manifestations, si
multiples qu’elles soient, s’expliquent les unes les autres, génie qui res-
tera toujours un modèle, mais dont nous reconnaîtrons chaque jour
davantage la nature très-originale et à bien des égards tout à fait diffé-
rente de la nôtre.
ALBERT DUMONT.
133
Il a suffi d’examiner avec quelque suite les céramiques de la Grèce
propre pour reconnaître la nouveauté et la richesse du sujet. Nous ne
sommes encore qu’au début de cette étude ; elle promet les plus heureuses
découvertes. Ce qui la rendra surtout féconde, c’est le progrès qui s’ac-
complit sous nos yeux dans les méthodes d’exégèse et de critique. L’ar-
chéologie devient de plus en plus une science positive, beaucoup plus
préoccupée de recueillir et de grouper des faits bien constatés, — ces
faits pris à part n’eussent-ils pour le moment qu’une importance secon-
daire, — que de s’égarer dans des hypothèses où l’abondance même de
l’érudition ne sert le plus souvent qu’à nous éloigner de la vérité. En
même temps l’antiquaire comprend que les monuments figurés ne doivent
jamais être isolés ni des temps qui les ont produits, ni de l’histoire géné-
rale des idées et des mœurs. Pour nous borner à la Grèce, ce que nous
voulons découvrir par ces recherches si diverses en considérant les
dieux et les fictions qu’étudie le mythologue, les systèmes des philo-
sophes, les constitutions et les faits politiques, c’est le caractère, l’âme
même d’une race disparue, ce qui n’appartient qu’à elle, ce qui appar-
tient à tous les peuples. Les monuments ne sont qu’une des expressions
particulières de cette âme; elle en a formé tous les détails à son image ; ils
en traduisent une des plus belles facultés; ils racontent comment elle a
compris le beau, par quels efforts elle est parvenue à réaliser la forme
particulière d’idéal qu’elle avait reçue en partage ; ils nous aideront à com-
prendre l’unité de ce génie hellénique dont toutes les manifestations, si
multiples qu’elles soient, s’expliquent les unes les autres, génie qui res-
tera toujours un modèle, mais dont nous reconnaîtrons chaque jour
davantage la nature très-originale et à bien des égards tout à fait diffé-
rente de la nôtre.
ALBERT DUMONT.