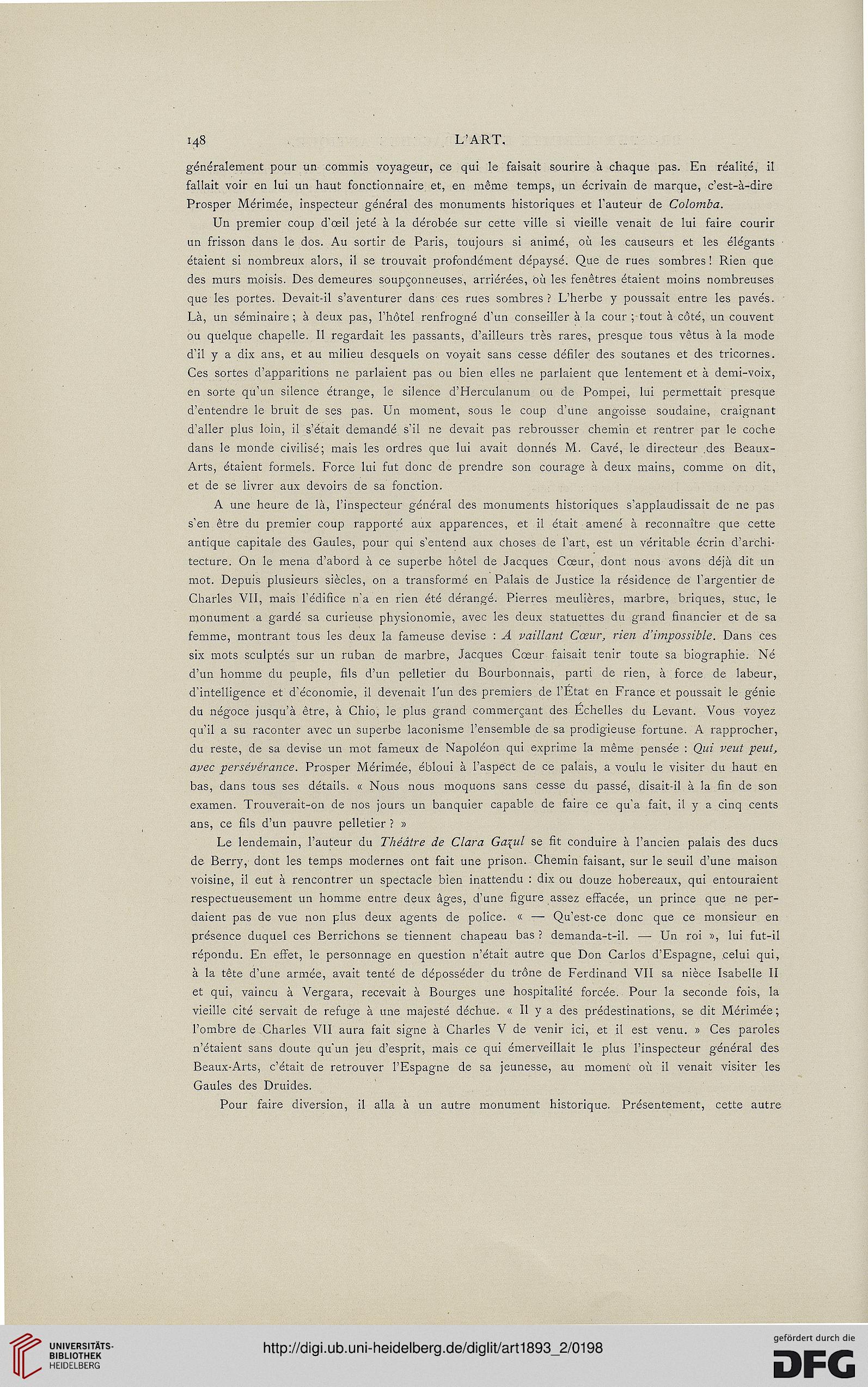148 L'ART.
généralement pour un commis voyageur, ce qui le faisait sourire à chaque pas. En réalité, il
fallait voir en lui un haut fonctionnaire et, en même temps, un écrivain de marque, c'est-à-dire
Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques et l'auteur de Colomba.
Un premier coup d'ceil jeté à la dérobée sur cette ville si vieille venait de lui faire courir
un frisson dans le dos. Au sortir de Paris, toujours si animé, où les causeurs et les élégants
étaient si nombreux alors, il se trouvait profondément dépaysé. Que de rues sombres ! Rien que
des murs moisis. Des demeures soupçonneuses, arriérées, où les fenêtres étaient moins nombreuses
que les portes. Devait-il s'aventurer dans ces rues sombres? L'herbe y poussait entre les pavés.
Là, un séminaire ; à deux pas, l'hôtel renfrogné d'un conseiller à la cour ; tout à côté, un couvent
ou quelque chapelle. Il regardait les passants, d'ailleurs très rares, presque tous vêtus à la mode
d'il y a dix ans, et au milieu desquels on voyait sans cesse défiler des soutanes et des tricornes.
Ces sortes d'apparitions ne parlaient pas ou bien elles ne parlaient que lentement et à demi-voix,
en sorte qu'un silence étrange, le silence d'Herculanum ou de Pompei, lui permettait presque
d'entendre le bruit de ses pas. Un moment, sous le coup d'une angoisse soudaine, craignant
d'aller plus loin, il s'était demandé s'il ne devait pas rebrousser chemin et rentrer par le coche
dans le monde civilisé; mais les ordres que lui avait donnés M. Gavé, le directeur .des Beaux-
Arts, étaient formels. Force lui fut donc de prendre son courage à deux mains, comme on dit,
et de se livrer aux devoirs de sa fonction.
A une heure de là, l'inspecteur général des monuments historiques s'applaudissait de ne pas
s'en être du premier coup rapporté aux apparences, et il était amené à reconnaître que cette
antique capitale des Gaules, pour qui s'entend aux choses de l'art, est un véritable écrin d'archi-
tecture. On le mena d'abord à ce superbe hôtel de Jacques Cœur, dont nous avons déjà dit un
mot. Depuis plusieurs siècles, on a transformé en Palais de Justice la résidence de l'argentier de
Charles VII, mais l'édifice n'a en rien été dérangé. Pierres meulières, marbre, briques, stuc, le
monument a gardé sa curieuse physionomie, avec les deux statuettes du grand financier et de sa
femme, montrant tous les deux la fameuse devise : A vaillant Cœur, rien d'impossible. Dans ces
six mots sculptés sur un ruban de marbre, Jacques Cœur faisait tenir toute sa biographie. Né
d'un homme du peuple, fils d'un pelletier du Bourbonnais, parti de rien, à force de labeur,
d'intelligence et d'économie, il devenait l'un des premiers de l'État en France et poussait le génie
du négoce jusqu'à être, à Chio, le plus grand commerçant des Echelles du Levant. Vous voyez
qu'il a su raconter avec un superbe laconisme l'ensemble de sa prodigieuse fortune. A rapprocher,
du reste, de sa devise un mot fameux de Napoléon qui exprime la même pensée : Qui veut peut,
avec persévérance. Prosper Mérimée, ébloui à l'aspect de ce palais, a voulu le visiter du haut en
bas, dans tous ses détails. « Nous nous moquons sans cesse du passé, disait-il à la fin de son
examen. Trouverait-on de nos jours un banquier capable de faire ce qu'a fait, il y a cinq cents
ans, ce fils d'un pauvre pelletier ? »
Le lendemain, l'auteur du Théâtre de Clara Ga\ul se fit conduire à l'ancien palais des ducs
de Berry, dont les temps modernes ont fait une prison. Chemin faisant, sur le seuil d'une maison
voisine, il eut à rencontrer un spectacle bien inattendu : dix ou douze hobereaux, qui entouraient
respectueusement un homme entre deux âges, d'une figure assez effacée, un prince que ne per-
daient pas de vue non plus deux agents de police. « — Qu'est-ce donc que ce monsieur en
présence duquel ces Berrichons se tiennent chapeau bas ? demanda-t-il. — Un roi », lui fut-il
répondu. En effet, le personnage en question n'était autre que Don Carlos d'Espagne, celui qui,
à la tête d'une armée, avait tenté de déposséder du trône de Ferdinand VII sa nièce Isabelle II
et qui, vaincu à Vergara, recevait à Bourges une hospitalité forcée. Pour la seconde fois, la
vieille cité servait de refuge à une majesté déchue. « Il y a des prédestinations, se dit Mérimée ;
l'ombre de Charles VII aura fait signe à Charles V de venir ici, et il est venu. » Ces paroles
n'étaient sans doute qu'un jeu d'esprit, mais ce qui émerveillait le plus l'inspecteur général des
Beaux-Arts, c'était de retrouver l'Espagne de sa jeunesse, au moment où il venait visiter les
Gaules des Druides.
Pour faire diversion, il alla à un autre monument historique. Présentement, cette autre
généralement pour un commis voyageur, ce qui le faisait sourire à chaque pas. En réalité, il
fallait voir en lui un haut fonctionnaire et, en même temps, un écrivain de marque, c'est-à-dire
Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques et l'auteur de Colomba.
Un premier coup d'ceil jeté à la dérobée sur cette ville si vieille venait de lui faire courir
un frisson dans le dos. Au sortir de Paris, toujours si animé, où les causeurs et les élégants
étaient si nombreux alors, il se trouvait profondément dépaysé. Que de rues sombres ! Rien que
des murs moisis. Des demeures soupçonneuses, arriérées, où les fenêtres étaient moins nombreuses
que les portes. Devait-il s'aventurer dans ces rues sombres? L'herbe y poussait entre les pavés.
Là, un séminaire ; à deux pas, l'hôtel renfrogné d'un conseiller à la cour ; tout à côté, un couvent
ou quelque chapelle. Il regardait les passants, d'ailleurs très rares, presque tous vêtus à la mode
d'il y a dix ans, et au milieu desquels on voyait sans cesse défiler des soutanes et des tricornes.
Ces sortes d'apparitions ne parlaient pas ou bien elles ne parlaient que lentement et à demi-voix,
en sorte qu'un silence étrange, le silence d'Herculanum ou de Pompei, lui permettait presque
d'entendre le bruit de ses pas. Un moment, sous le coup d'une angoisse soudaine, craignant
d'aller plus loin, il s'était demandé s'il ne devait pas rebrousser chemin et rentrer par le coche
dans le monde civilisé; mais les ordres que lui avait donnés M. Gavé, le directeur .des Beaux-
Arts, étaient formels. Force lui fut donc de prendre son courage à deux mains, comme on dit,
et de se livrer aux devoirs de sa fonction.
A une heure de là, l'inspecteur général des monuments historiques s'applaudissait de ne pas
s'en être du premier coup rapporté aux apparences, et il était amené à reconnaître que cette
antique capitale des Gaules, pour qui s'entend aux choses de l'art, est un véritable écrin d'archi-
tecture. On le mena d'abord à ce superbe hôtel de Jacques Cœur, dont nous avons déjà dit un
mot. Depuis plusieurs siècles, on a transformé en Palais de Justice la résidence de l'argentier de
Charles VII, mais l'édifice n'a en rien été dérangé. Pierres meulières, marbre, briques, stuc, le
monument a gardé sa curieuse physionomie, avec les deux statuettes du grand financier et de sa
femme, montrant tous les deux la fameuse devise : A vaillant Cœur, rien d'impossible. Dans ces
six mots sculptés sur un ruban de marbre, Jacques Cœur faisait tenir toute sa biographie. Né
d'un homme du peuple, fils d'un pelletier du Bourbonnais, parti de rien, à force de labeur,
d'intelligence et d'économie, il devenait l'un des premiers de l'État en France et poussait le génie
du négoce jusqu'à être, à Chio, le plus grand commerçant des Echelles du Levant. Vous voyez
qu'il a su raconter avec un superbe laconisme l'ensemble de sa prodigieuse fortune. A rapprocher,
du reste, de sa devise un mot fameux de Napoléon qui exprime la même pensée : Qui veut peut,
avec persévérance. Prosper Mérimée, ébloui à l'aspect de ce palais, a voulu le visiter du haut en
bas, dans tous ses détails. « Nous nous moquons sans cesse du passé, disait-il à la fin de son
examen. Trouverait-on de nos jours un banquier capable de faire ce qu'a fait, il y a cinq cents
ans, ce fils d'un pauvre pelletier ? »
Le lendemain, l'auteur du Théâtre de Clara Ga\ul se fit conduire à l'ancien palais des ducs
de Berry, dont les temps modernes ont fait une prison. Chemin faisant, sur le seuil d'une maison
voisine, il eut à rencontrer un spectacle bien inattendu : dix ou douze hobereaux, qui entouraient
respectueusement un homme entre deux âges, d'une figure assez effacée, un prince que ne per-
daient pas de vue non plus deux agents de police. « — Qu'est-ce donc que ce monsieur en
présence duquel ces Berrichons se tiennent chapeau bas ? demanda-t-il. — Un roi », lui fut-il
répondu. En effet, le personnage en question n'était autre que Don Carlos d'Espagne, celui qui,
à la tête d'une armée, avait tenté de déposséder du trône de Ferdinand VII sa nièce Isabelle II
et qui, vaincu à Vergara, recevait à Bourges une hospitalité forcée. Pour la seconde fois, la
vieille cité servait de refuge à une majesté déchue. « Il y a des prédestinations, se dit Mérimée ;
l'ombre de Charles VII aura fait signe à Charles V de venir ici, et il est venu. » Ces paroles
n'étaient sans doute qu'un jeu d'esprit, mais ce qui émerveillait le plus l'inspecteur général des
Beaux-Arts, c'était de retrouver l'Espagne de sa jeunesse, au moment où il venait visiter les
Gaules des Druides.
Pour faire diversion, il alla à un autre monument historique. Présentement, cette autre