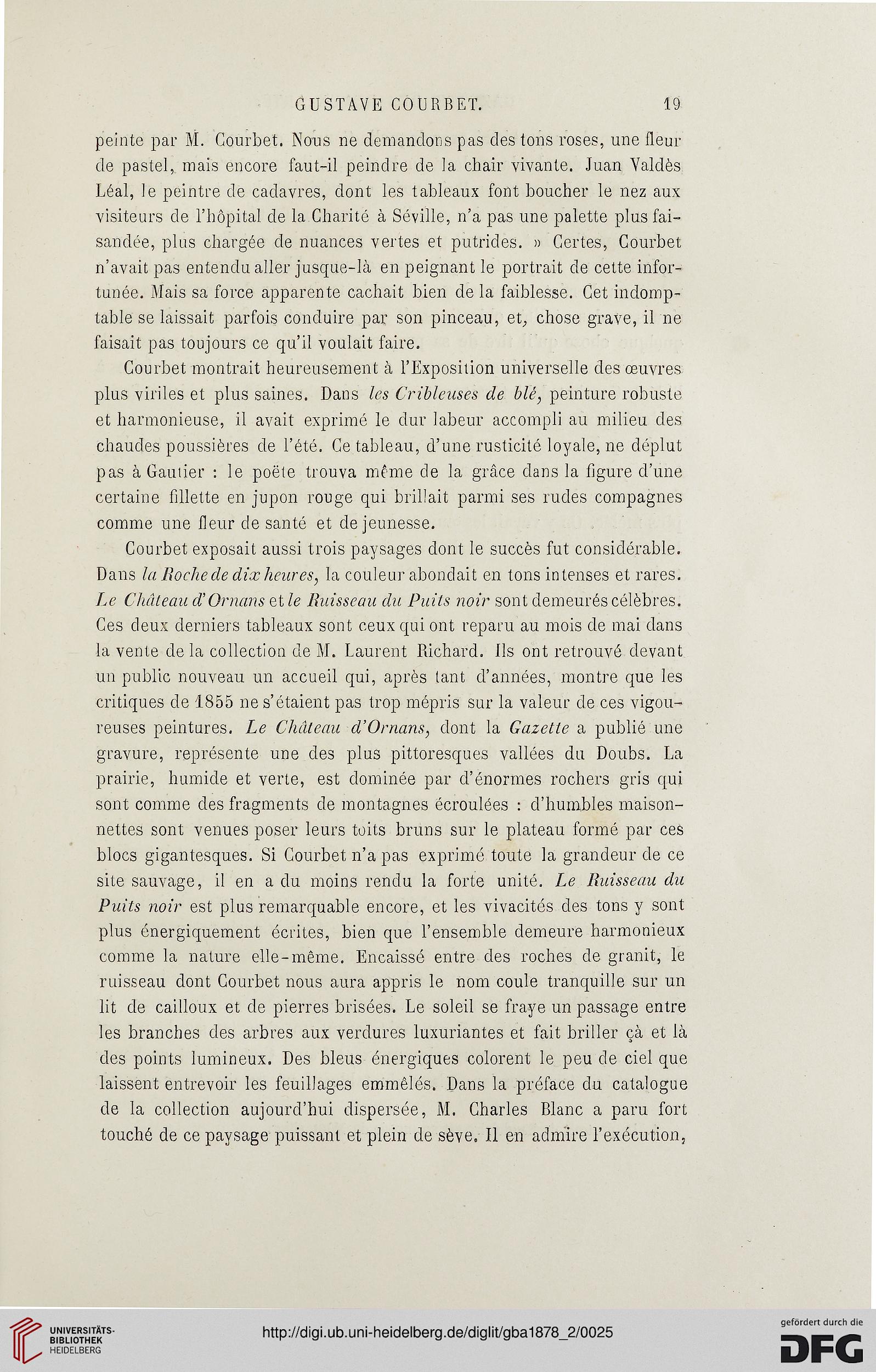GUSTAVE COURBET.
19
peinte par M. Courbet. Nous ne demandons pas des tons roses, une fleur
de pastel, mais encore faut-il peindre de la chair vivante. Juan Yaldès
Léal, le peintre de cadavres, dont les tableaux font boucher le nez aux
visiteurs de l’hôpital de la Charité à Séville, n’a pas une palette plus fai-
sandée, plus chargée de nuances vertes et putrides. » Certes, Courbet
n’avait pas entendu aller jusque-là en peignant le portrait de cette infor-
tunée. Mais sa force apparente cachait bien de la faiblesse. Cet indomp-
table se laissait parfois conduire par son pinceau, et, chose grave, il ne
faisait pas toujours ce qu’il voulait faire.
Courbet montrait heureusement à l’Exposition universelle des œuvres
plus viriles et plus saines. Dans les Cribleuses de blé, peinture robuste
et harmonieuse, il avait exprimé le dur labeur accompli au milieu des
chaudes poussières de l’été. Ce tableau, d’une rusticité loyale, ne déplut
pas à Gautier : le poète trouva même de la grâce dans la figure d’une
certaine fillette en jupon rouge qui brillait parmi ses rudes compagnes
comme une fleur de santé et de jeunesse.
Courbet exposait aussi trois paysages dont le succès fut considérable.
Dans la Roche de dix heures, la couleur abondait en tons intenses et rares.
Le Château cl’Ornans et le Ruisseau du Puits noir sont demeurés célèbres.
Ces deux derniers tableaux sont ceux qui ont reparu au mois de mai dans
la vente de la collection de M. Laurent Richard. Ils ont retrouvé devant
un public nouveau un accueil qui, après tant d’années, montre que les
critiques de 1855 ne s’étaient pas trop mépris sur la valeur de ces vigou-
reuses peintures. Le Château cl’Ornans, dont la Gazette a publié une
gravure, représente une des plus pittoresques vallées du Doubs. La
prairie, humide et verte, est dominée par d’énormes rochers gris qui
sont comme des fragments de montagnes écroulées : d’humbles maison-
nettes sont venues poser leurs toits bruns sur le plateau formé par ces
blocs gigantesques. Si Courbet n’a pas exprimé toute la grandeur de ce
site sauvage, il en a du moins rendu la forte unité. Le Ruisseau du
Puits noir est plus remarquable encore, et les vivacités des tons y sont
plus énergiquement écrites, bien que l’ensemble demeure harmonieux
comme la nature elle-même. Encaissé entre des roches de granit, le
ruisseau dont Courbet nous aura appris le nom coule tranquille sur un
lit de cailloux et de pierres brisées. Le soleil se fraye un passage entre
les branches des arbres aux verdures luxuriantes et fait briller çà et là
des points lumineux. Des bleus énergiques colorent le peu de ciel que
laissent entrevoir les feuillages emmêlés. Dans la préface du catalogue
de la collection aujourd’hui dispersée, M. Charles Blanc a paru fort
touché de ce paysage puissant et plein de sève. Il en admire l’exécution,
19
peinte par M. Courbet. Nous ne demandons pas des tons roses, une fleur
de pastel, mais encore faut-il peindre de la chair vivante. Juan Yaldès
Léal, le peintre de cadavres, dont les tableaux font boucher le nez aux
visiteurs de l’hôpital de la Charité à Séville, n’a pas une palette plus fai-
sandée, plus chargée de nuances vertes et putrides. » Certes, Courbet
n’avait pas entendu aller jusque-là en peignant le portrait de cette infor-
tunée. Mais sa force apparente cachait bien de la faiblesse. Cet indomp-
table se laissait parfois conduire par son pinceau, et, chose grave, il ne
faisait pas toujours ce qu’il voulait faire.
Courbet montrait heureusement à l’Exposition universelle des œuvres
plus viriles et plus saines. Dans les Cribleuses de blé, peinture robuste
et harmonieuse, il avait exprimé le dur labeur accompli au milieu des
chaudes poussières de l’été. Ce tableau, d’une rusticité loyale, ne déplut
pas à Gautier : le poète trouva même de la grâce dans la figure d’une
certaine fillette en jupon rouge qui brillait parmi ses rudes compagnes
comme une fleur de santé et de jeunesse.
Courbet exposait aussi trois paysages dont le succès fut considérable.
Dans la Roche de dix heures, la couleur abondait en tons intenses et rares.
Le Château cl’Ornans et le Ruisseau du Puits noir sont demeurés célèbres.
Ces deux derniers tableaux sont ceux qui ont reparu au mois de mai dans
la vente de la collection de M. Laurent Richard. Ils ont retrouvé devant
un public nouveau un accueil qui, après tant d’années, montre que les
critiques de 1855 ne s’étaient pas trop mépris sur la valeur de ces vigou-
reuses peintures. Le Château cl’Ornans, dont la Gazette a publié une
gravure, représente une des plus pittoresques vallées du Doubs. La
prairie, humide et verte, est dominée par d’énormes rochers gris qui
sont comme des fragments de montagnes écroulées : d’humbles maison-
nettes sont venues poser leurs toits bruns sur le plateau formé par ces
blocs gigantesques. Si Courbet n’a pas exprimé toute la grandeur de ce
site sauvage, il en a du moins rendu la forte unité. Le Ruisseau du
Puits noir est plus remarquable encore, et les vivacités des tons y sont
plus énergiquement écrites, bien que l’ensemble demeure harmonieux
comme la nature elle-même. Encaissé entre des roches de granit, le
ruisseau dont Courbet nous aura appris le nom coule tranquille sur un
lit de cailloux et de pierres brisées. Le soleil se fraye un passage entre
les branches des arbres aux verdures luxuriantes et fait briller çà et là
des points lumineux. Des bleus énergiques colorent le peu de ciel que
laissent entrevoir les feuillages emmêlés. Dans la préface du catalogue
de la collection aujourd’hui dispersée, M. Charles Blanc a paru fort
touché de ce paysage puissant et plein de sève. Il en admire l’exécution,