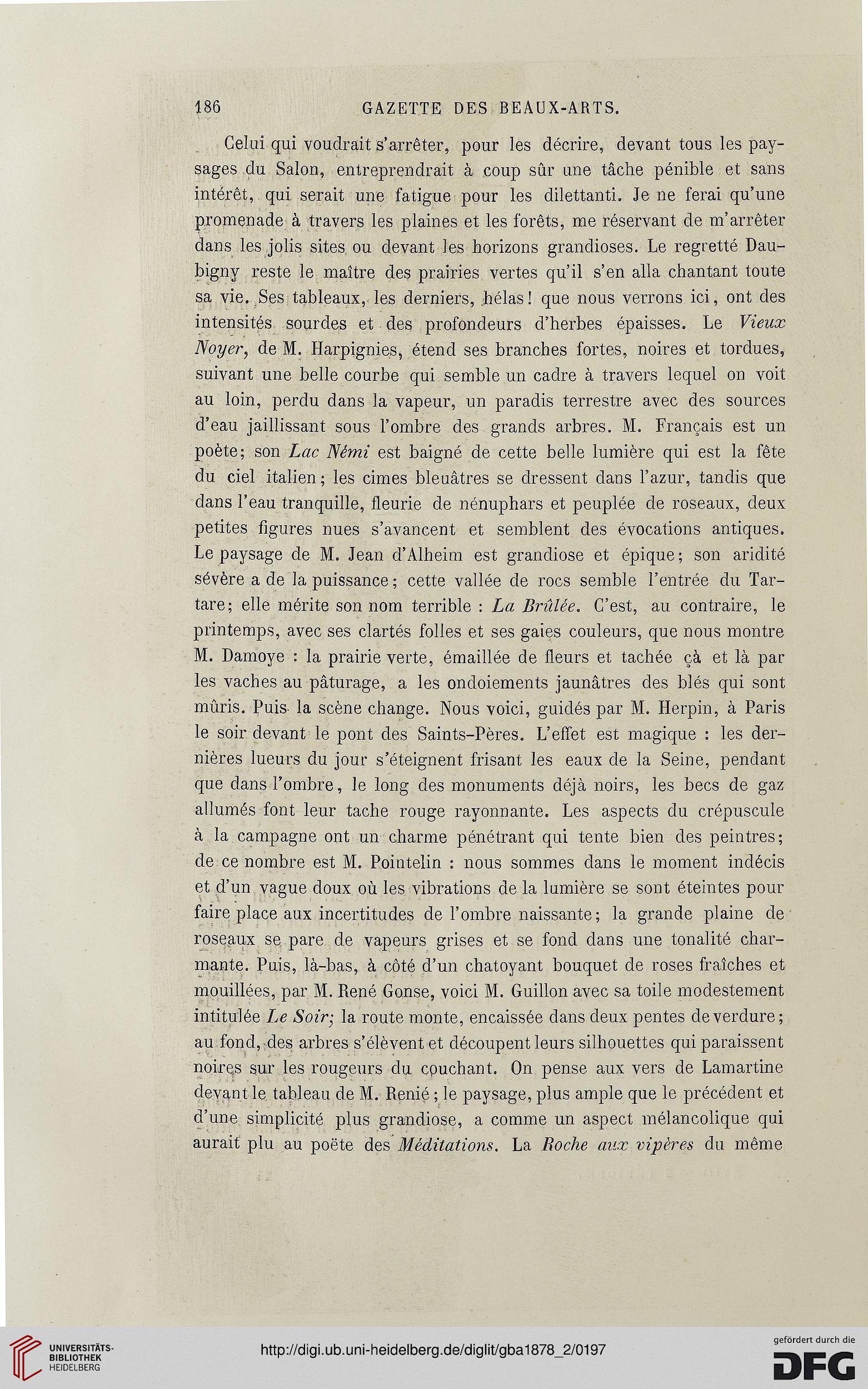186
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
Celui qui voudrait s’arrêter, pour les décrire, devant tous les pay-
sages du Salon, entreprendrait à coup sûr une tâche pénible et sans
intérêt, qui serait une fatigue pour les dilettanti. Je ne ferai qu’une
promenade à travers les plaines et les forêts, me réservant de m’arrêter
dans les jolis sites ou devant les horizons grandioses. Le regretté Dau-
bigny reste le maître des prairies vertes qu’il s’en alla chantant toute
sa vie. Ses tableaux, les derniers, hélas! que nous verrons ici, ont des
intensités sourdes et des profondeurs d’herbes épaisses. Le Vieux
Noyer, de M. Harpignies, étend ses branches fortes, noires et tordues,
suivant une belle courbe qui semble un cadre à travers lequel on voit
au loin, perdu dans la vapeur, un paradis terrestre avec des sources
d’eau jaillissant sous l’ombre des grands arbres. M. Français est un
poète; son Lac Nèmi est baigné de cette belle lumière qui est la fête
du ciel italien ; les cimes bleuâtres se dressent dans l’azur, tandis que
dans l’eau tranquille, fleurie de nénuphars et peuplée de roseaux, deux
petites figures nues s’avancent et semblent des évocations antiques.
Le paysage de M. Jean d’Alheim est grandiose et épique; son aridité
sévère a de la puissance ; cette vallée de rocs semble l’entrée du Tar-
tare; elle mérite son nom terrible : La Brûlée. C’est, au contraire, le
printemps, avec ses clartés folles et ses gaies couleurs, que nous montre
M. Damoye : la prairie verte, émaillée de fleurs et tachée çà et là par
les vaches au pâturage, a les ondoiements jaunâtres des blés qui sont
mûris. Puis- la scène change. Nous voici, guidés par M. Herpin, à Paris
le soir devant le pont des Saints-Pères. L’effet est magique : les der-
nières lueurs du jour s’éteignent frisant les eaux de la Seine, pendant
que dans l’ombre, le long des monuments déjà noirs, les becs de gaz
allumés font leur tache rouge rayonnante. Les aspects du crépuscule
à la campagne ont un charme pénétrant qui tente bien des peintres;
de ce nombre est M. Pointelin : nous sommes dans le moment indécis
et d’un vague doux où les vibrations de la lumière se sont éteintes pour
faire place aux incertitudes de l’ombre naissante; la grande plaine de
roseaux se pare de vapeurs grises et se fond dans une tonalité char-
mante. Puis, là-bas, à côté d’un chatoyant bouquet de roses fraîches et
mouillées, par M. René Gonse, voici M. Guillon avec sa toile modestement
intitulée Le Soir• la route monte, encaissée dans deux pentes de verdure;
au fond, des arbres s’élèvent et découpent leurs silhouettes qui paraissent
noirçs sur les rougeurs du couchant. On pense aux vers de Lamartine
devant le tableau de M. Renié ; le paysage, plus ample que le précédent et
d’une simplicité plus grandiose, a comme un aspect mélancolique qui
aurait plu au poète des Méditations. La Boche aux vipères du même
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
Celui qui voudrait s’arrêter, pour les décrire, devant tous les pay-
sages du Salon, entreprendrait à coup sûr une tâche pénible et sans
intérêt, qui serait une fatigue pour les dilettanti. Je ne ferai qu’une
promenade à travers les plaines et les forêts, me réservant de m’arrêter
dans les jolis sites ou devant les horizons grandioses. Le regretté Dau-
bigny reste le maître des prairies vertes qu’il s’en alla chantant toute
sa vie. Ses tableaux, les derniers, hélas! que nous verrons ici, ont des
intensités sourdes et des profondeurs d’herbes épaisses. Le Vieux
Noyer, de M. Harpignies, étend ses branches fortes, noires et tordues,
suivant une belle courbe qui semble un cadre à travers lequel on voit
au loin, perdu dans la vapeur, un paradis terrestre avec des sources
d’eau jaillissant sous l’ombre des grands arbres. M. Français est un
poète; son Lac Nèmi est baigné de cette belle lumière qui est la fête
du ciel italien ; les cimes bleuâtres se dressent dans l’azur, tandis que
dans l’eau tranquille, fleurie de nénuphars et peuplée de roseaux, deux
petites figures nues s’avancent et semblent des évocations antiques.
Le paysage de M. Jean d’Alheim est grandiose et épique; son aridité
sévère a de la puissance ; cette vallée de rocs semble l’entrée du Tar-
tare; elle mérite son nom terrible : La Brûlée. C’est, au contraire, le
printemps, avec ses clartés folles et ses gaies couleurs, que nous montre
M. Damoye : la prairie verte, émaillée de fleurs et tachée çà et là par
les vaches au pâturage, a les ondoiements jaunâtres des blés qui sont
mûris. Puis- la scène change. Nous voici, guidés par M. Herpin, à Paris
le soir devant le pont des Saints-Pères. L’effet est magique : les der-
nières lueurs du jour s’éteignent frisant les eaux de la Seine, pendant
que dans l’ombre, le long des monuments déjà noirs, les becs de gaz
allumés font leur tache rouge rayonnante. Les aspects du crépuscule
à la campagne ont un charme pénétrant qui tente bien des peintres;
de ce nombre est M. Pointelin : nous sommes dans le moment indécis
et d’un vague doux où les vibrations de la lumière se sont éteintes pour
faire place aux incertitudes de l’ombre naissante; la grande plaine de
roseaux se pare de vapeurs grises et se fond dans une tonalité char-
mante. Puis, là-bas, à côté d’un chatoyant bouquet de roses fraîches et
mouillées, par M. René Gonse, voici M. Guillon avec sa toile modestement
intitulée Le Soir• la route monte, encaissée dans deux pentes de verdure;
au fond, des arbres s’élèvent et découpent leurs silhouettes qui paraissent
noirçs sur les rougeurs du couchant. On pense aux vers de Lamartine
devant le tableau de M. Renié ; le paysage, plus ample que le précédent et
d’une simplicité plus grandiose, a comme un aspect mélancolique qui
aurait plu au poète des Méditations. La Boche aux vipères du même