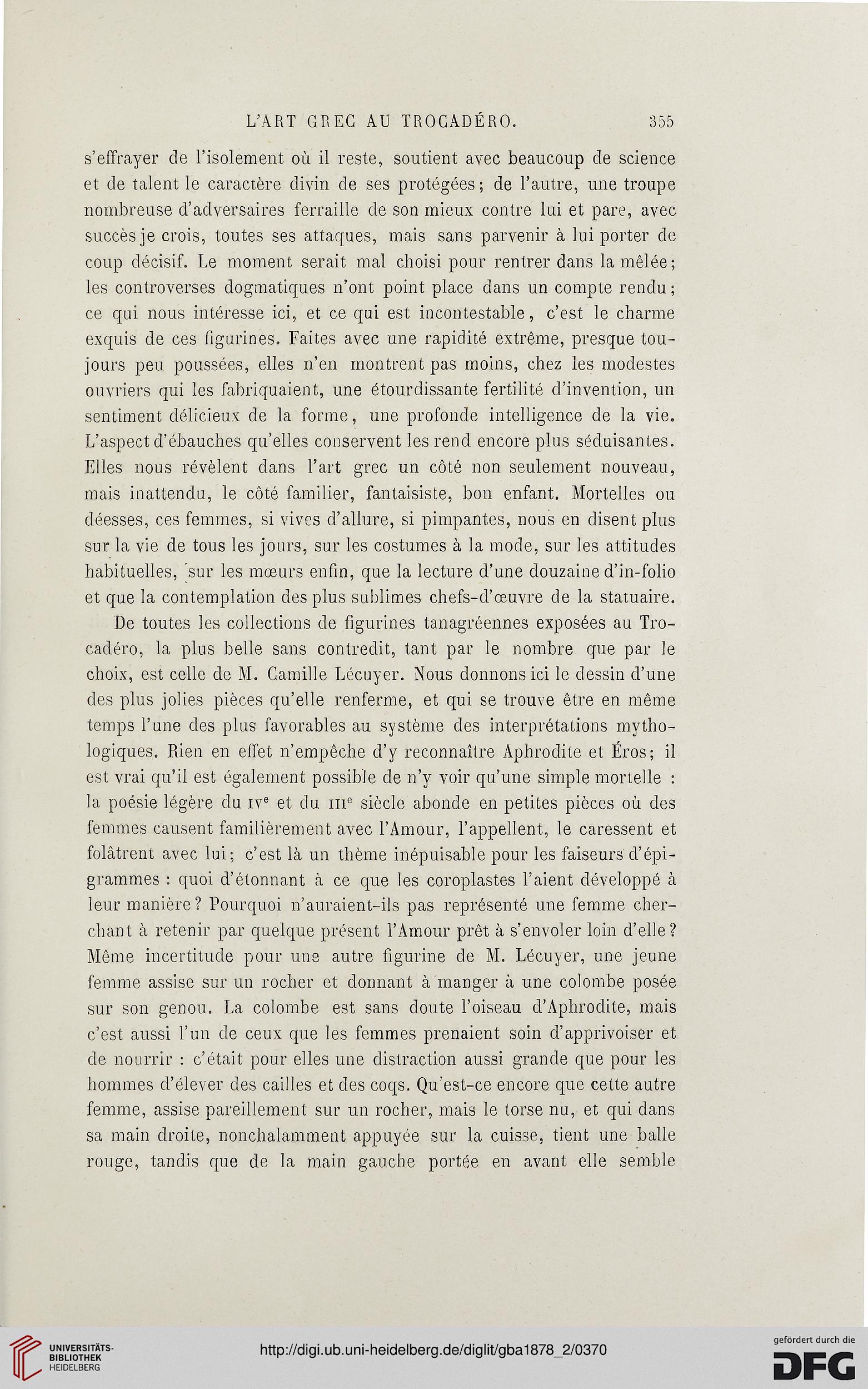L’ART GREC AU TROCADÉRO.
355
s’effrayer de l’isolement où il reste, soutient avec beaucoup de science
et de talent le caractère divin de ses protégées ; de l’autre, une troupe
nombreuse d’adversaires ferraille de son mieux contre lui et pare, avec
succès je crois, toutes ses attaques, mais sans parvenir à lui porter de
coup décisif. Le moment serait mal choisi pour rentrer dans la mêlée;
les controverses dogmatiques n’ont point place dans un compte rendu ;
ce qui nous intéresse ici, et ce qui est incontestable, c’est le charme
exquis de ces figurines. Faites avec une rapidité extrême, presque tou-
jours peu poussées, elles n’en montrent pas moins, chez les modestes
ouvriers qui les fabriquaient, une étourdissante fertilité d’invention, un
sentiment délicieux de la forme, une profonde intelligence de la vie.
L’aspect d'ébauches qu’elles conservent les rend encore plus séduisantes.
Elles nous révèlent dans l’art grec un côté non seulement nouveau,
mais inattendu, le côté familier, fantaisiste, bon enfant. Mortelles ou
déesses, ces femmes, si vives d’allure, si pimpantes, nous en disent plus
sur la vie de tous les jours, sur les costumes à la mode, sur les attitudes
habituelles, sur les mœurs enfin, que la lecture d’une douzaine d’in-folio
et que la contemplation des plus sublimes chefs-d’œuvre de la statuaire.
Ue toutes les collections de figurines tanagréennes exposées au Tro-
cadéro, la plus belle sans contredit, tant par le nombre que par le
choix, est celle de M. Camille Lécuyer. Nous donnons ici le dessin d’une
des plus jolies pièces qu’elle renferme, et qui se trouve être en même
temps l’une des plus favorables au système des interprétations mytho-
logiques. Rien en effet n’empêche d’y reconnaître Aphrodite et Éros; il
est vrai qu’il est également possible de n’y voir qu’une simple mortelle :
la poésie légère du ive et du me siècle abonde en petites pièces où des
femmes causent familièrement avec l’Amour, l’appellent, le caressent et
folâtrent avec lui; c’est là un thème inépuisable pour les faiseurs d’épi-
grammes : quoi d’étonnant h ce que les coroplastes l’aient développé à
leur manière? Pourquoi n’auraient-ils pas représenté une femme cher-
chant à retenir par quelque présent l’Amour prêt à s’envoler loin d’elle?
Même incertitude pour une autre figurine de M. Lécuyer, une jeune
femme assise sur un rocher et donnant à manger à une colombe posée
sur son genou. La colombe est sans doute l’oiseau d’Aphrodite, mais
c’est aussi l’un de ceux que les femmes prenaient soin d’apprivoiser et
de nourrir : c’était pour elles une distraction aussi grande que pour les
hommes d’élever des cailles et des coqs. Qu'est-ce encore que cette autre
femme, assise pareillement sur un rocher, mais le torse nu, et qui dans
sa main droite, nonchalamment appuyée sur la cuisse, tient une balle
rouge, tandis que de la main gauche portée en avant elle semble
355
s’effrayer de l’isolement où il reste, soutient avec beaucoup de science
et de talent le caractère divin de ses protégées ; de l’autre, une troupe
nombreuse d’adversaires ferraille de son mieux contre lui et pare, avec
succès je crois, toutes ses attaques, mais sans parvenir à lui porter de
coup décisif. Le moment serait mal choisi pour rentrer dans la mêlée;
les controverses dogmatiques n’ont point place dans un compte rendu ;
ce qui nous intéresse ici, et ce qui est incontestable, c’est le charme
exquis de ces figurines. Faites avec une rapidité extrême, presque tou-
jours peu poussées, elles n’en montrent pas moins, chez les modestes
ouvriers qui les fabriquaient, une étourdissante fertilité d’invention, un
sentiment délicieux de la forme, une profonde intelligence de la vie.
L’aspect d'ébauches qu’elles conservent les rend encore plus séduisantes.
Elles nous révèlent dans l’art grec un côté non seulement nouveau,
mais inattendu, le côté familier, fantaisiste, bon enfant. Mortelles ou
déesses, ces femmes, si vives d’allure, si pimpantes, nous en disent plus
sur la vie de tous les jours, sur les costumes à la mode, sur les attitudes
habituelles, sur les mœurs enfin, que la lecture d’une douzaine d’in-folio
et que la contemplation des plus sublimes chefs-d’œuvre de la statuaire.
Ue toutes les collections de figurines tanagréennes exposées au Tro-
cadéro, la plus belle sans contredit, tant par le nombre que par le
choix, est celle de M. Camille Lécuyer. Nous donnons ici le dessin d’une
des plus jolies pièces qu’elle renferme, et qui se trouve être en même
temps l’une des plus favorables au système des interprétations mytho-
logiques. Rien en effet n’empêche d’y reconnaître Aphrodite et Éros; il
est vrai qu’il est également possible de n’y voir qu’une simple mortelle :
la poésie légère du ive et du me siècle abonde en petites pièces où des
femmes causent familièrement avec l’Amour, l’appellent, le caressent et
folâtrent avec lui; c’est là un thème inépuisable pour les faiseurs d’épi-
grammes : quoi d’étonnant h ce que les coroplastes l’aient développé à
leur manière? Pourquoi n’auraient-ils pas représenté une femme cher-
chant à retenir par quelque présent l’Amour prêt à s’envoler loin d’elle?
Même incertitude pour une autre figurine de M. Lécuyer, une jeune
femme assise sur un rocher et donnant à manger à une colombe posée
sur son genou. La colombe est sans doute l’oiseau d’Aphrodite, mais
c’est aussi l’un de ceux que les femmes prenaient soin d’apprivoiser et
de nourrir : c’était pour elles une distraction aussi grande que pour les
hommes d’élever des cailles et des coqs. Qu'est-ce encore que cette autre
femme, assise pareillement sur un rocher, mais le torse nu, et qui dans
sa main droite, nonchalamment appuyée sur la cuisse, tient une balle
rouge, tandis que de la main gauche portée en avant elle semble