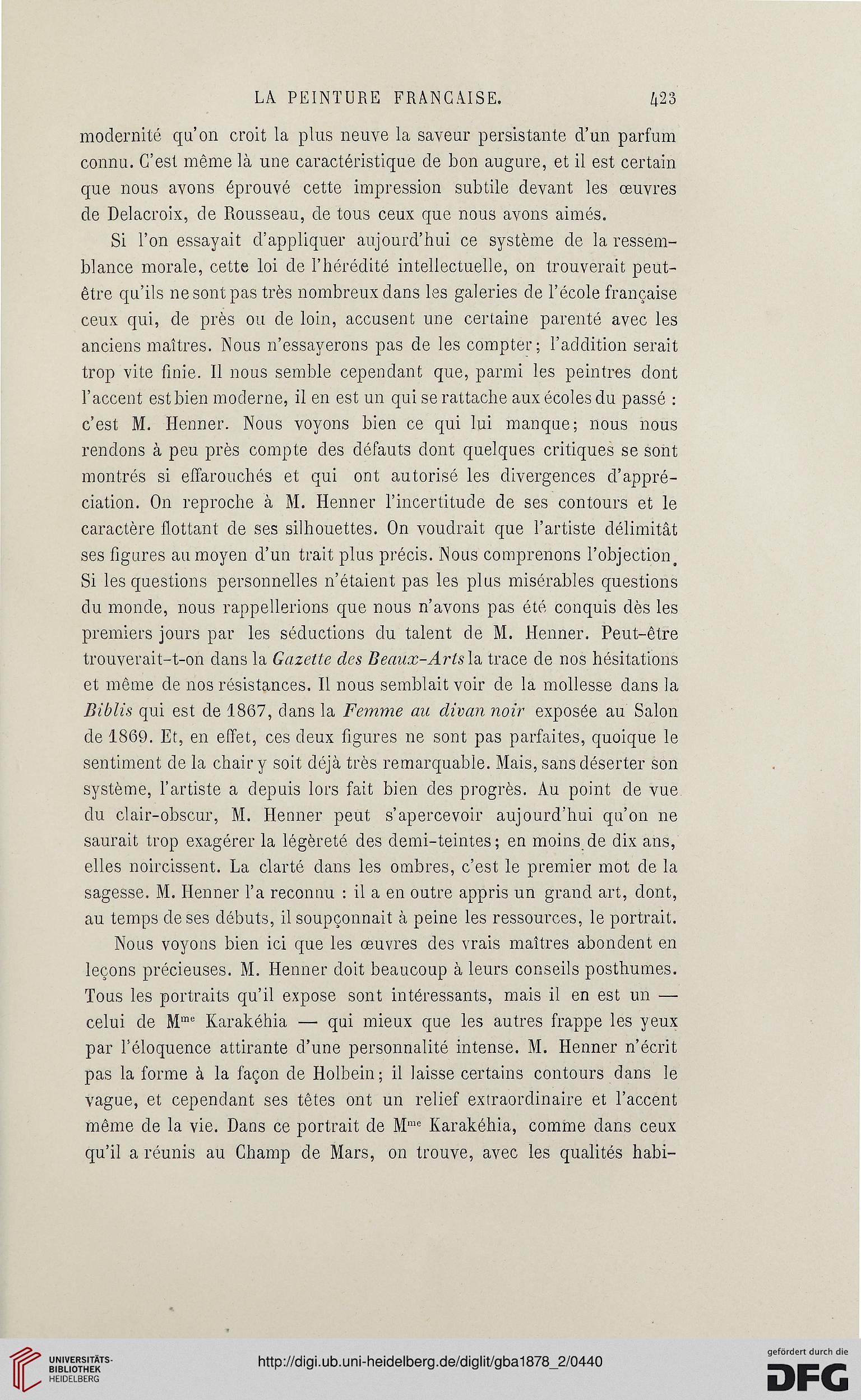LÀ PEINTURE FRANÇAISE.
à23
modernité qu’on croit la plus neuve la saveur persistante d’un parfum
connu. C’est même là une caractéristique de bon augure, et il est certain
que nous avons éprouvé cette impression subtile devant les œuvres
de Delacroix, de Rousseau, de tous ceux que nous avons aimés.
Si l’on essayait d’appliquer aujourd’hui ce système de la ressem-
blance morale, cette loi de l’hérédité intellectuelle, on trouverait peut-
être qu’ils ne sont pas très nombreux dans les galeries de l’école française
ceux qui, de près ou de loin, accusent une certaine parenté avec les
anciens maîtres. Nous n’essaverons pas de les compter; l’addition serait
trop vite finie. Il nous semble cependant que, parmi les peintres dont
l’accent est bien moderne, il en est un qui se rattache aux écoles du passé :
c’est M. Henner. Nous voyons bien ce qui lui manque; nous nous
rendons à peu près compte des défauts dont quelques critiques se sont
montrés si effarouchés et qui ont autorisé les divergences d’appré-
ciation. On reproche à M. Henner l’incertitude de ses contours et le
caractère flottant de ses silhouettes. On voudrait que l’artiste délimitât
ses figures au moyen d’un trait plus précis. Nous comprenons l’objection.
Si les questions personnelles n’étaient pas les plus misérables questions
du monde, nous rappellerions que nous n’avons pas été conquis dès les
premiers jours par les séductions du talent de M. Henner. Peut-être
trouverait-t-on dans la Gazette des Beaux-Arts\& trace de nos hésitations
et même de nos résistances. Il nous semblait voir de la mollesse dans la
Biblis qui est de 1867, dans la Femme au divan noir exposée au Salon
de 1869. Et, en effet, ces deux figures ne sont pas parfaites, quoique le
sentiment de la chair y soit déjà très remarquable. Mais, sans déserter son
système, l’artiste a depuis lors fait bien des progrès. Au point de vue
du clair-obscur, M. Henner peut s’apercevoir aujourd'hui qu’on ne
saurait trop exagérer la légèreté des demi-teintes; en moins de dix ans,
elles noircissent. La clarté dans les ombres, c’est le premier mot de la
sagesse. M. Henner l’a reconnu : il a en outre appris un grand art, dont,
au temps de ses débuts, il soupçonnait à peine les ressources, le portrait.
Nous voyons bien ici que les œuvres des vrais maîtres abondent en
leçons précieuses. M. Henner doit beaucoup à leurs conseils posthumes.
Tous les portraits qu’il expose sont intéressants, mais il en est un —
celui de Mme Karakéhia — qui mieux que les autres frappe les yeux
par l’éloquence attirante d’une personnalité intense. M. Henner n’écrit
pas la forme à la façon de Holbein; il laisse certains contours dans le
vague, et cependant ses têtes ont un relief extraordinaire et l’accent
même de la vie. Dans ce portrait de Mme Karakéhia, comme dans ceux
qu’il a réunis au Champ de Mars, on trouve, avec les qualités habi-
à23
modernité qu’on croit la plus neuve la saveur persistante d’un parfum
connu. C’est même là une caractéristique de bon augure, et il est certain
que nous avons éprouvé cette impression subtile devant les œuvres
de Delacroix, de Rousseau, de tous ceux que nous avons aimés.
Si l’on essayait d’appliquer aujourd’hui ce système de la ressem-
blance morale, cette loi de l’hérédité intellectuelle, on trouverait peut-
être qu’ils ne sont pas très nombreux dans les galeries de l’école française
ceux qui, de près ou de loin, accusent une certaine parenté avec les
anciens maîtres. Nous n’essaverons pas de les compter; l’addition serait
trop vite finie. Il nous semble cependant que, parmi les peintres dont
l’accent est bien moderne, il en est un qui se rattache aux écoles du passé :
c’est M. Henner. Nous voyons bien ce qui lui manque; nous nous
rendons à peu près compte des défauts dont quelques critiques se sont
montrés si effarouchés et qui ont autorisé les divergences d’appré-
ciation. On reproche à M. Henner l’incertitude de ses contours et le
caractère flottant de ses silhouettes. On voudrait que l’artiste délimitât
ses figures au moyen d’un trait plus précis. Nous comprenons l’objection.
Si les questions personnelles n’étaient pas les plus misérables questions
du monde, nous rappellerions que nous n’avons pas été conquis dès les
premiers jours par les séductions du talent de M. Henner. Peut-être
trouverait-t-on dans la Gazette des Beaux-Arts\& trace de nos hésitations
et même de nos résistances. Il nous semblait voir de la mollesse dans la
Biblis qui est de 1867, dans la Femme au divan noir exposée au Salon
de 1869. Et, en effet, ces deux figures ne sont pas parfaites, quoique le
sentiment de la chair y soit déjà très remarquable. Mais, sans déserter son
système, l’artiste a depuis lors fait bien des progrès. Au point de vue
du clair-obscur, M. Henner peut s’apercevoir aujourd'hui qu’on ne
saurait trop exagérer la légèreté des demi-teintes; en moins de dix ans,
elles noircissent. La clarté dans les ombres, c’est le premier mot de la
sagesse. M. Henner l’a reconnu : il a en outre appris un grand art, dont,
au temps de ses débuts, il soupçonnait à peine les ressources, le portrait.
Nous voyons bien ici que les œuvres des vrais maîtres abondent en
leçons précieuses. M. Henner doit beaucoup à leurs conseils posthumes.
Tous les portraits qu’il expose sont intéressants, mais il en est un —
celui de Mme Karakéhia — qui mieux que les autres frappe les yeux
par l’éloquence attirante d’une personnalité intense. M. Henner n’écrit
pas la forme à la façon de Holbein; il laisse certains contours dans le
vague, et cependant ses têtes ont un relief extraordinaire et l’accent
même de la vie. Dans ce portrait de Mme Karakéhia, comme dans ceux
qu’il a réunis au Champ de Mars, on trouve, avec les qualités habi-