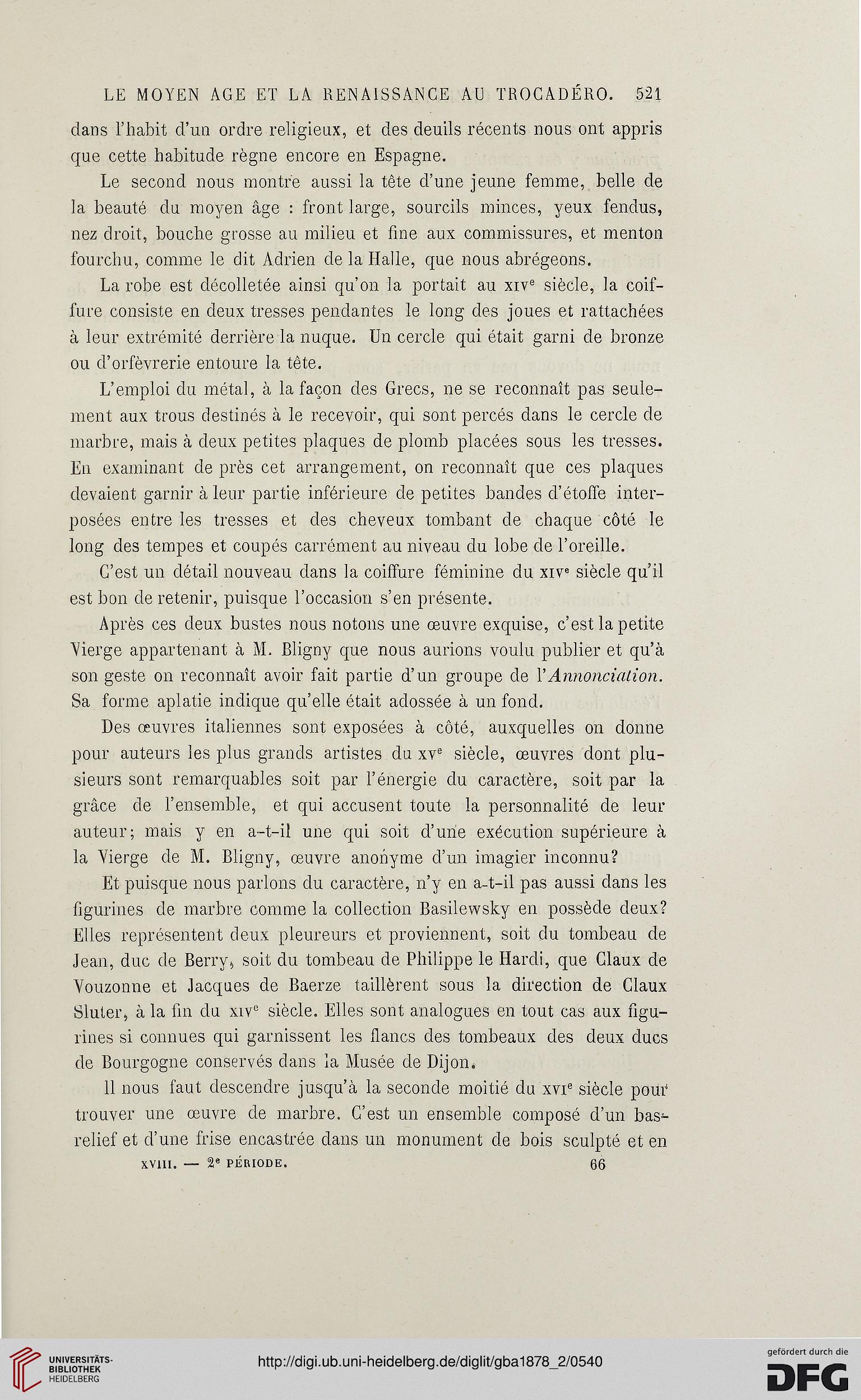LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE AL TROGADÉRO. 521
dans l’habit d’un ordre religieux, et des deuils récents nous ont appris
que cette habitude règne encore en Espagne.
Le second nous montre aussi la tête d’une jeune femme, belle de
la beauté du moyen âge : front large, sourcils minces, yeux fendus,
nez droit, bouche grosse au milieu et fine aux commissures, et menton
fourchu, comme le dit Adrien de la Halle, que nous abrégeons.
La robe est décolletée ainsi qu’on la portait au xive siècle, la coif-
fure consiste en deux tresses pendantes le long des joues et rattachées
à leur extrémité derrière la nuque. Un cercle qui était garni de bronze
ou d’orfèvrerie entoure la tête.
L’emploi du métal, à la façon des Grecs, ne se reconnaît pas seule-
ment aux trous destinés à le recevoir, qui sont percés dans le cercle de
marbre, mais à deux petites plaques de plomb placées sous les tresses.
En examinant de près cet arrangement, on reconnaît que ces plaques
devaient garnir à leur partie inférieure de petites bandes d’étolfe inter-
posées entre les tresses et des cheveux tombant de chaque côté le
long des tempes et coupés carrément au niveau du lobe de l’oreille.
C’est un détail nouveau dans la coiffure féminine du xive siècle qu’il
est bon de retenir, puisque l’occasion s’en présente.
Après ces deux bustes nous notons une œuvre exquise, c’est la petite
"Vierge appartenant à M. Bligny que nous aurions voulu publier et qu’à
son geste on reconnaît avoir fait partie d’un groupe de V Annonciation.
Sa forme aplatie indique qu’elle était adossée à un fond.
Des œuvres italiennes sont exposées à côté, auxquelles on donne
pour auteurs les plus grands artistes du xve siècle, œuvres dont plu-
sieurs sont remarquables soit par l’énergie du caractère, soit par la
grâce de l’ensemble, et qui accusent toute la personnalité de leur
auteur; mais y en a-t-il une qui soit d’une exécution supérieure à
la Vierge de M. Bligny, œuvre anonyme d’un imagier inconnu?
Et puisque nous parlons du caractère, n’y en a-t-il pas aussi dans les
figurines de marbre comme la collection Basilewsky en possède deux?
Elles représentent deux pleureurs et proviennent, soit du tombeau de
Jean, duc de Berry, soit du tombeau de Philippe le Hardi, que Claux de
Vouzonne et Jacques de Baerze taillèrent sous la direction de Claux
Sluter, à la fin du xive siècle. Elles sont analogues en tout cas aux figu-
rines si connues qui garnissent les flancs des tombeaux des deux ducs
de Bourgogne conservés dans la Musée de Dijon,
11 nous faut descendre jusqu’à la seconde moitié du xvie siècle pouf
trouver une œuvre de marbre. C’est un ensemble composé d’un bas-
relief et d’une frise encastrée dans un monument de bois sculpté et en
XVIII. — 2e PERIODE. 66
dans l’habit d’un ordre religieux, et des deuils récents nous ont appris
que cette habitude règne encore en Espagne.
Le second nous montre aussi la tête d’une jeune femme, belle de
la beauté du moyen âge : front large, sourcils minces, yeux fendus,
nez droit, bouche grosse au milieu et fine aux commissures, et menton
fourchu, comme le dit Adrien de la Halle, que nous abrégeons.
La robe est décolletée ainsi qu’on la portait au xive siècle, la coif-
fure consiste en deux tresses pendantes le long des joues et rattachées
à leur extrémité derrière la nuque. Un cercle qui était garni de bronze
ou d’orfèvrerie entoure la tête.
L’emploi du métal, à la façon des Grecs, ne se reconnaît pas seule-
ment aux trous destinés à le recevoir, qui sont percés dans le cercle de
marbre, mais à deux petites plaques de plomb placées sous les tresses.
En examinant de près cet arrangement, on reconnaît que ces plaques
devaient garnir à leur partie inférieure de petites bandes d’étolfe inter-
posées entre les tresses et des cheveux tombant de chaque côté le
long des tempes et coupés carrément au niveau du lobe de l’oreille.
C’est un détail nouveau dans la coiffure féminine du xive siècle qu’il
est bon de retenir, puisque l’occasion s’en présente.
Après ces deux bustes nous notons une œuvre exquise, c’est la petite
"Vierge appartenant à M. Bligny que nous aurions voulu publier et qu’à
son geste on reconnaît avoir fait partie d’un groupe de V Annonciation.
Sa forme aplatie indique qu’elle était adossée à un fond.
Des œuvres italiennes sont exposées à côté, auxquelles on donne
pour auteurs les plus grands artistes du xve siècle, œuvres dont plu-
sieurs sont remarquables soit par l’énergie du caractère, soit par la
grâce de l’ensemble, et qui accusent toute la personnalité de leur
auteur; mais y en a-t-il une qui soit d’une exécution supérieure à
la Vierge de M. Bligny, œuvre anonyme d’un imagier inconnu?
Et puisque nous parlons du caractère, n’y en a-t-il pas aussi dans les
figurines de marbre comme la collection Basilewsky en possède deux?
Elles représentent deux pleureurs et proviennent, soit du tombeau de
Jean, duc de Berry, soit du tombeau de Philippe le Hardi, que Claux de
Vouzonne et Jacques de Baerze taillèrent sous la direction de Claux
Sluter, à la fin du xive siècle. Elles sont analogues en tout cas aux figu-
rines si connues qui garnissent les flancs des tombeaux des deux ducs
de Bourgogne conservés dans la Musée de Dijon,
11 nous faut descendre jusqu’à la seconde moitié du xvie siècle pouf
trouver une œuvre de marbre. C’est un ensemble composé d’un bas-
relief et d’une frise encastrée dans un monument de bois sculpté et en
XVIII. — 2e PERIODE. 66