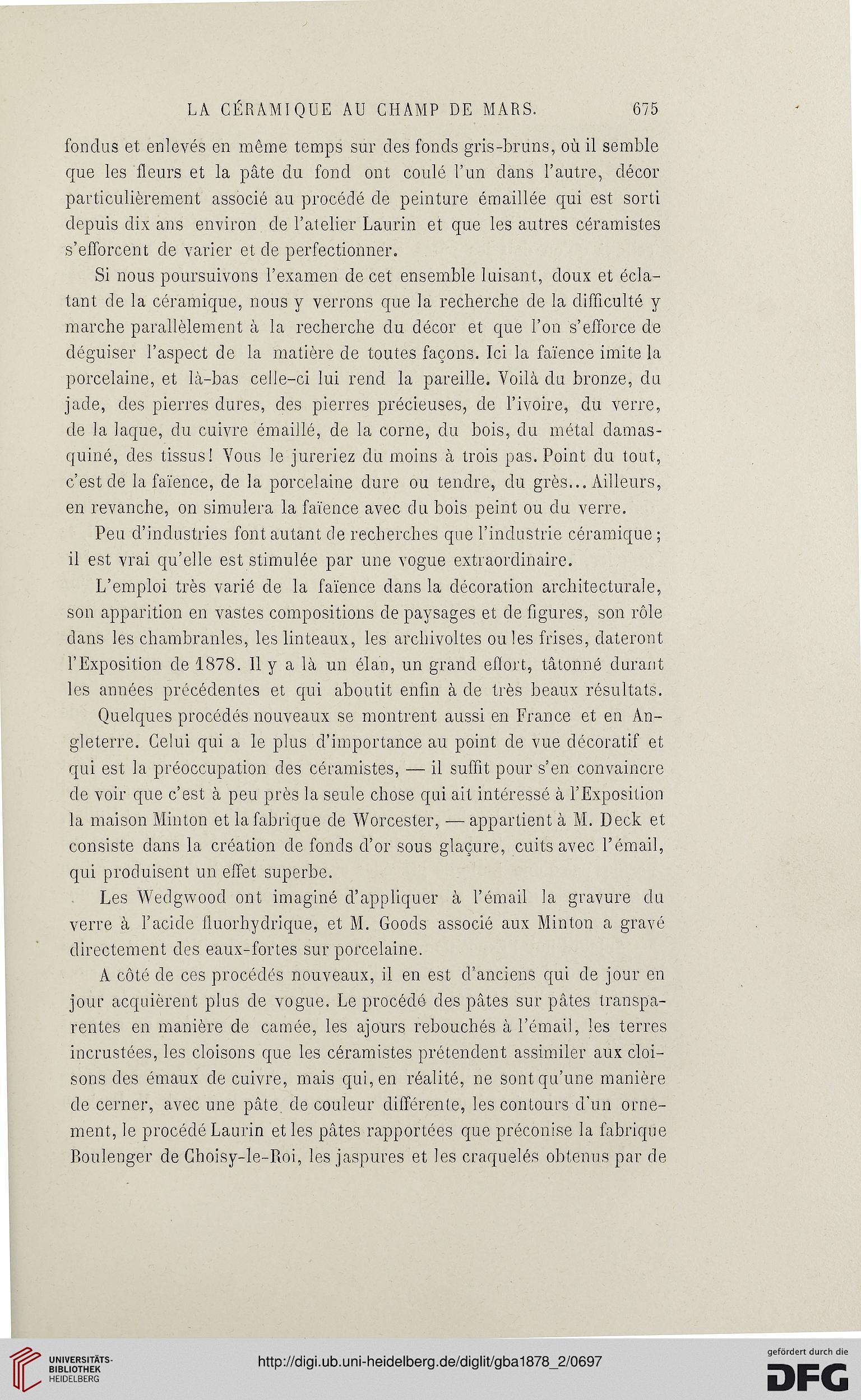LA CÉRAMIQUE AU CHAMP DE MARS.
675
fondus et enlevés en même temps sur des fonds gris-bruns, où il semble
que les fleurs et la pâte du fond ont coulé l’un dans l’autre, décor
particulièrement associé au procédé de peinture émaillée qui est sorti
depuis dix ans environ de l’atelier Laurin et que les autres céramistes
s’efforcent de varier et de perfectionner.
Si nous poursuivons l’examen de cet ensemble luisant, doux et écla-
tant de la céramique, nous y verrons que la recherche de la difficulté y
marche parallèlement à la recherche du décor et que l’on s’efforce de
déguiser l’aspect de la matière de toutes façons. Ici la faïence imite la
porcelaine, et là-bas celle-ci lui rend la pareille. Voilà du bronze, du
jade, des pierres dures, des pierres précieuses, de l’ivoire, du verre,
de la laque, du cuivre émaillé, de la corne, du bois, du métal damas-
quiné, des tissus! Vous le jureriez du moins à trois pas. Point du tout,
c’est de la faïence, de la porcelaine dure ou tendre, du grès... Ailleurs,
en revanche, on simulera la faïence avec du bois peint ou du verre.
Peu d’industries font autant de recherches que l’industrie céramique;
il est vrai qu’elle est stimulée par une vogue extraordinaire.
L’emploi très varié de la faïence dans la décoration architecturale,
son apparition en vastes compositions de paysages et de figures, son rôle
dans les chambranles, les linteaux, les archivoltes ouïes frises, dateront
l’Exposition de 1878. 11 y a là un élan, un grand effort, tâtonné durant
les années précédentes et qui aboutit enfin à de très beaux résultats.
Quelques procédés nouveaux se montrent aussi en France et en An-
gleterre. Celui qui a le plus d’importance au point de vue décoratif et
qui est la préoccupation des céramistes, — il suffit pour s’en convaincre
de voir que c’est à peu près la seule chose qui ait intéressé à l’Exposition
la maison Minton et la fabrique de Worcester, —appartient à M. Deck et
consiste dans la création de fonds d’or sous glaçure, cuits avec l’émail,
qui produisent un effet superbe.
Les Wedgwood ont imaginé d’appliquer à l’émail la gravure du
verre à l’acide fluorhydrique, et M. Goods associé aux Minton a gravé
directement des eaux-fortes sur porcelaine.
A côté de ces procédés nouveaux, il en est d’anciens qui de jour en
jour acquièrent plus de vogue. Le procédé des pâtes sur pâtes transpa-
rentes en manière de camée, les ajours rebouchés à l’émail, les terres
incrustées, les cloisons que les céramistes prétendent assimiler aux cloi-
sons des émaux de cuivre, mais qui, en réalité, ne sont qu’une manière
de cerner, avec une pâte de couleur différente, les contours d’un orne-
ment, le procédé Laurin et les pâtes rapportées que préconise la fabrique
Boulenger de Choisy-le-Roi, les jaspures et les craquelés obtenus par de
675
fondus et enlevés en même temps sur des fonds gris-bruns, où il semble
que les fleurs et la pâte du fond ont coulé l’un dans l’autre, décor
particulièrement associé au procédé de peinture émaillée qui est sorti
depuis dix ans environ de l’atelier Laurin et que les autres céramistes
s’efforcent de varier et de perfectionner.
Si nous poursuivons l’examen de cet ensemble luisant, doux et écla-
tant de la céramique, nous y verrons que la recherche de la difficulté y
marche parallèlement à la recherche du décor et que l’on s’efforce de
déguiser l’aspect de la matière de toutes façons. Ici la faïence imite la
porcelaine, et là-bas celle-ci lui rend la pareille. Voilà du bronze, du
jade, des pierres dures, des pierres précieuses, de l’ivoire, du verre,
de la laque, du cuivre émaillé, de la corne, du bois, du métal damas-
quiné, des tissus! Vous le jureriez du moins à trois pas. Point du tout,
c’est de la faïence, de la porcelaine dure ou tendre, du grès... Ailleurs,
en revanche, on simulera la faïence avec du bois peint ou du verre.
Peu d’industries font autant de recherches que l’industrie céramique;
il est vrai qu’elle est stimulée par une vogue extraordinaire.
L’emploi très varié de la faïence dans la décoration architecturale,
son apparition en vastes compositions de paysages et de figures, son rôle
dans les chambranles, les linteaux, les archivoltes ouïes frises, dateront
l’Exposition de 1878. 11 y a là un élan, un grand effort, tâtonné durant
les années précédentes et qui aboutit enfin à de très beaux résultats.
Quelques procédés nouveaux se montrent aussi en France et en An-
gleterre. Celui qui a le plus d’importance au point de vue décoratif et
qui est la préoccupation des céramistes, — il suffit pour s’en convaincre
de voir que c’est à peu près la seule chose qui ait intéressé à l’Exposition
la maison Minton et la fabrique de Worcester, —appartient à M. Deck et
consiste dans la création de fonds d’or sous glaçure, cuits avec l’émail,
qui produisent un effet superbe.
Les Wedgwood ont imaginé d’appliquer à l’émail la gravure du
verre à l’acide fluorhydrique, et M. Goods associé aux Minton a gravé
directement des eaux-fortes sur porcelaine.
A côté de ces procédés nouveaux, il en est d’anciens qui de jour en
jour acquièrent plus de vogue. Le procédé des pâtes sur pâtes transpa-
rentes en manière de camée, les ajours rebouchés à l’émail, les terres
incrustées, les cloisons que les céramistes prétendent assimiler aux cloi-
sons des émaux de cuivre, mais qui, en réalité, ne sont qu’une manière
de cerner, avec une pâte de couleur différente, les contours d’un orne-
ment, le procédé Laurin et les pâtes rapportées que préconise la fabrique
Boulenger de Choisy-le-Roi, les jaspures et les craquelés obtenus par de