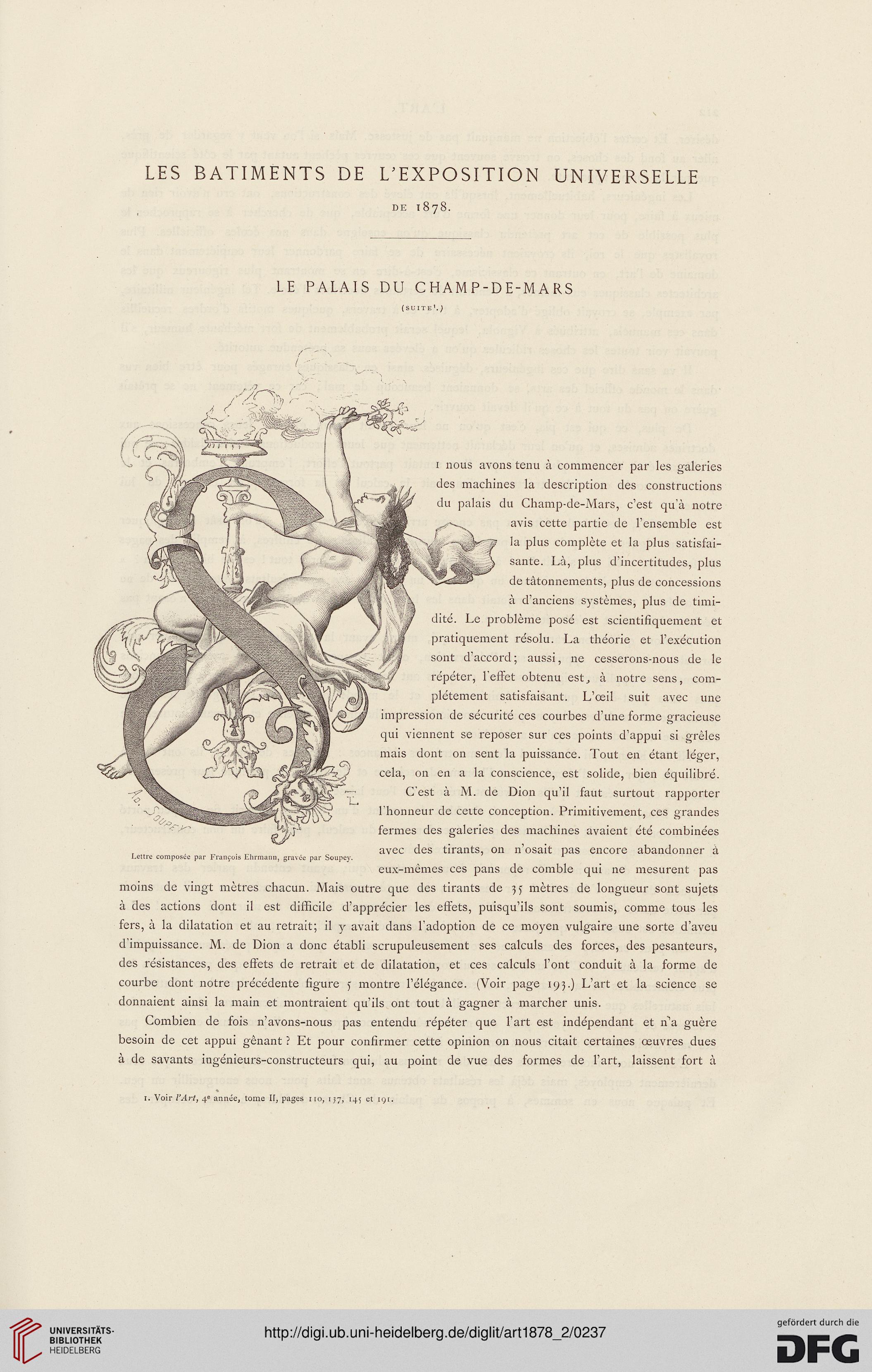LES BATIMENTS DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE
DE 1878.
LE PALAIS DU CHAMP-DE-MARS
(SUITE1.)
f
I
■ (f?â
1 nous avons tenu à commencer par les galeries
des machines la description des constructions
du palais du Champ-de-Mars, c'est qu'à notre
avis cette partie de l'ensemble est
la plus complète et la plus satisfai-
sante. Là, plus d'incertitudes, plus
de tâtonnements, plus de concessions
à d'anciens systèmes, plus de timi-
lité. Le problème posé est scientifiquement et
pratiquement résolu. La théorie et l'exécution
sont d'accord ; aussi, ne cesserons-nous de le
répéter, l'effet obtenu est., à notre sens, com-
plètement satisfaisant. L'œil suit avec une
impression de sécurité ces courbes d'une forme gracieuse
qui viennent se reposer sur ces points d'appui si grêles
mais dont on sent la puissance. Tout en étant léger,
cela, on en a la conscience, est solide, bien équilibré.
C'est à M. de Dion qu'il faut surtout rapporter
l'honneur de celte conception. Primitivement, ces grandes
fermes des galeries des machines avaient été combinées
avec des tirants, on n'osait pas encore abandonner à
Lettre composée par François Ehrmann, gravée par Soupey.
eux-mêmes ces pans de comble qui ne mesurent pas
moins de vingt mètres chacun. Mais outre que des tirants de 35: mètres de longueur sont sujets
à des actions dont il est difficile d'apprécier les effets, puisqu'ils sont soumis, comme tous les
fers, à la dilatation et au retrait; il y avait dans l'adoption de ce moyen vulgaire une sorte d'aveu
d'impuissance. M. de Dion a donc établi scrupuleusement ses calculs des forces, des pesanteurs,
des résistances, des effets de retrait et de dilatation, et ces calculs l'ont conduit à la forme de
courbe dont notre précédente figure f montre l'élégance. (Voir page 193.) L'art et la science se
donnaient ainsi la main et montraient qu'ils ont tout à gagner à marcher unis.
Combien de fois n'avons-nous pas entendu répéter que l'art est indépendant et n*a guère
besoin de cet appui gênant ? Et pour confirmer cette opinion on nous citait certaines œuvres dues
à de savants ingénieurs-constructeurs qui, au point de vue des formes de l'art, laissent fort à
1. Voir l'Art, 4e année, tome U, pages 110, 157, 145 et n;i.
DE 1878.
LE PALAIS DU CHAMP-DE-MARS
(SUITE1.)
f
I
■ (f?â
1 nous avons tenu à commencer par les galeries
des machines la description des constructions
du palais du Champ-de-Mars, c'est qu'à notre
avis cette partie de l'ensemble est
la plus complète et la plus satisfai-
sante. Là, plus d'incertitudes, plus
de tâtonnements, plus de concessions
à d'anciens systèmes, plus de timi-
lité. Le problème posé est scientifiquement et
pratiquement résolu. La théorie et l'exécution
sont d'accord ; aussi, ne cesserons-nous de le
répéter, l'effet obtenu est., à notre sens, com-
plètement satisfaisant. L'œil suit avec une
impression de sécurité ces courbes d'une forme gracieuse
qui viennent se reposer sur ces points d'appui si grêles
mais dont on sent la puissance. Tout en étant léger,
cela, on en a la conscience, est solide, bien équilibré.
C'est à M. de Dion qu'il faut surtout rapporter
l'honneur de celte conception. Primitivement, ces grandes
fermes des galeries des machines avaient été combinées
avec des tirants, on n'osait pas encore abandonner à
Lettre composée par François Ehrmann, gravée par Soupey.
eux-mêmes ces pans de comble qui ne mesurent pas
moins de vingt mètres chacun. Mais outre que des tirants de 35: mètres de longueur sont sujets
à des actions dont il est difficile d'apprécier les effets, puisqu'ils sont soumis, comme tous les
fers, à la dilatation et au retrait; il y avait dans l'adoption de ce moyen vulgaire une sorte d'aveu
d'impuissance. M. de Dion a donc établi scrupuleusement ses calculs des forces, des pesanteurs,
des résistances, des effets de retrait et de dilatation, et ces calculs l'ont conduit à la forme de
courbe dont notre précédente figure f montre l'élégance. (Voir page 193.) L'art et la science se
donnaient ainsi la main et montraient qu'ils ont tout à gagner à marcher unis.
Combien de fois n'avons-nous pas entendu répéter que l'art est indépendant et n*a guère
besoin de cet appui gênant ? Et pour confirmer cette opinion on nous citait certaines œuvres dues
à de savants ingénieurs-constructeurs qui, au point de vue des formes de l'art, laissent fort à
1. Voir l'Art, 4e année, tome U, pages 110, 157, 145 et n;i.