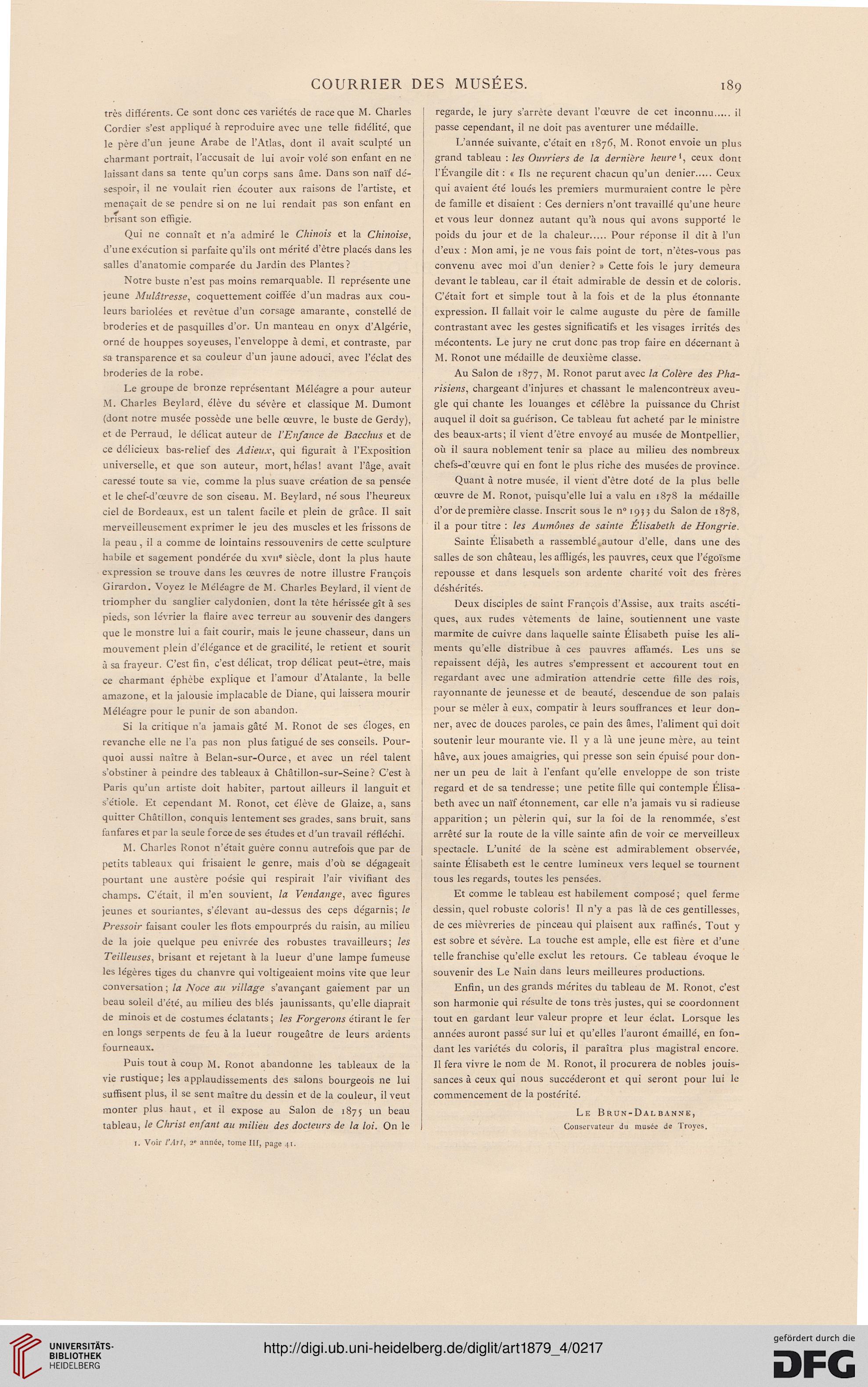COURRIER DES MUSÉES.
189
très différents. Ce sont donc ces variétés de race que M. Charles
Cordier s'est appliqué à reproduire avec une telle fidélité, que
le père d'un jeune Arabe de l'Atlas, dont il avait sculpté un
charmant portrait, l'accusait de lui avoir volé son enfant en ne
laissant dans sa tente qu'un corps sans âme. Dans son naïf dé-
sespoir, il ne voulait rien écouter aux raisons de l'artiste, et
menaçait de se pendre si on ne lui rendait pas son enfant en
brisant son effigie.
Qui ne connaît et n'a admiré le Chinois et la Chinoise,
d'une exécution si parfaite qu'ils ont mérité d'être placés dans les
salles d'anatomie comparée du Jardin des Plantes?
Notre buste n'est pas moins remarquable. Il représente une
jeune Mulâtresse, coquettement coiffée d'un madras aux cou-
leurs bariolées et revêtue d'un corsage amarante, constellé de
broderies et de pasquilles d'or. Un manteau en onyx d'Algérie,
orné de houppes soyeuses, l'enveloppe à demi, et contraste, par
sa transparence et sa couleur d'un jaune adouci, avec l'éclat des
broderies de la robe.
Le groupe de bronze représentant Méléagre a pour auteur
M. Charles Beylard. élève du sévère et classique M. Dumont
(dont notre musée possède une belle œuvre, le buste de Gerdy).
et de Perraud. le délicat auteur de l'Enfance de Bacchus et de
ce délicieux bas-relief des Adieux, qui figurait à l'Exposition
universelle, et que son auteur, mort, hélas! avant l'âge, avait
caressé toute sa vie, comme la plus suave création de sa pensée
et le chef-d'œuvre de son ciseau. M. Beylard, né sous l'heureux
ciel de Bordeaux, est un talent facile et plein de grâce. Il sait
merveilleusement exprimer le jeu des muscles et les frissons de
la peau , il a comme de lointains ressouvenirs de cette sculpture
habile et sagement pondérée du xvn" siècle, dont la plus haute
expression se trouve dans les œuvres de notre illustre François
Girardon. Voyez le Méléagre de M. Charles Beylard, il vient de
triompher du sanglier calydonien. dont la tête hérissée gît à ses
pieds, son lévrier la flaire avec terreur au souvenir des dangers
que le monstre lui a fait courir, mais le jeune chasseur, dans un
mouvement plein d'élégance et de gracilité, le retient et sourit
à sa frayeur. C'est fin, c'est délicat, trop délicat peut-être, mais
ce charmant éphèbe explique et l'amour d'Atalante, la belle
amazone, et la jalousie implacable de Diane, qui laissera mourir
Méléagre pour le punir de son abandon.
Si la critique n'a jamais gâté M. Ronot de ses éloges, en
revanche elle ne l'a pas non plus fatigué de ses conseils. Pour-
quoi aussi naître à Belan-sur-Ource, et avec un réel talent
s'obstiner à peindre des tableaux à Châtillon-sur-Seine ? C'est à
Paris qu'un artiste doit habiter, partout ailleurs il languit et
s'étiole. Et cependant M. Ronot, cet élève de Glaize, a, sans
quitter Châtillon, conquis lentement ses grades, sans bruit, sans
fanfares et par la seule force de ses études et d'un travail réfléchi.
M. Charles Ronot n'était guère connu autrefois que par de
petits tableaux qui frisaient le genre, mais d'où se dégageait
pourtant une austère poésie qui respirait l'air vivifiant des
champs. C'était, il m'en souvient, la Vendange, avec figures
jeunes et souriantes, s'élevant au-dessus des ceps dégarnis; le
Pressoir faisant couler les flots empourprés du raisin, au milieu
de la joie quelque peu enivrée des robustes travailleurs; les
Teilleuses, brisant et rejetant à la lueur d'une lampe fumeuse
les légères tiges du chanvre qui voltigeaient moins vite que leur
conversation ; la Noce au village s'avançant gaiement par un
beau soleil d'été, au milieu des blés jaunissants, qu'elle diaprait
de minois et de costumes éclatants ; les Forgerons étirant le fer
en longs serpents de feu à la lueur rougeâtre de leurs ardents
fourneaux.
Puis tout à coup M. Ronot abandonne les tableaux de la
vie rustique; les applaudissements des salons bourgeois ne lui
suffisent plus, il se sent maître du dessin et de la couleur, il veut
monter plus haut, et il expose au Salon de 1875 un beau
lableau, le Christ enfant au milieu des docteurs de la loi. On le
1. Voir l'Art, 2' année, tome Ilf, page 41.
regarde, le jury s'arrête devant l'œuvre de cet inconnu..... il
passe cependant, il ne doit pas aventurer une médaille.
L'année suivante, c'était en 1876, M. Ronot envoie un plus
grand tableau : les Ouvriers de la dernière heure1, ceux dont
l'Evangile dit : « Ils ne reçurent chacun qu'un denier..... Ceux
qui avaient été loués les premiers murmuraient contre le père
de famille et disaient : Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure
et vous leur donnez autant qu'à nous qui avons supporté le
poids du jour et de la chaleur..... Pour réponse il dit à l'un
d'eux : Mon ami, je ne vous fais point de tort, n'ètes-vous pas
convenu avec moi d'un denier? » Cette fois le jury demeura
devant le tableau, car il était admirable de dessin et de coloris.
C'était fort et simple tout à la fois et de la plus étonnante
expression. Il fallait voir le calme auguste du père de famille
contrastant avec les gestes significatifs et les visages irrités des
mécontents. Le jury ne crut donc pas trop faire en décernant à
M. Ronot une médaille de deuxième classe.
Au Salon de 1877, M. Ronot parut avec la Colère des Pha-
risiens, chargeant d'injures et chassant le malencontreux aveu-
gle qui chante les louanges et célèbre la puissance du Christ
auquel il doit sa guérison. Ce tableau fut acheté par le ministre
des beaux-arts; il vient d'être envoyé au musée de Montpellier,
où il saura noblement tenir sa place au milieu des nombreux
chefs-d'œuvre qui en font le plus riche des musées de province.
Quant à notre musée, il vient d'être doté de la plus belle
œuvre de M. Ronot, puisqu'elle lui a valu en 1878 la médaille
d'or de première classe. Inscrit sous le ^1953 du Salon de 1878,
il a pour titre : les Aumônes de sainte Élisabeth de Hongrie.
Sainte Elisabeth a rassemblé vautour d'elle, dans une des
salles de son château, les affligés, les pauvres, ceux que l'égoïsme
repousse et dans lesquels son ardente charité voit des frères
déshérités.
Deux disciples de saint François d'Assise, aux traits ascéti-
ques, aux rudes vêtements de laine, soutiennent une vaste
marmite de cuivre dans laquelle sainte Élisabeth puise les ali-
j ments qu'elle distribue à ces pauvres affamés. Les uns se
repaissent déjà, les autres s'empressent et accourent tout en
regardant avec une admiration attendrie cette fille des rois,
rayonnante de jeunesse et de beauté, descendue de son palais
pour se mêler à eux, compatir à leurs souffrances et leur don-
ner, avec de douces paroles, ce pain des âmes, l'aliment qui doit
i soutenir leur mourante vie. Il y a là une jeune mère, au teint
hâve, aux joues amaigries, qui presse son sein épuisé pour don-
ner un peu de lait à l'enfant qu'elle enveloppe de son triste
regard et de sa tendresse; une petite fille qui contemple Elisa-
beth avec un naïf étonnement, car elle n'a jamais vu si radieuse
apparition ; un pèlerin qui, sur la foi de la renommée, s'est
arrêté sur la route de la ville sainte afin de voir ce merveilleux
spectacle. L'unité de la scène est admirablement observée,
sainte Elisabeth est le centre lumineux vers lequel se tournent
tous les regards, toutes les pensées.
Et comme le tableau est habilement composé; quel ferme
dessin, quel robuste coloris! Il n'y a pas là de ces gentillesses,
de ces mièvreries de pinceau qui plaisent aux raffinés. Tout y
est sobre et sévère. La touche est ample, elle est fière et d'une
telle franchise qu'elle exclut les retours. Ce tableau évoque le
souvenir des Le Nain dans leurs meilleures productions.
Enfin, un des grands mérites du tableau de M. Ronot, c'est
son harmonie qui résulte de tons très justes, qui se coordonnent
tout en gardant leur valeur propre et leur éclat. Lorsque les
années auront passé sur lui et qu'elles l'auront émaillé, en fon-
dant les variétés du coloris, il paraîtra plus magistral encore.
Il fera vivre le nom de M. Ronot, il procurera de nobles jouis-
sances à ceux qui nous succéderont et qui seront pour lui le
commencement de la postérité.
Le Brun-Dalbanne,
Conservateur du musée de Troyes.
189
très différents. Ce sont donc ces variétés de race que M. Charles
Cordier s'est appliqué à reproduire avec une telle fidélité, que
le père d'un jeune Arabe de l'Atlas, dont il avait sculpté un
charmant portrait, l'accusait de lui avoir volé son enfant en ne
laissant dans sa tente qu'un corps sans âme. Dans son naïf dé-
sespoir, il ne voulait rien écouter aux raisons de l'artiste, et
menaçait de se pendre si on ne lui rendait pas son enfant en
brisant son effigie.
Qui ne connaît et n'a admiré le Chinois et la Chinoise,
d'une exécution si parfaite qu'ils ont mérité d'être placés dans les
salles d'anatomie comparée du Jardin des Plantes?
Notre buste n'est pas moins remarquable. Il représente une
jeune Mulâtresse, coquettement coiffée d'un madras aux cou-
leurs bariolées et revêtue d'un corsage amarante, constellé de
broderies et de pasquilles d'or. Un manteau en onyx d'Algérie,
orné de houppes soyeuses, l'enveloppe à demi, et contraste, par
sa transparence et sa couleur d'un jaune adouci, avec l'éclat des
broderies de la robe.
Le groupe de bronze représentant Méléagre a pour auteur
M. Charles Beylard. élève du sévère et classique M. Dumont
(dont notre musée possède une belle œuvre, le buste de Gerdy).
et de Perraud. le délicat auteur de l'Enfance de Bacchus et de
ce délicieux bas-relief des Adieux, qui figurait à l'Exposition
universelle, et que son auteur, mort, hélas! avant l'âge, avait
caressé toute sa vie, comme la plus suave création de sa pensée
et le chef-d'œuvre de son ciseau. M. Beylard, né sous l'heureux
ciel de Bordeaux, est un talent facile et plein de grâce. Il sait
merveilleusement exprimer le jeu des muscles et les frissons de
la peau , il a comme de lointains ressouvenirs de cette sculpture
habile et sagement pondérée du xvn" siècle, dont la plus haute
expression se trouve dans les œuvres de notre illustre François
Girardon. Voyez le Méléagre de M. Charles Beylard, il vient de
triompher du sanglier calydonien. dont la tête hérissée gît à ses
pieds, son lévrier la flaire avec terreur au souvenir des dangers
que le monstre lui a fait courir, mais le jeune chasseur, dans un
mouvement plein d'élégance et de gracilité, le retient et sourit
à sa frayeur. C'est fin, c'est délicat, trop délicat peut-être, mais
ce charmant éphèbe explique et l'amour d'Atalante, la belle
amazone, et la jalousie implacable de Diane, qui laissera mourir
Méléagre pour le punir de son abandon.
Si la critique n'a jamais gâté M. Ronot de ses éloges, en
revanche elle ne l'a pas non plus fatigué de ses conseils. Pour-
quoi aussi naître à Belan-sur-Ource, et avec un réel talent
s'obstiner à peindre des tableaux à Châtillon-sur-Seine ? C'est à
Paris qu'un artiste doit habiter, partout ailleurs il languit et
s'étiole. Et cependant M. Ronot, cet élève de Glaize, a, sans
quitter Châtillon, conquis lentement ses grades, sans bruit, sans
fanfares et par la seule force de ses études et d'un travail réfléchi.
M. Charles Ronot n'était guère connu autrefois que par de
petits tableaux qui frisaient le genre, mais d'où se dégageait
pourtant une austère poésie qui respirait l'air vivifiant des
champs. C'était, il m'en souvient, la Vendange, avec figures
jeunes et souriantes, s'élevant au-dessus des ceps dégarnis; le
Pressoir faisant couler les flots empourprés du raisin, au milieu
de la joie quelque peu enivrée des robustes travailleurs; les
Teilleuses, brisant et rejetant à la lueur d'une lampe fumeuse
les légères tiges du chanvre qui voltigeaient moins vite que leur
conversation ; la Noce au village s'avançant gaiement par un
beau soleil d'été, au milieu des blés jaunissants, qu'elle diaprait
de minois et de costumes éclatants ; les Forgerons étirant le fer
en longs serpents de feu à la lueur rougeâtre de leurs ardents
fourneaux.
Puis tout à coup M. Ronot abandonne les tableaux de la
vie rustique; les applaudissements des salons bourgeois ne lui
suffisent plus, il se sent maître du dessin et de la couleur, il veut
monter plus haut, et il expose au Salon de 1875 un beau
lableau, le Christ enfant au milieu des docteurs de la loi. On le
1. Voir l'Art, 2' année, tome Ilf, page 41.
regarde, le jury s'arrête devant l'œuvre de cet inconnu..... il
passe cependant, il ne doit pas aventurer une médaille.
L'année suivante, c'était en 1876, M. Ronot envoie un plus
grand tableau : les Ouvriers de la dernière heure1, ceux dont
l'Evangile dit : « Ils ne reçurent chacun qu'un denier..... Ceux
qui avaient été loués les premiers murmuraient contre le père
de famille et disaient : Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure
et vous leur donnez autant qu'à nous qui avons supporté le
poids du jour et de la chaleur..... Pour réponse il dit à l'un
d'eux : Mon ami, je ne vous fais point de tort, n'ètes-vous pas
convenu avec moi d'un denier? » Cette fois le jury demeura
devant le tableau, car il était admirable de dessin et de coloris.
C'était fort et simple tout à la fois et de la plus étonnante
expression. Il fallait voir le calme auguste du père de famille
contrastant avec les gestes significatifs et les visages irrités des
mécontents. Le jury ne crut donc pas trop faire en décernant à
M. Ronot une médaille de deuxième classe.
Au Salon de 1877, M. Ronot parut avec la Colère des Pha-
risiens, chargeant d'injures et chassant le malencontreux aveu-
gle qui chante les louanges et célèbre la puissance du Christ
auquel il doit sa guérison. Ce tableau fut acheté par le ministre
des beaux-arts; il vient d'être envoyé au musée de Montpellier,
où il saura noblement tenir sa place au milieu des nombreux
chefs-d'œuvre qui en font le plus riche des musées de province.
Quant à notre musée, il vient d'être doté de la plus belle
œuvre de M. Ronot, puisqu'elle lui a valu en 1878 la médaille
d'or de première classe. Inscrit sous le ^1953 du Salon de 1878,
il a pour titre : les Aumônes de sainte Élisabeth de Hongrie.
Sainte Elisabeth a rassemblé vautour d'elle, dans une des
salles de son château, les affligés, les pauvres, ceux que l'égoïsme
repousse et dans lesquels son ardente charité voit des frères
déshérités.
Deux disciples de saint François d'Assise, aux traits ascéti-
ques, aux rudes vêtements de laine, soutiennent une vaste
marmite de cuivre dans laquelle sainte Élisabeth puise les ali-
j ments qu'elle distribue à ces pauvres affamés. Les uns se
repaissent déjà, les autres s'empressent et accourent tout en
regardant avec une admiration attendrie cette fille des rois,
rayonnante de jeunesse et de beauté, descendue de son palais
pour se mêler à eux, compatir à leurs souffrances et leur don-
ner, avec de douces paroles, ce pain des âmes, l'aliment qui doit
i soutenir leur mourante vie. Il y a là une jeune mère, au teint
hâve, aux joues amaigries, qui presse son sein épuisé pour don-
ner un peu de lait à l'enfant qu'elle enveloppe de son triste
regard et de sa tendresse; une petite fille qui contemple Elisa-
beth avec un naïf étonnement, car elle n'a jamais vu si radieuse
apparition ; un pèlerin qui, sur la foi de la renommée, s'est
arrêté sur la route de la ville sainte afin de voir ce merveilleux
spectacle. L'unité de la scène est admirablement observée,
sainte Elisabeth est le centre lumineux vers lequel se tournent
tous les regards, toutes les pensées.
Et comme le tableau est habilement composé; quel ferme
dessin, quel robuste coloris! Il n'y a pas là de ces gentillesses,
de ces mièvreries de pinceau qui plaisent aux raffinés. Tout y
est sobre et sévère. La touche est ample, elle est fière et d'une
telle franchise qu'elle exclut les retours. Ce tableau évoque le
souvenir des Le Nain dans leurs meilleures productions.
Enfin, un des grands mérites du tableau de M. Ronot, c'est
son harmonie qui résulte de tons très justes, qui se coordonnent
tout en gardant leur valeur propre et leur éclat. Lorsque les
années auront passé sur lui et qu'elles l'auront émaillé, en fon-
dant les variétés du coloris, il paraîtra plus magistral encore.
Il fera vivre le nom de M. Ronot, il procurera de nobles jouis-
sances à ceux qui nous succéderont et qui seront pour lui le
commencement de la postérité.
Le Brun-Dalbanne,
Conservateur du musée de Troyes.