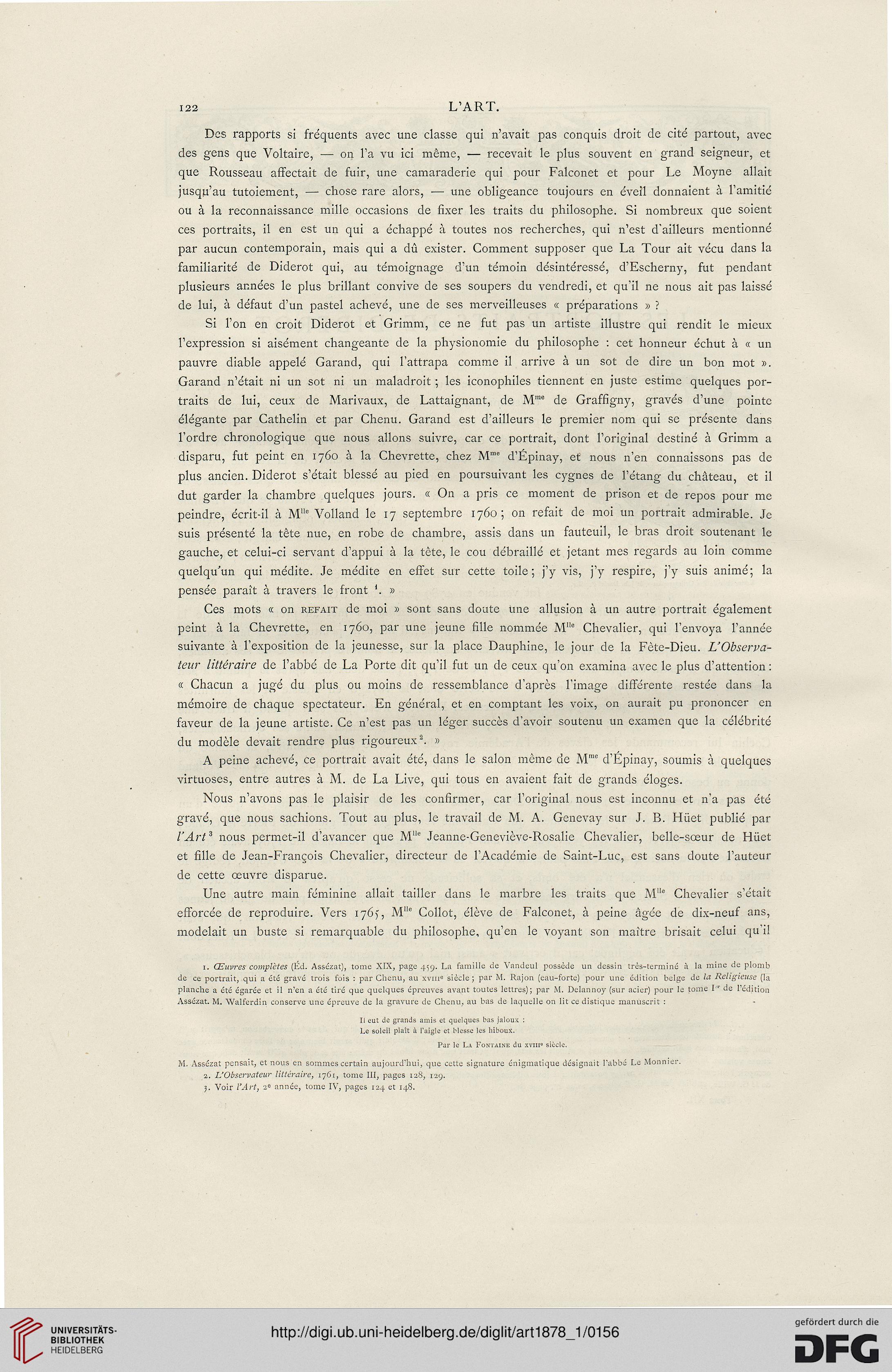122
L'ART.
Des rapports si fréquents avec une classe qui n'avait pas conquis droit de cité partout, avec
des gens que Voltaire, ■— on Fa vu ici même, — recevait le plus souvent en grand seigneur, et
que Rousseau affectait de fuir, une camaraderie qui pour Falconet et pour Le Moyne allait
jusqu'au tutoiement, — chose rare alors, — une obligeance toujours en éveil donnaient à l'amitié
ou à la reconnaissance mille occasions de fixer les traits du philosophe. Si nombreux que soient
ces portraits, il en est un qui a échappé à toutes nos recherches, qui n'est d'ailleurs mentionné
par aucun contemporain, mais qui a dû exister. Comment supposer que La Tour ait vécu dans la
familiarité de Diderot qui, au témoignage d'un témoin désintéressé, d'Escherny, fut pendant
plusieurs années le plus brillant convive de ses soupers du vendredi, et qu'il ne nous ait pas laissé
de lui, à défaut d'un pastel achevé, une de ses merveilleuses ce préparations » ?
Si l'on en croit Diderot et Grimm, ce ne fut pas un artiste illustre qui rendit le mieux
l'expression si aisément changeante de la physionomie du philosophe : cet honneur échut à « un
pauvre diable appelé Garand, qui l'attrapa comme il arrive à un sot de dire un bon mot ».
Garand n'était ni un sot ni un maladroit ; les iconophiles tiennent en juste estime quelques por-
traits de lui, ceux de Marivaux, de Lattaignant, de Mme de Graffigny, gravés d'une pointe
élégante par Cathelin et par Chenu. Garand est d'ailleurs le premier nom qui se présente dans
l'ordre chronologique que nous allons suivre, car ce portrait, dont l'original destiné à Grimm a
disparu, fut peint en 1760 à la Chevrette, chez Mmc d'Épinay, et nous n'en connaissons pas de
plus ancien. Diderot s'était blessé au pied en poursuivant les cygnes de l'étang du château, et il
dut garder la chambre quelques jours, « On a pris ce moment de prison et de repos pour me
peindre, écrit-il à MUo Volland le 17 septembre 1760; on refait de moi un portrait admirable. Je
suis présenté la tête nue, en robe de chambre, assis dans un fauteuil, le bras droit soutenant le
gauche, et celui-ci servant d'appui à la tête, le cou débraillé et jetant mes regards au loin comme
quelqu'un qui médite. Je médite en effet sur cette toile; j'y vis, j'y respire, j'y suis animé; la
pensée paraît à travers le front f. »
Ces mots « on refait de moi » sont sans doute une allusion à un autre portrait également
peint à la Chevrette, en 1760, par une jeune fille nommée M"° Chevalier, qui l'envoya l'année
suivante à l'exposition de la jeunesse, sur la place Dauphine, le jour de la Fête-Dieu. L'Observa-
teur littéraire de l'abbé de La Porte dit qu'il fut un de ceux qu'on examina avec le plus d'attention :
« Chacun a jugé du plus ou moins de ressemblance d'après l'image différente restée dans la
mémoire de chaque spectateur. En général, et en comptant les voix, on aurait pu prononcer en
faveur de la jeune artiste. Ce n'est pas un léger succès d'avoir soutenu un examen que la célébrité
du modèle devait rendre plus rigoureux2. »
A peine achevé, ce portrait avait été, dans le salon même de Mrac d'Épinay, soumis à quelques
virtuoses, entre autres à M. de La Live, qui tous en avaient fait de grands éloges.
Nous n'avons pas le plaisir de les confirmer, car l'original nous est inconnu et n'a pas été
gravé, que nous sachions. Tout au plus, le travail de M. A. Genevay sur J. B. Hûet publié par
l'Art3 nous permet-il d'avancer que M"c Jeanne-Geneviève-Rosalie Chevalier, belle-sœur de Hùet
et fille de Jean-François Chevalier, directeur de l'Académie de Saint-Luc, est sans cloute l'auteur
de cette œuvre disparue.
Une autre main féminine allait tailler dans le marbre les traits que M"e Chevalier s'était
efforcée de reproduire. Vers 176)', Mlle Collot, élève de Falconet, à peine âgée de dix-neuf ans,
modelait un buste si remarquable du philosophe, qu'en le voyant son maître brisait celui qu'il
l. Œuvres complètes (Éd. Assézat), tome XIX, page 459. La famille de Vandeul possède un dessin très-terminé à la mine de plomb
de ce portrait, qui a été gravé trois fois : par Chenu, au xviiie siècle; par M. Rajon (eau-forte) pour une édition belge de la Religieuse (la
planche a été égarée et il n'en a été tiré que quelques épreuves avant toutes lettres); par M. Delannoy (sur acier) pour le tome I™ de l'édition
Assézat. M. Walferdin conserve une épreuve de la gravure de Chenu, au bas de laquelle on lit ce distique manuscrit :
Il eut de grands amis et quelques bas jaloux :
Le soleil plaît à l'aigle et blesse les hiboux.
Par le La Fontaine du xvm0 siècle.
M. Assézat pensait, et nous en sommes certain aujourd'hui, que cette signature énigmatique désignait l'abbé Le Monnier.
■1. L'Observateur littéraire, 1761, tome III, pages 128, 129.
j. Voir l'Art, 20 année, tome IV, pages 124 et 148.
L'ART.
Des rapports si fréquents avec une classe qui n'avait pas conquis droit de cité partout, avec
des gens que Voltaire, ■— on Fa vu ici même, — recevait le plus souvent en grand seigneur, et
que Rousseau affectait de fuir, une camaraderie qui pour Falconet et pour Le Moyne allait
jusqu'au tutoiement, — chose rare alors, — une obligeance toujours en éveil donnaient à l'amitié
ou à la reconnaissance mille occasions de fixer les traits du philosophe. Si nombreux que soient
ces portraits, il en est un qui a échappé à toutes nos recherches, qui n'est d'ailleurs mentionné
par aucun contemporain, mais qui a dû exister. Comment supposer que La Tour ait vécu dans la
familiarité de Diderot qui, au témoignage d'un témoin désintéressé, d'Escherny, fut pendant
plusieurs années le plus brillant convive de ses soupers du vendredi, et qu'il ne nous ait pas laissé
de lui, à défaut d'un pastel achevé, une de ses merveilleuses ce préparations » ?
Si l'on en croit Diderot et Grimm, ce ne fut pas un artiste illustre qui rendit le mieux
l'expression si aisément changeante de la physionomie du philosophe : cet honneur échut à « un
pauvre diable appelé Garand, qui l'attrapa comme il arrive à un sot de dire un bon mot ».
Garand n'était ni un sot ni un maladroit ; les iconophiles tiennent en juste estime quelques por-
traits de lui, ceux de Marivaux, de Lattaignant, de Mme de Graffigny, gravés d'une pointe
élégante par Cathelin et par Chenu. Garand est d'ailleurs le premier nom qui se présente dans
l'ordre chronologique que nous allons suivre, car ce portrait, dont l'original destiné à Grimm a
disparu, fut peint en 1760 à la Chevrette, chez Mmc d'Épinay, et nous n'en connaissons pas de
plus ancien. Diderot s'était blessé au pied en poursuivant les cygnes de l'étang du château, et il
dut garder la chambre quelques jours, « On a pris ce moment de prison et de repos pour me
peindre, écrit-il à MUo Volland le 17 septembre 1760; on refait de moi un portrait admirable. Je
suis présenté la tête nue, en robe de chambre, assis dans un fauteuil, le bras droit soutenant le
gauche, et celui-ci servant d'appui à la tête, le cou débraillé et jetant mes regards au loin comme
quelqu'un qui médite. Je médite en effet sur cette toile; j'y vis, j'y respire, j'y suis animé; la
pensée paraît à travers le front f. »
Ces mots « on refait de moi » sont sans doute une allusion à un autre portrait également
peint à la Chevrette, en 1760, par une jeune fille nommée M"° Chevalier, qui l'envoya l'année
suivante à l'exposition de la jeunesse, sur la place Dauphine, le jour de la Fête-Dieu. L'Observa-
teur littéraire de l'abbé de La Porte dit qu'il fut un de ceux qu'on examina avec le plus d'attention :
« Chacun a jugé du plus ou moins de ressemblance d'après l'image différente restée dans la
mémoire de chaque spectateur. En général, et en comptant les voix, on aurait pu prononcer en
faveur de la jeune artiste. Ce n'est pas un léger succès d'avoir soutenu un examen que la célébrité
du modèle devait rendre plus rigoureux2. »
A peine achevé, ce portrait avait été, dans le salon même de Mrac d'Épinay, soumis à quelques
virtuoses, entre autres à M. de La Live, qui tous en avaient fait de grands éloges.
Nous n'avons pas le plaisir de les confirmer, car l'original nous est inconnu et n'a pas été
gravé, que nous sachions. Tout au plus, le travail de M. A. Genevay sur J. B. Hûet publié par
l'Art3 nous permet-il d'avancer que M"c Jeanne-Geneviève-Rosalie Chevalier, belle-sœur de Hùet
et fille de Jean-François Chevalier, directeur de l'Académie de Saint-Luc, est sans cloute l'auteur
de cette œuvre disparue.
Une autre main féminine allait tailler dans le marbre les traits que M"e Chevalier s'était
efforcée de reproduire. Vers 176)', Mlle Collot, élève de Falconet, à peine âgée de dix-neuf ans,
modelait un buste si remarquable du philosophe, qu'en le voyant son maître brisait celui qu'il
l. Œuvres complètes (Éd. Assézat), tome XIX, page 459. La famille de Vandeul possède un dessin très-terminé à la mine de plomb
de ce portrait, qui a été gravé trois fois : par Chenu, au xviiie siècle; par M. Rajon (eau-forte) pour une édition belge de la Religieuse (la
planche a été égarée et il n'en a été tiré que quelques épreuves avant toutes lettres); par M. Delannoy (sur acier) pour le tome I™ de l'édition
Assézat. M. Walferdin conserve une épreuve de la gravure de Chenu, au bas de laquelle on lit ce distique manuscrit :
Il eut de grands amis et quelques bas jaloux :
Le soleil plaît à l'aigle et blesse les hiboux.
Par le La Fontaine du xvm0 siècle.
M. Assézat pensait, et nous en sommes certain aujourd'hui, que cette signature énigmatique désignait l'abbé Le Monnier.
■1. L'Observateur littéraire, 1761, tome III, pages 128, 129.
j. Voir l'Art, 20 année, tome IV, pages 124 et 148.