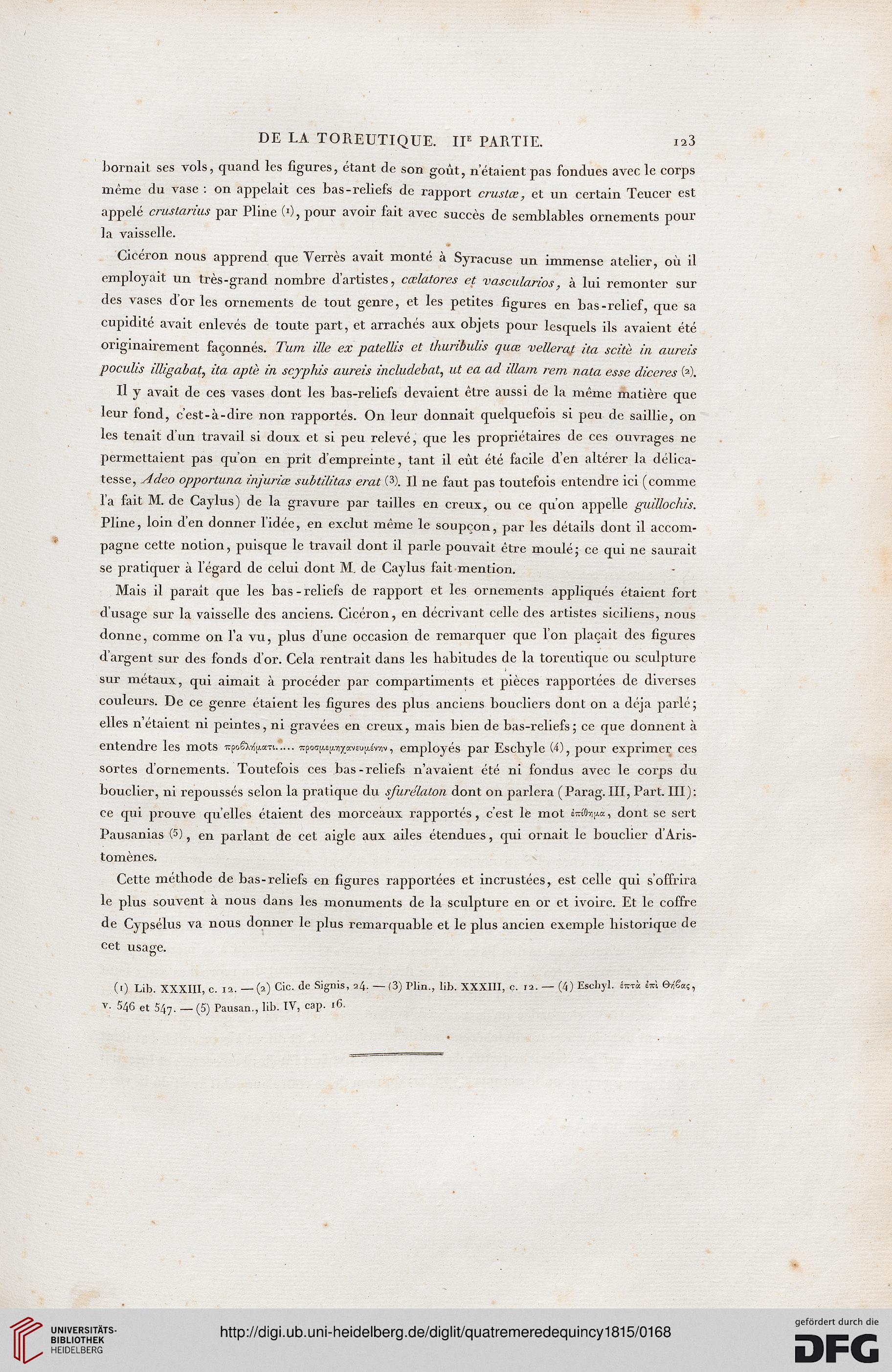DE LA TOREUTIQUE. IP PARTIE. ii3
bornait ses vols, quand les figures, étant de son goût, netaient pas fondues avec le corps
même du vase : on appelait ces bas-reliefs de rapport crustœ, et un certain Teucer est
appelé cruslarius par Pline W, pour avoir fait avec succès de semblables ornements pour
la vaisselle.
Cicéron nous apprend que Verres avait monté à Syracuse un immense atelier, où il
employait un très-grand nombre d'artistes, cœlatores et vascularios, à lui remonter sur
des vases d'or les ornements de tout genre, et les petites figures en bas-relief, que sa
cupidité avait enlevés de toute part, et arrachés aux objets pour lesquels ils avaient été
originairement façonnés. Tum Me ex patellis et thuribulis quœ velleraf ita scitè in aureis
poculis illigabat, ita apte in scyphis aureis includebat, ut ea ad illam rem nata esse diccres (2).
Il y avait de ces vases dont les bas-reliefs devaient être aussi de la même matière que
leur fond, c'est-à-dire non rapportés. On leur donnait quelquefois si peu de saillie, on
les tenait d'un travail si doux et si peu relevé, que les propriétaires de ces ouvrages ne
permettaient pas qu'on en prît d'empreinte, tant il eût été facile d'en altérer la délica-
tesse, Adeo opportuna injuriœ subtilitas erat (3). Il ne faut pas toutefois entendre ici (comme
l'a fait M. de Caylus) de la gravure par tailles en creux, ou ce qu'on appelle guilhchis.
Pline, loin d'en donner l'idée, en exclut même le soupçon, par les détails dont il accom-
pagne cette notion, puisque le travail dont il parle pouvait être moulé; ce qui ne saurait
se pratiquer à l'égard de celui dont M. de Caylus fait mention.
Mais il parait que les bas-reliefs de rapport et les ornements appliqués étaient fort
d'usage sur la vaisselle des anciens. Cicéron, en décrivant celle des artistes siciliens, nous
donne, comme on la vu, plus d'une occasion de remarquer que l'on plaçait des figures
d'argent sur des fonds d'or. Cela rentrait dans les habitudes de la toreutique ou sculpture
sur métaux, qui aimait à procéder par compartiments et pièces rapportées de diverses
couleurs. De ce genre étaient les figures des plus anciens boucliers dont on a déjà parlé;
elles n'étaient ni peintes, ni gravées en creux, mais bien de bas-reliefs; ce que donnent à
entendre les mots xpoêXvi'aaTt.....^^{j^ym^é^, employés par Eschyle (4), pour exprimer ces
sortes d'ornements. Toutefois ces bas-reliefs n'avaient été ni fondus avec le corps du
bouclier, ni repoussés selon la pratique du sfurélaton dont on parlera (Parag. III, Part. III):
ce qui prouve qu'elles étaient des morceaux rapportés, c'est le mot im^à, dont se sert
Pausanias (5), en parlant de cet aigle aux ailes étendues, qui ornait le bouclier d'Aris-
tomènes.
Cette méthode de bas-reliefs en figures rapportées et incrustées, est celle qui s'offrira
le plus souvent à nous dans les monuments de la sculpture en or et ivoire. Et le coffre
de Cypsélus va nous donner le plus remarquable et le plus ancien exemple historique de
cet usage.
(0 Lib. XXXIII, c. 12. — (2) Cic. de Signis, 24. — (3) Plin., lib. XXXIII, c. 12. — (4) Eschyl. inrk i*\ 6tfg*ç,
v- 546 et 547. — (5) Pausan., lib. IV, cap. 16.
bornait ses vols, quand les figures, étant de son goût, netaient pas fondues avec le corps
même du vase : on appelait ces bas-reliefs de rapport crustœ, et un certain Teucer est
appelé cruslarius par Pline W, pour avoir fait avec succès de semblables ornements pour
la vaisselle.
Cicéron nous apprend que Verres avait monté à Syracuse un immense atelier, où il
employait un très-grand nombre d'artistes, cœlatores et vascularios, à lui remonter sur
des vases d'or les ornements de tout genre, et les petites figures en bas-relief, que sa
cupidité avait enlevés de toute part, et arrachés aux objets pour lesquels ils avaient été
originairement façonnés. Tum Me ex patellis et thuribulis quœ velleraf ita scitè in aureis
poculis illigabat, ita apte in scyphis aureis includebat, ut ea ad illam rem nata esse diccres (2).
Il y avait de ces vases dont les bas-reliefs devaient être aussi de la même matière que
leur fond, c'est-à-dire non rapportés. On leur donnait quelquefois si peu de saillie, on
les tenait d'un travail si doux et si peu relevé, que les propriétaires de ces ouvrages ne
permettaient pas qu'on en prît d'empreinte, tant il eût été facile d'en altérer la délica-
tesse, Adeo opportuna injuriœ subtilitas erat (3). Il ne faut pas toutefois entendre ici (comme
l'a fait M. de Caylus) de la gravure par tailles en creux, ou ce qu'on appelle guilhchis.
Pline, loin d'en donner l'idée, en exclut même le soupçon, par les détails dont il accom-
pagne cette notion, puisque le travail dont il parle pouvait être moulé; ce qui ne saurait
se pratiquer à l'égard de celui dont M. de Caylus fait mention.
Mais il parait que les bas-reliefs de rapport et les ornements appliqués étaient fort
d'usage sur la vaisselle des anciens. Cicéron, en décrivant celle des artistes siciliens, nous
donne, comme on la vu, plus d'une occasion de remarquer que l'on plaçait des figures
d'argent sur des fonds d'or. Cela rentrait dans les habitudes de la toreutique ou sculpture
sur métaux, qui aimait à procéder par compartiments et pièces rapportées de diverses
couleurs. De ce genre étaient les figures des plus anciens boucliers dont on a déjà parlé;
elles n'étaient ni peintes, ni gravées en creux, mais bien de bas-reliefs; ce que donnent à
entendre les mots xpoêXvi'aaTt.....^^{j^ym^é^, employés par Eschyle (4), pour exprimer ces
sortes d'ornements. Toutefois ces bas-reliefs n'avaient été ni fondus avec le corps du
bouclier, ni repoussés selon la pratique du sfurélaton dont on parlera (Parag. III, Part. III):
ce qui prouve qu'elles étaient des morceaux rapportés, c'est le mot im^à, dont se sert
Pausanias (5), en parlant de cet aigle aux ailes étendues, qui ornait le bouclier d'Aris-
tomènes.
Cette méthode de bas-reliefs en figures rapportées et incrustées, est celle qui s'offrira
le plus souvent à nous dans les monuments de la sculpture en or et ivoire. Et le coffre
de Cypsélus va nous donner le plus remarquable et le plus ancien exemple historique de
cet usage.
(0 Lib. XXXIII, c. 12. — (2) Cic. de Signis, 24. — (3) Plin., lib. XXXIII, c. 12. — (4) Eschyl. inrk i*\ 6tfg*ç,
v- 546 et 547. — (5) Pausan., lib. IV, cap. 16.