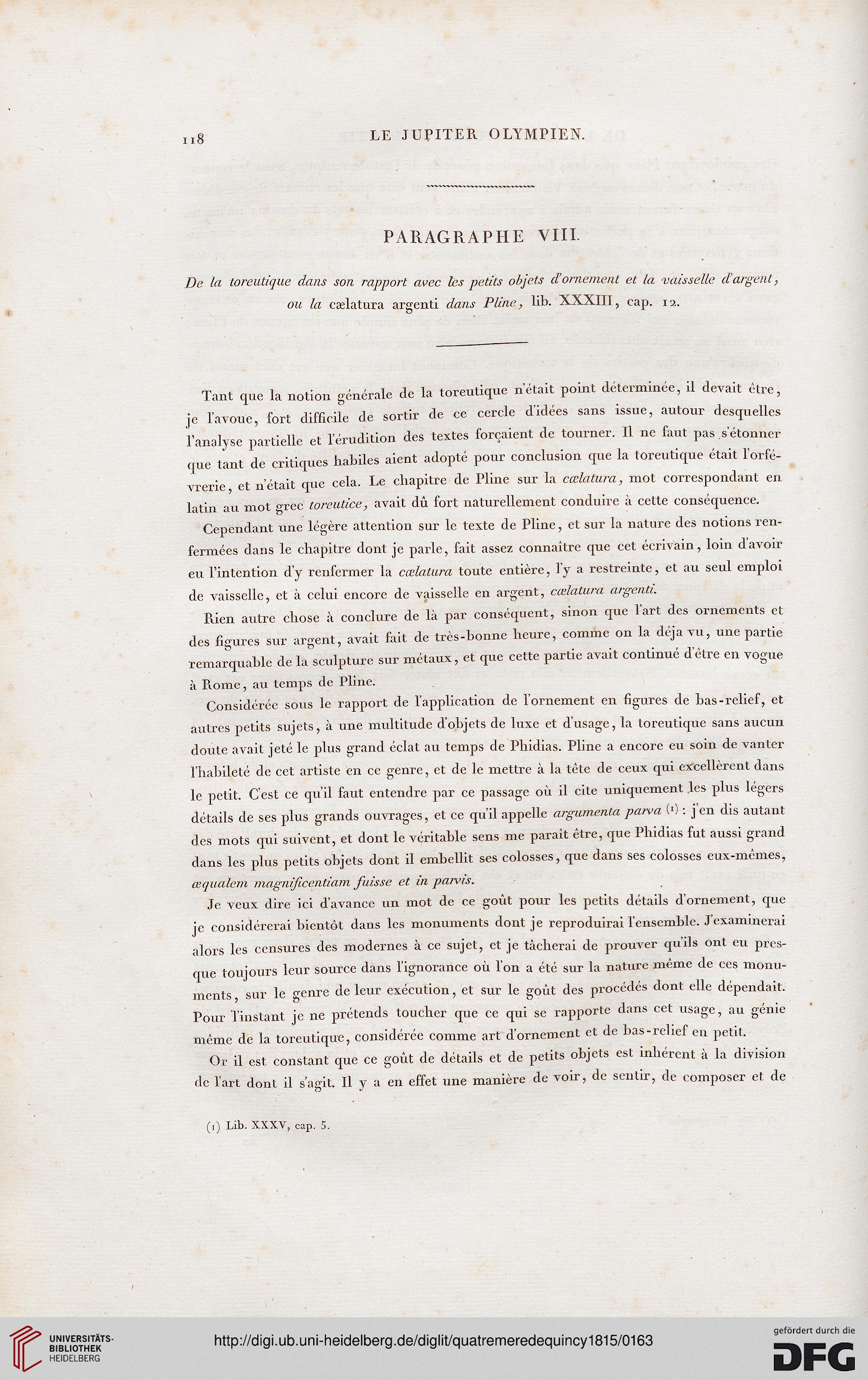n8 LE JUPITER OLYMPIEN.
PARAGRAPHE VIII.
De la toreutique dans son rapport avec les petits objets d'ornement et la vaisselle d'argent,
ou la cœlatura argenti dans Pline, lib. XXXIII, cap. 12.
Tant que la notion générale de la toreutique n'était point déterminée, il devait être,
je l'avoue, fort difficile de sortir de ce cercle d'idées sans issue, autour desquelles
l'analyse partielle et l'érudition des textes forçaient de tourner. Il ne faut pas s'étonner
que tant de critiques habiles aient adopté pour conclusion que la toreutique était l'orfè-
vrerie, et n'était que cela. Le chapitre de Pline sur la cœlatura, mot correspondant en
latin au mot grec toreutice, avait dû fort naturellement conduire à cette conséquence.
Cependant une légère attention sur le texte de Pline, et sur la nature des notions ren-
fermées dans le chapitre dont je parle, fait assez connaître que cet écrivain, loin d'avoir
eu l'intention d'y renfermer la cœlatura toute entière, l'y a restreinte, et au seul emploi
de vaisselle, et à celui encore de vaisselle en argent, cœlatura argenti.
Rien autre chose à conclure de là par conséquent, sinon que l'art des ornements et
des figures sur argent, avait fait de très-bonne heure, comme on la déjà vu, une partie
remarquable de la sculpture sur métaux, et que cette partie avait continué d'être en vogue
à Piome, au temps de Pline.
Considérée sous le rapport de l'application de l'ornement en figures de bas-relief, et
autres petits sujets, à une multitude d'objets de luxe et d'usage, la toreutique sans aucun
doute avait jeté le plus grand éclat au temps de Phidias. Pline a encore eu soin de vanter
l'habileté de cet artiste en ce genre, et de le mettre à la tête de ceux qui excellèrent dans
le petit. C'est ce qu'il faut entendre par ce passage où il cite uniquement les plus légers
détails de ses plus grands ouvrages, et ce qu'il appelle argumenta parva (0 : j'en dis autant
des mots qui suivent, et dont le véritable sens me paraît être, que Phidias fut aussi grand
dans les plus petits objets dont il embellit ses colosses, que dans ses colosses eux-mêmes,
œqualem magnificentiam fuisse et in parvis.
Je veux dire ici d'avance un mot de ce goût pour les petits détails d'ornement, que
je considérerai bientôt dans les monuments dont je reproduirai l'ensemble. J'examinerai
alors les censures des modernes à ce sujet, et je tâcherai de prouver qu'ils ont eu pres-
que toujours leur source dans l'ignorance où l'on a été sur la nature même de ces monu-
ments , sur le genre de leur exécution, et sur le goût des procédés dont elle dépendait.
Pour l'instant je ne prétends toucher que ce qui se rapporte dans cet usage, au génie
même de la toreutique, considérée comme art d'ornement et de bas-relief en petit.
Or il est constant que ce goût de détails et de petits objets est inhérent à la division
de l'art dont il s'agit. Il y a en effet une manière de voir, de sentir, de composer et de
(!) Lib. XXXV, cap. 5.
PARAGRAPHE VIII.
De la toreutique dans son rapport avec les petits objets d'ornement et la vaisselle d'argent,
ou la cœlatura argenti dans Pline, lib. XXXIII, cap. 12.
Tant que la notion générale de la toreutique n'était point déterminée, il devait être,
je l'avoue, fort difficile de sortir de ce cercle d'idées sans issue, autour desquelles
l'analyse partielle et l'érudition des textes forçaient de tourner. Il ne faut pas s'étonner
que tant de critiques habiles aient adopté pour conclusion que la toreutique était l'orfè-
vrerie, et n'était que cela. Le chapitre de Pline sur la cœlatura, mot correspondant en
latin au mot grec toreutice, avait dû fort naturellement conduire à cette conséquence.
Cependant une légère attention sur le texte de Pline, et sur la nature des notions ren-
fermées dans le chapitre dont je parle, fait assez connaître que cet écrivain, loin d'avoir
eu l'intention d'y renfermer la cœlatura toute entière, l'y a restreinte, et au seul emploi
de vaisselle, et à celui encore de vaisselle en argent, cœlatura argenti.
Rien autre chose à conclure de là par conséquent, sinon que l'art des ornements et
des figures sur argent, avait fait de très-bonne heure, comme on la déjà vu, une partie
remarquable de la sculpture sur métaux, et que cette partie avait continué d'être en vogue
à Piome, au temps de Pline.
Considérée sous le rapport de l'application de l'ornement en figures de bas-relief, et
autres petits sujets, à une multitude d'objets de luxe et d'usage, la toreutique sans aucun
doute avait jeté le plus grand éclat au temps de Phidias. Pline a encore eu soin de vanter
l'habileté de cet artiste en ce genre, et de le mettre à la tête de ceux qui excellèrent dans
le petit. C'est ce qu'il faut entendre par ce passage où il cite uniquement les plus légers
détails de ses plus grands ouvrages, et ce qu'il appelle argumenta parva (0 : j'en dis autant
des mots qui suivent, et dont le véritable sens me paraît être, que Phidias fut aussi grand
dans les plus petits objets dont il embellit ses colosses, que dans ses colosses eux-mêmes,
œqualem magnificentiam fuisse et in parvis.
Je veux dire ici d'avance un mot de ce goût pour les petits détails d'ornement, que
je considérerai bientôt dans les monuments dont je reproduirai l'ensemble. J'examinerai
alors les censures des modernes à ce sujet, et je tâcherai de prouver qu'ils ont eu pres-
que toujours leur source dans l'ignorance où l'on a été sur la nature même de ces monu-
ments , sur le genre de leur exécution, et sur le goût des procédés dont elle dépendait.
Pour l'instant je ne prétends toucher que ce qui se rapporte dans cet usage, au génie
même de la toreutique, considérée comme art d'ornement et de bas-relief en petit.
Or il est constant que ce goût de détails et de petits objets est inhérent à la division
de l'art dont il s'agit. Il y a en effet une manière de voir, de sentir, de composer et de
(!) Lib. XXXV, cap. 5.