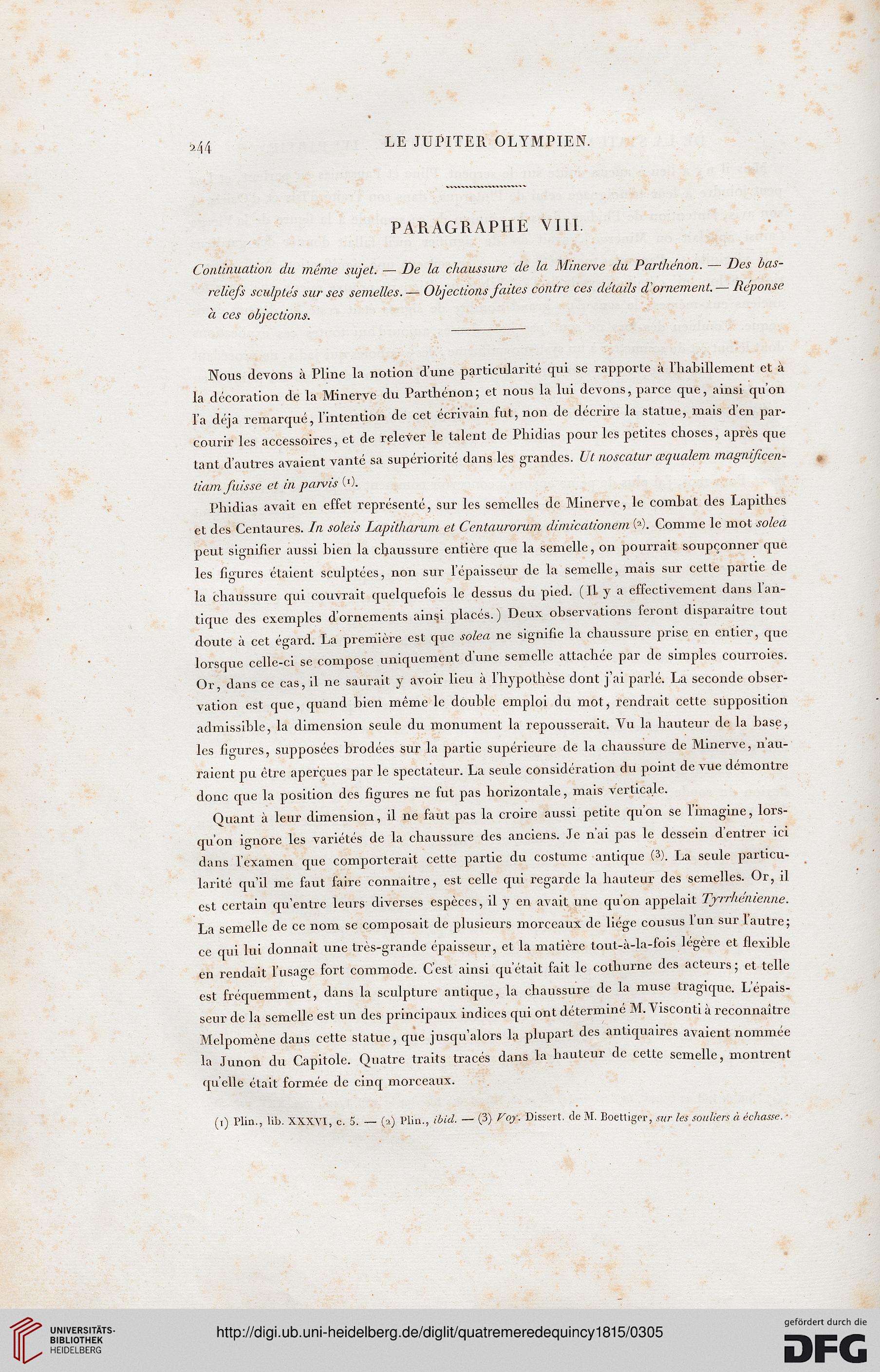M4
LE JUPITER OLYMPIEN.
PARAGRAPHE VIII.
Continuation du même sujet. — De la chaussure de la Minerve du Parthénon. — Des bas-
reliefs sculptés sur ses semelles. — Objections faites contre ces détails d'ornement. — Réponse
a ces objections.
Nous devons à Pline la notion d'une particularité qui se rapporte à l'habillement et à
la décoration de la Minerve du Parthénon; et nous la lui devons, parce que, ainsi qu'on
l'a déjà remarqué, l'intention de cet écrivain fut, non de décrire la statue, mais d'en par-
courir les accessoires, et de relever le talent de Phidias pour les petites choses, après que
tant d'autres avaient vanté sa supériorité dans les grandes. Ut noscatur œqualem magnificen-
tiam fuisse et in parvis (0.
Phidias avait en effet représenté, sur les semelles de Minerve, le combat des Lapithes
et des Centaures. In soleis Lapitharum et Centaurorum dimicationem (2). Comme le mot solea
peut signifier aussi bien la chaussure entière que la semelle, on pourrait soupçonner que
les figures étaient sculptées, non sur l'épaisseur de la semelle, mais sur cette partie de
la chaussure qui couvrait quelquefois le dessus du pied. (Il y a effectivement dans l'an-
tique des exemples d'ornements ainsi placés. ) Deux observations feront disparaître tout
doute à cet égard. La première est que solea ne signifie la chaussure prise en entier, que
lorsque celle-ci se compose uniquement d'une semelle attachée par de simples courroies.
Or, dans ce cas, il ne saurait y avoir lieu à l'hypothèse dont j'ai parlé. La seconde obser-
vation est que, quand bien même le double emploi du mot, rendrait cette supposition
admissible, la dimension seule du monument la repousserait. Vu la hauteur de la base,
les figures, supposées brodées sur la partie supérieure de la chaussure de Minerve, n'au-
raient pu être aperçues par le spectateur. La seule considération du point de vue démontre
donc que la position des figures ne fut pas horizontale, mais verticale.
Quant à leur dimension, il ne faut pas la croire aussi petite qu'on se l'imagine, lors-
qu'on ignore les variétés de la chaussure des anciens. Je n'ai pas le dessein d'entrer ici
dans l'examen que comporterait cette partie du costume antique (3). La seule particu-
larité qu'il me faut faire connaître, est celle qui regarde la hauteur des semelles. Or, il
est certain qu'entre leurs diverses espèces, il y en avait une qu'on ajjpelait Tyrrhénienne.
La semelle de ce nom se composait de plusieurs morceaux de liège cousus l'un sur l'autre;
ce qui lui donnait une très-grande épaisseur, et la matière tout-à-la-fois légère et flexible
en rendait l'usage fort commode. C'est ainsi qu'était fait le cothurne des acteurs ; et telle
est fréquemment, dans la sculpture antique, la chaussure de la muse tragique. L'épais-
seur de la semelle est un des principaux indices qui ont déterminé M.^isconti à reconnaître
Melpomène dans cette statue, que jusqu'alors la plupart des antiquaires avaient nommée
la Junon du Capitole. Quatre traits tracés dans la hauteur de cette semelle, montrent
qu'elle était formée de cinq morceaux.
(i) Plin., lib. XXXVI, c. 5. — (a) Plïfl., ibid. — (3) Foy. Dissert, de M. Boettiger, sur les souliers à échasse.
LE JUPITER OLYMPIEN.
PARAGRAPHE VIII.
Continuation du même sujet. — De la chaussure de la Minerve du Parthénon. — Des bas-
reliefs sculptés sur ses semelles. — Objections faites contre ces détails d'ornement. — Réponse
a ces objections.
Nous devons à Pline la notion d'une particularité qui se rapporte à l'habillement et à
la décoration de la Minerve du Parthénon; et nous la lui devons, parce que, ainsi qu'on
l'a déjà remarqué, l'intention de cet écrivain fut, non de décrire la statue, mais d'en par-
courir les accessoires, et de relever le talent de Phidias pour les petites choses, après que
tant d'autres avaient vanté sa supériorité dans les grandes. Ut noscatur œqualem magnificen-
tiam fuisse et in parvis (0.
Phidias avait en effet représenté, sur les semelles de Minerve, le combat des Lapithes
et des Centaures. In soleis Lapitharum et Centaurorum dimicationem (2). Comme le mot solea
peut signifier aussi bien la chaussure entière que la semelle, on pourrait soupçonner que
les figures étaient sculptées, non sur l'épaisseur de la semelle, mais sur cette partie de
la chaussure qui couvrait quelquefois le dessus du pied. (Il y a effectivement dans l'an-
tique des exemples d'ornements ainsi placés. ) Deux observations feront disparaître tout
doute à cet égard. La première est que solea ne signifie la chaussure prise en entier, que
lorsque celle-ci se compose uniquement d'une semelle attachée par de simples courroies.
Or, dans ce cas, il ne saurait y avoir lieu à l'hypothèse dont j'ai parlé. La seconde obser-
vation est que, quand bien même le double emploi du mot, rendrait cette supposition
admissible, la dimension seule du monument la repousserait. Vu la hauteur de la base,
les figures, supposées brodées sur la partie supérieure de la chaussure de Minerve, n'au-
raient pu être aperçues par le spectateur. La seule considération du point de vue démontre
donc que la position des figures ne fut pas horizontale, mais verticale.
Quant à leur dimension, il ne faut pas la croire aussi petite qu'on se l'imagine, lors-
qu'on ignore les variétés de la chaussure des anciens. Je n'ai pas le dessein d'entrer ici
dans l'examen que comporterait cette partie du costume antique (3). La seule particu-
larité qu'il me faut faire connaître, est celle qui regarde la hauteur des semelles. Or, il
est certain qu'entre leurs diverses espèces, il y en avait une qu'on ajjpelait Tyrrhénienne.
La semelle de ce nom se composait de plusieurs morceaux de liège cousus l'un sur l'autre;
ce qui lui donnait une très-grande épaisseur, et la matière tout-à-la-fois légère et flexible
en rendait l'usage fort commode. C'est ainsi qu'était fait le cothurne des acteurs ; et telle
est fréquemment, dans la sculpture antique, la chaussure de la muse tragique. L'épais-
seur de la semelle est un des principaux indices qui ont déterminé M.^isconti à reconnaître
Melpomène dans cette statue, que jusqu'alors la plupart des antiquaires avaient nommée
la Junon du Capitole. Quatre traits tracés dans la hauteur de cette semelle, montrent
qu'elle était formée de cinq morceaux.
(i) Plin., lib. XXXVI, c. 5. — (a) Plïfl., ibid. — (3) Foy. Dissert, de M. Boettiger, sur les souliers à échasse.