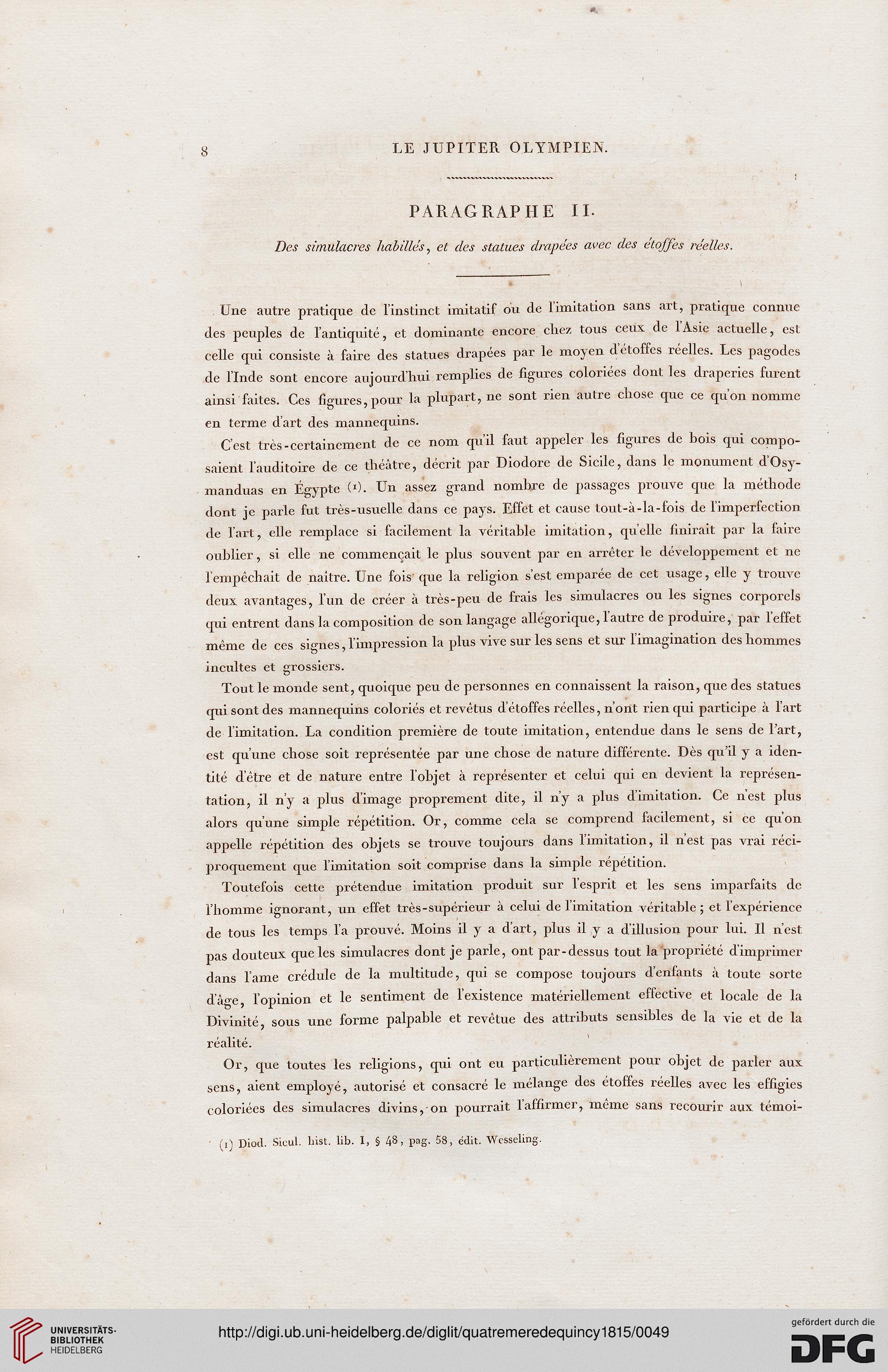8
LE JUPITER OLYMPIEN.
PARAGRAPHE IL
Des simulacres habillés, et des statues drapées avec des étoffes réelles.
Une autre pratique de l'instinct imitatif ou de l'imitation sans art, pratique connue
des peuples de l'antiquité, et dominante encore chez tous ceux de l'Asie actuelle, est
celle qui consiste à faire des statues drapées par le moyen d'étoffes réelles. Les pagodes
de l'Inde sont encore aujourd'hui remplies de figures coloriées dont les draperies furent
ainsi faites. Ces figures, pour la plupart, ne sont rien autre chose que ce qu'on nomme
en terme d'art des mannequins.
C'est très-certainement de ce nom qu'il faut appeler les figures de bois qui compo-
saient l'auditoire de ce théâtre, décrit par Diodore de Sicile, clans le monument d'Osy-
manduas en Egypte (*). Un assez grand nomhre de passages prouve que la méthode
dont je parle fut très-usuelle dans ce pays. Effet et cause tout-à-la-fois de l'imperfection
de l'art, elle remplace si facilement la véritable imitation, qu'elle finirait par la faire
oublier, si elle ne commençait le plus souvent par en arrêter le développement et ne
l'empêchait de naître. Une fois que la religion s'est emparée de cet usage, elle y trouve
deux avantages, l'un de créer à très-peu de frais les simulacres ou les signes corporels
qui entrent dans la composition de son langage allégorique, l'autre de produire, par l'effet
même de ces signes, l'impression la plus vive sur les sens et sur l'imagination des hommes
incultes et grossiers.
Tout le monde sent, quoique peu de personnes en connaissent la raison, que des statues
qui sont des mannequins coloriés et revêtus d'étoffes réelles, n'ont rien qui participe à l'art
de l'imitation. La condition première de toute imitation, entendue dans le sens de l'art,
est qu'une chose soit représentée par une chose de nature différente. Dès qu'il y a iden-
tité d'être et de nature entre l'objet à représenter et celui qui en devient la représen-
tation, il n'y a plus d'image proprement dite, il n'y a plus d'imitation. Ce n'est plus
alors qu'une simple répétition. Or, comme cela se comprend facilement, si ce qu'on
appelle répétition des objets se trouve toujours dans l'imitation, il n'est pas vrai réci-
proquement que l'imitation soit comprise dans la simple répétition.
Toutefois cette prétendue imitation produit sur l'esprit et les sens imparfaits de
l'homme ignorant, un effet très-supérieur à celui de l'imitation véritable; et l'expérience
de tous les temps l'a prouvé. Moins il y a d'art, plus il y a d'illusion pour lui. Il n'est
pas douteux que les simulacres dont je parle, ont par-dessus tout la propriété d'imprimer
dans l'ame crédule de la multitude, qui se compose toujours d'enfants à toute sorte
d'âge, l'opinion et le sentiment de l'existence matériellement effective et locale de la
Divinité, sous une forme palpable et revêtue des attributs sensibles de la vie et de la
réalité.
Or, que toutes les religions, qui ont eu particulièrement pour objet de parler aux
sens, aient employé, autorisé et consacré le mélange des étoffes réelles avec les effigies
coloriées des simulacres divins, on pourrait l'affirmer, même sans recourir aux témoi-
(i) Diocl. Sicul. liist. lib. I, § 48, pag. 58, édit. Wcsseling.
LE JUPITER OLYMPIEN.
PARAGRAPHE IL
Des simulacres habillés, et des statues drapées avec des étoffes réelles.
Une autre pratique de l'instinct imitatif ou de l'imitation sans art, pratique connue
des peuples de l'antiquité, et dominante encore chez tous ceux de l'Asie actuelle, est
celle qui consiste à faire des statues drapées par le moyen d'étoffes réelles. Les pagodes
de l'Inde sont encore aujourd'hui remplies de figures coloriées dont les draperies furent
ainsi faites. Ces figures, pour la plupart, ne sont rien autre chose que ce qu'on nomme
en terme d'art des mannequins.
C'est très-certainement de ce nom qu'il faut appeler les figures de bois qui compo-
saient l'auditoire de ce théâtre, décrit par Diodore de Sicile, clans le monument d'Osy-
manduas en Egypte (*). Un assez grand nomhre de passages prouve que la méthode
dont je parle fut très-usuelle dans ce pays. Effet et cause tout-à-la-fois de l'imperfection
de l'art, elle remplace si facilement la véritable imitation, qu'elle finirait par la faire
oublier, si elle ne commençait le plus souvent par en arrêter le développement et ne
l'empêchait de naître. Une fois que la religion s'est emparée de cet usage, elle y trouve
deux avantages, l'un de créer à très-peu de frais les simulacres ou les signes corporels
qui entrent dans la composition de son langage allégorique, l'autre de produire, par l'effet
même de ces signes, l'impression la plus vive sur les sens et sur l'imagination des hommes
incultes et grossiers.
Tout le monde sent, quoique peu de personnes en connaissent la raison, que des statues
qui sont des mannequins coloriés et revêtus d'étoffes réelles, n'ont rien qui participe à l'art
de l'imitation. La condition première de toute imitation, entendue dans le sens de l'art,
est qu'une chose soit représentée par une chose de nature différente. Dès qu'il y a iden-
tité d'être et de nature entre l'objet à représenter et celui qui en devient la représen-
tation, il n'y a plus d'image proprement dite, il n'y a plus d'imitation. Ce n'est plus
alors qu'une simple répétition. Or, comme cela se comprend facilement, si ce qu'on
appelle répétition des objets se trouve toujours dans l'imitation, il n'est pas vrai réci-
proquement que l'imitation soit comprise dans la simple répétition.
Toutefois cette prétendue imitation produit sur l'esprit et les sens imparfaits de
l'homme ignorant, un effet très-supérieur à celui de l'imitation véritable; et l'expérience
de tous les temps l'a prouvé. Moins il y a d'art, plus il y a d'illusion pour lui. Il n'est
pas douteux que les simulacres dont je parle, ont par-dessus tout la propriété d'imprimer
dans l'ame crédule de la multitude, qui se compose toujours d'enfants à toute sorte
d'âge, l'opinion et le sentiment de l'existence matériellement effective et locale de la
Divinité, sous une forme palpable et revêtue des attributs sensibles de la vie et de la
réalité.
Or, que toutes les religions, qui ont eu particulièrement pour objet de parler aux
sens, aient employé, autorisé et consacré le mélange des étoffes réelles avec les effigies
coloriées des simulacres divins, on pourrait l'affirmer, même sans recourir aux témoi-
(i) Diocl. Sicul. liist. lib. I, § 48, pag. 58, édit. Wcsseling.