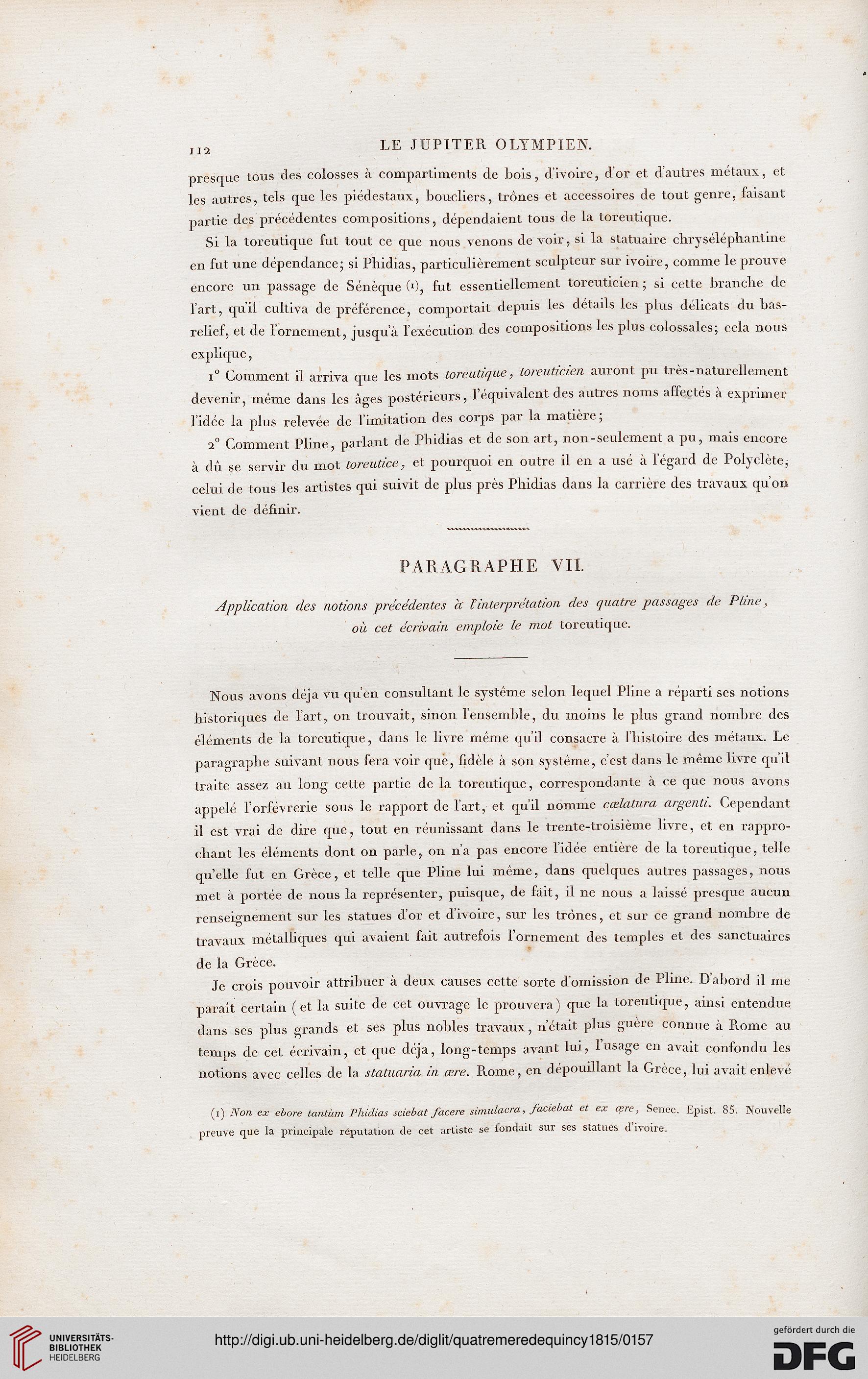lia LE JUPITER OLYMPIEN.
presque tous des colosses à compartiments de bois, d'ivoire, d'or et d'autres métaux, et
les autres, tels que les piédestaux, boucliers, trônes et accessoires de tout genre, faisant
partie des précédentes compositions, dépendaient tous de la toreutique.
Si la toreutique fut tout ce que nous venons de voir, si la statuaire chryséléphantine
en fut une dépendance; si Phidias, particulièrement sculpteur sur ivoire, comme le prouve
encore un passage de Sénèque (0, fut essentiellement toreuticien; si cette branche de
l'art, qu'il cultiva de préférence, comportait depuis les détails les plus délicats du bas-
relief, et de l'ornement, jusqu'à l'exécution des compositions les plus colossales; cela nous
explique,
i° Comment il arriva que les mots toreutique, toreuticien auront pu très-naturellement
devenir, même dans les âges postérieurs, l'équivalent des autres noms affectés à exprimer
l'idée la plus relevée de l'imitation des corps par la matière ;
2° Comment Pline, parlant de Phidias et de son art, non-seulement a pu, mais encore
à dû se servir du mot toreutice, et pourquoi en outre il en a usé à l'égard de Polyclète^
celui de tous les artistes qui suivit de plus près Phidias dans la carrière des travaux qu'on
vient de définir.
PARAGRAPHE VIL
Application des notions précédentes a Tinterprétation des quatre passages de Pline,
où cet écrivain emploie le mot toreutique.
Nous avons déjà vu qu'en consultant le système selon lequel Pline a réparti ses notions
historiques de l'art, on trouvait, sinon l'ensemble, du moins le plus grand nombre des
éléments de la toreutique, dans le livre même qu'il consacre à J'histoire des métaux. Le
paragraphe suivant nous fera voir que, fidèle à son système, c'est dans le même livre qu'il
traite assez au long cette partie de la toreutique, correspondante à ce que nous avons
appelé l'orfèvrerie sous le rapport de l'art, et qu'il nomme cœlatura argenti. Cependant
il est vrai de dire que, tout en réunissant dans le trente-troisième livre, et en rappro-
chant les éléments dont on parle, on n'a pas encore l'idée entière de la toreutique, telle
quelle fut en Grèce, et telle que Pline lui même, dans quelques autres passages, nous
met à portée de nous la représenter, puisque, de fait, il ne nous a laissé presque aucun
renseignement sur les statues d'or et d'ivoire, sur les trônes, et sur ce grand nombre de
travaux métalliques qui avaient fait autrefois l'ornement des temples et des sanctuaires
9 ■
de la Grèce.
Je crois pouvoir attribuer à deux causes cette sorte d'omission de Pline. D'abord il me
paraît certain ( et la suite de cet ouvrage le prouvera ) que la toreutique, ainsi entendue
dans ses plus grands et ses plus nobles travaux, n'était plus guère connue à Rome au
temps de cet écrivain, et que déjà, long-temps avant lui, l'usage en avait confondu les
notions avec celles de la staluaria in œre. Rome, en dépouillant la Grèce, lui avait enlevé
(i) Non ex ebore tantùm Phidias sciebat facere simulacra, faciebat et ex œre, Senec. Epist. 85. Nouvelle
preuve que la principale réputation de cet artiste se fondait sur ses statues d'ivoire.
presque tous des colosses à compartiments de bois, d'ivoire, d'or et d'autres métaux, et
les autres, tels que les piédestaux, boucliers, trônes et accessoires de tout genre, faisant
partie des précédentes compositions, dépendaient tous de la toreutique.
Si la toreutique fut tout ce que nous venons de voir, si la statuaire chryséléphantine
en fut une dépendance; si Phidias, particulièrement sculpteur sur ivoire, comme le prouve
encore un passage de Sénèque (0, fut essentiellement toreuticien; si cette branche de
l'art, qu'il cultiva de préférence, comportait depuis les détails les plus délicats du bas-
relief, et de l'ornement, jusqu'à l'exécution des compositions les plus colossales; cela nous
explique,
i° Comment il arriva que les mots toreutique, toreuticien auront pu très-naturellement
devenir, même dans les âges postérieurs, l'équivalent des autres noms affectés à exprimer
l'idée la plus relevée de l'imitation des corps par la matière ;
2° Comment Pline, parlant de Phidias et de son art, non-seulement a pu, mais encore
à dû se servir du mot toreutice, et pourquoi en outre il en a usé à l'égard de Polyclète^
celui de tous les artistes qui suivit de plus près Phidias dans la carrière des travaux qu'on
vient de définir.
PARAGRAPHE VIL
Application des notions précédentes a Tinterprétation des quatre passages de Pline,
où cet écrivain emploie le mot toreutique.
Nous avons déjà vu qu'en consultant le système selon lequel Pline a réparti ses notions
historiques de l'art, on trouvait, sinon l'ensemble, du moins le plus grand nombre des
éléments de la toreutique, dans le livre même qu'il consacre à J'histoire des métaux. Le
paragraphe suivant nous fera voir que, fidèle à son système, c'est dans le même livre qu'il
traite assez au long cette partie de la toreutique, correspondante à ce que nous avons
appelé l'orfèvrerie sous le rapport de l'art, et qu'il nomme cœlatura argenti. Cependant
il est vrai de dire que, tout en réunissant dans le trente-troisième livre, et en rappro-
chant les éléments dont on parle, on n'a pas encore l'idée entière de la toreutique, telle
quelle fut en Grèce, et telle que Pline lui même, dans quelques autres passages, nous
met à portée de nous la représenter, puisque, de fait, il ne nous a laissé presque aucun
renseignement sur les statues d'or et d'ivoire, sur les trônes, et sur ce grand nombre de
travaux métalliques qui avaient fait autrefois l'ornement des temples et des sanctuaires
9 ■
de la Grèce.
Je crois pouvoir attribuer à deux causes cette sorte d'omission de Pline. D'abord il me
paraît certain ( et la suite de cet ouvrage le prouvera ) que la toreutique, ainsi entendue
dans ses plus grands et ses plus nobles travaux, n'était plus guère connue à Rome au
temps de cet écrivain, et que déjà, long-temps avant lui, l'usage en avait confondu les
notions avec celles de la staluaria in œre. Rome, en dépouillant la Grèce, lui avait enlevé
(i) Non ex ebore tantùm Phidias sciebat facere simulacra, faciebat et ex œre, Senec. Epist. 85. Nouvelle
preuve que la principale réputation de cet artiste se fondait sur ses statues d'ivoire.