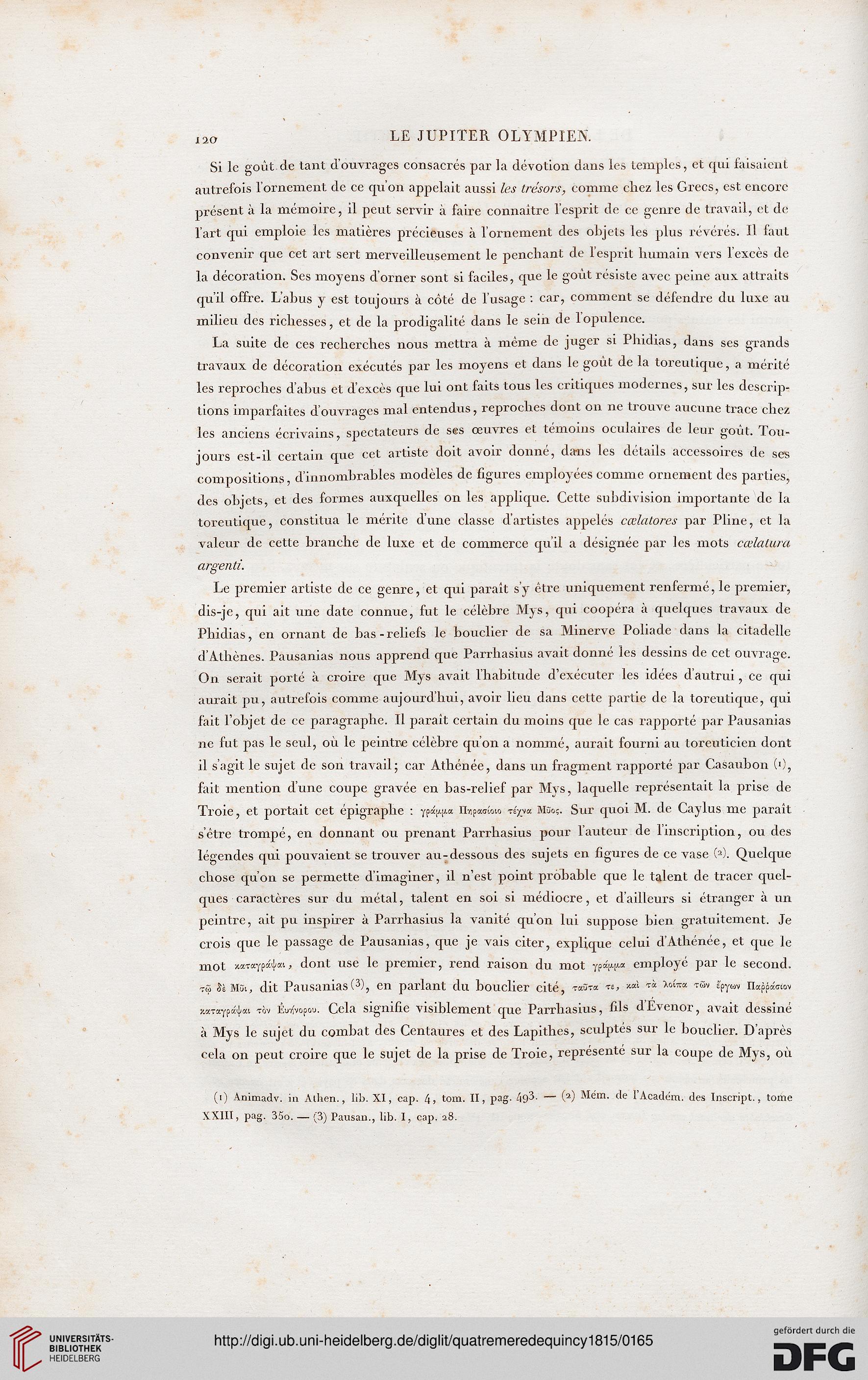iao LE JUPITER OLYMPIEN.
Si le goût de tant d'ouvrages consacrés par la dévotion dans les temples, et qui faisaient
autrefois l'ornement de ce qu'on appelait aussi les trésors, comme chez les Grecs, est encore
présent à la mémoire, il peut servir à faire connaitre l'esprit de ce genre de travail, et de
l'art qui emploie les matières précieuses à l'ornement des objets les plus révérés. Il faut
convenir que cet art sert merveilleusement le penchant de l'esprit humain vers l'excès de
la décoration. Ses moyens d'orner sont si faciles, que le goût résiste avec peine aux attraits
qu'il offre. L'abus y est toujours à côté de l'usage : car, comment se défendre du luxe au
milieu des richesses, et de la prodigalité dans le sein de l'opulence.
La suite de ces recherches nous mettra à même de juger si Phidias, dans ses grands
travaux de décoration exécutés par les moyens et dans le goût de la toreutique, a mérité
les reproches d'abus et d'excès que lui ont faits tous les critiques modernes, sur les descrip-
tions imparfaites d'ouvrages mal entendus, reproches dont on ne trouve aucune trace chez
les anciens écrivains, spectateurs de ses œuvres et témoins oculaires de leur goût. Tou-
jours est-il certain que cet artiste doit avoir donné, dans les détails accessoires de ses
compositions, d'innombrables modèles de figures employées comme ornement des parties,
des objets, et des formes auxquelles on les applique. Cette subdivision importante de la
toreutique, constitua le mérite d'une classe d'artistes appelés cœlatores par Pline, et la
valeur de cette branche de luxe et de commerce qu'il a désignée par les mots cœlalura
argenti.
Le premier artiste de ce genre, et qui paraît s'y être uniquement renfermé, le premier,
dis-je, qui ait une date connue, fut le célèbre Mys, qui coopéra à quelques travaux de
Phidias, en ornant de bas-reliefs le bouclier de sa Minerve Poliade dans la citadelle
d'Athènes. Pausanias nous apprend que Parrhasius avait donné les dessins de cet ouvrage.
On serait porté à croire que Mys avait l'habitude d'exécuter les idées dautrui, ce qui
aurait pu, autrefois comme aujourd'hui, avoir lieu dans cette partie de la toreutique, qui
fait l'objet de ce paragraphe. Il paraît certain du moins que le cas rapporté par Pausanias
ne fut pas le seul, où le peintre célèbre qu'on a nommé, aurait fourni au toreuticien dont
il s'agit le sujet de son travail; car Athénée, dans un fragment rapporté par Casaubon (0,
fait mention d'une coupe gravée en bas-relief par Mys, laquelle représentait la prise de
Troie, et portait cet épigraphe : ypa^a îT/ipadww zéyya- Msoç. Sur quoi M. de Caylus me paraît
s'être trompé, en donnant ou prenant Parrhasius pour l'auteur de l'inscription, ou des
légendes qui pouvaient se trouver au-dessous des sujets en figures de ce vase (2). Quelque
chose qu'on se permette d'imaginer, il n'est point probable que le talent de tracer quel-
ques caractères sur du métal, talent en soi si médiocre, et d'ailleurs si étranger à un
peintre, ait pu inspirer à Parrhasius la vanité qu'on lui suppose bien gratuitement. Je
crois que le passage de Pausanias, que je vais citer, explique celui d'Athénée, et que le
mot xaTaypa<{/ai, dont use le premier, rend raison du mot ypwa employé par le second.
t<î> SèMùi, dit Pausanias (3), en parlant du bouclier cité, ™ùt* n, »<« *« ^™ *&v â'pywv nappactov
Cela signifie visiblement que Parrhasius, fils d'Evenor, avait dessiné
à Mys le sujet du combat des Centaures et des Lapithes, sculptés sur le bouclier. D'après
cela on peut croire que le sujet de la prise de Troie, représenté sur la coupe de Mys, où
(i) Animadv. in Athen., lib. XI, cap. 4, tom. II, pag. 493- — (a) Mém. de l'Académ. des Inscript., tome
XXIII, pag. 35o. — (3) Pausan., lib. I, cap. 28.
Si le goût de tant d'ouvrages consacrés par la dévotion dans les temples, et qui faisaient
autrefois l'ornement de ce qu'on appelait aussi les trésors, comme chez les Grecs, est encore
présent à la mémoire, il peut servir à faire connaitre l'esprit de ce genre de travail, et de
l'art qui emploie les matières précieuses à l'ornement des objets les plus révérés. Il faut
convenir que cet art sert merveilleusement le penchant de l'esprit humain vers l'excès de
la décoration. Ses moyens d'orner sont si faciles, que le goût résiste avec peine aux attraits
qu'il offre. L'abus y est toujours à côté de l'usage : car, comment se défendre du luxe au
milieu des richesses, et de la prodigalité dans le sein de l'opulence.
La suite de ces recherches nous mettra à même de juger si Phidias, dans ses grands
travaux de décoration exécutés par les moyens et dans le goût de la toreutique, a mérité
les reproches d'abus et d'excès que lui ont faits tous les critiques modernes, sur les descrip-
tions imparfaites d'ouvrages mal entendus, reproches dont on ne trouve aucune trace chez
les anciens écrivains, spectateurs de ses œuvres et témoins oculaires de leur goût. Tou-
jours est-il certain que cet artiste doit avoir donné, dans les détails accessoires de ses
compositions, d'innombrables modèles de figures employées comme ornement des parties,
des objets, et des formes auxquelles on les applique. Cette subdivision importante de la
toreutique, constitua le mérite d'une classe d'artistes appelés cœlatores par Pline, et la
valeur de cette branche de luxe et de commerce qu'il a désignée par les mots cœlalura
argenti.
Le premier artiste de ce genre, et qui paraît s'y être uniquement renfermé, le premier,
dis-je, qui ait une date connue, fut le célèbre Mys, qui coopéra à quelques travaux de
Phidias, en ornant de bas-reliefs le bouclier de sa Minerve Poliade dans la citadelle
d'Athènes. Pausanias nous apprend que Parrhasius avait donné les dessins de cet ouvrage.
On serait porté à croire que Mys avait l'habitude d'exécuter les idées dautrui, ce qui
aurait pu, autrefois comme aujourd'hui, avoir lieu dans cette partie de la toreutique, qui
fait l'objet de ce paragraphe. Il paraît certain du moins que le cas rapporté par Pausanias
ne fut pas le seul, où le peintre célèbre qu'on a nommé, aurait fourni au toreuticien dont
il s'agit le sujet de son travail; car Athénée, dans un fragment rapporté par Casaubon (0,
fait mention d'une coupe gravée en bas-relief par Mys, laquelle représentait la prise de
Troie, et portait cet épigraphe : ypa^a îT/ipadww zéyya- Msoç. Sur quoi M. de Caylus me paraît
s'être trompé, en donnant ou prenant Parrhasius pour l'auteur de l'inscription, ou des
légendes qui pouvaient se trouver au-dessous des sujets en figures de ce vase (2). Quelque
chose qu'on se permette d'imaginer, il n'est point probable que le talent de tracer quel-
ques caractères sur du métal, talent en soi si médiocre, et d'ailleurs si étranger à un
peintre, ait pu inspirer à Parrhasius la vanité qu'on lui suppose bien gratuitement. Je
crois que le passage de Pausanias, que je vais citer, explique celui d'Athénée, et que le
mot xaTaypa<{/ai, dont use le premier, rend raison du mot ypwa employé par le second.
t<î> SèMùi, dit Pausanias (3), en parlant du bouclier cité, ™ùt* n, »<« *« ^™ *&v â'pywv nappactov
Cela signifie visiblement que Parrhasius, fils d'Evenor, avait dessiné
à Mys le sujet du combat des Centaures et des Lapithes, sculptés sur le bouclier. D'après
cela on peut croire que le sujet de la prise de Troie, représenté sur la coupe de Mys, où
(i) Animadv. in Athen., lib. XI, cap. 4, tom. II, pag. 493- — (a) Mém. de l'Académ. des Inscript., tome
XXIII, pag. 35o. — (3) Pausan., lib. I, cap. 28.