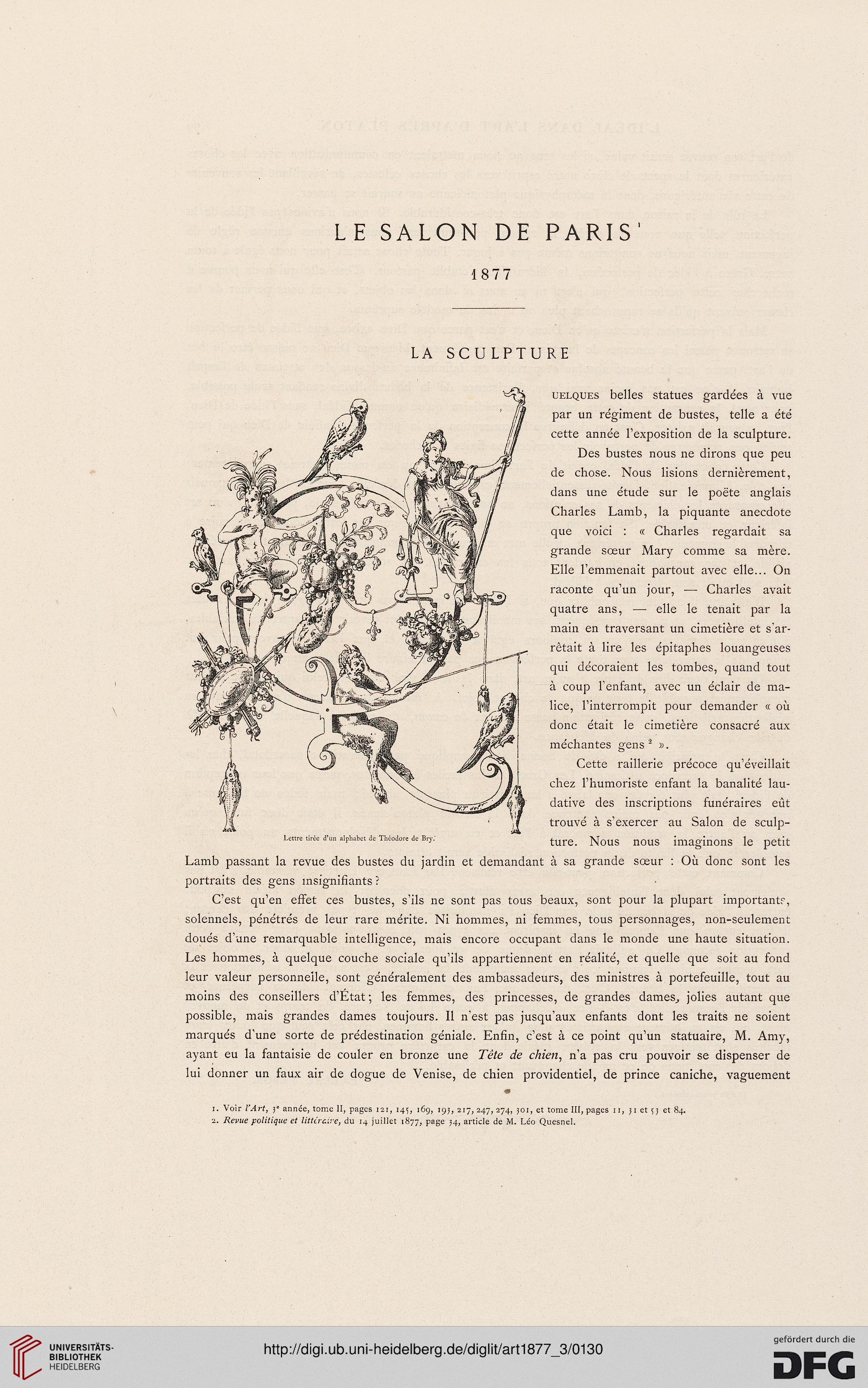LE SALON DE PARIS'
1877
LA SCULPTURE
uelques belles statues gardées à vue
par un régiment de bustes, telle a été
cette année l'exposition de la sculpture.
Des bustes nous ne dirons que peu
de chose. Nous lisions dernièrement,
dans une étude sur le poète anglais
Charles Lamb, la piquante anecdote
que voici : « Charles regardait sa
grande sœur Mary comme sa mère.
Elle l'emmenait partout avec elle... On
raconte qu'un jour, — Charles avait
quatre ans, — elle le tenait par la
main en traversant un cimetière et s'ar-
rêtait à lire les épitaphes louangeuses
qui décoraient les tombes, quand tout
à coup l'enfant, avec un éclair de ma-
lice, l'interrompit pour demander « où
donc était le cimetière consacré aux
méchantes gens 2 ».
Cette raillerie précoce qu'éveillait
chez l'humoriste enfant la banalité lau-
dative des inscriptions funéraires eût
trouvé à s'exercer au Salon de sculp-
ture. Nous nous imaginons le petit
Lamb passant la revue des bustes du jardin et demandant à sa grande soeur : Où donc sont les
portraits des gens insignifiants ?
C'est qu'en effet ces bustes, s'ils ne sont pas tous beaux, sont pour la plupart importantr,
solennels, pénétrés de leur rare mérite. Ni hommes, ni femmes, tous personnages, non-seulement
doués d'une remarquable intelligence, mais encore occupant dans le monde une haute situation.
Les hommes, à quelque couche sociale qu'ils appartiennent en réalité, et quelle que soit au fond
leur valeur personnelle, sont généralement des ambassadeurs, des ministres à portefeuille, tout au
moins des conseillers d'Etat ; les femmes, des princesses, de grandes dames, jolies autant que
possible, mais grandes dames toujours. Il n'est pas jusqu'aux enfants dont les traits ne soient
marqués d'une sorte de prédestination géniale. Enfin, c'est à ce point qu'un statuaire, M. Amy,
ayant eu la fantaisie de couler en bronze une Tête de chien, n'a pas cru pouvoir se dispenser de
lui donner un faux air de dogue de Venise, de chien providentiel, de prince caniche, vaguement
1. Voir l'Art, y année, tome II, pages 121, 145, 169, 195, 217, 247, 274, joi, et tome III, pages il, ; 1 et 5) et 84.
2. Revue politique et littirc.re, du 14 juillet 1877, page 54, article de M. Léo Quesnel.
\
Lettre tirée d'un alphabet de Théodore de Bry.'
1877
LA SCULPTURE
uelques belles statues gardées à vue
par un régiment de bustes, telle a été
cette année l'exposition de la sculpture.
Des bustes nous ne dirons que peu
de chose. Nous lisions dernièrement,
dans une étude sur le poète anglais
Charles Lamb, la piquante anecdote
que voici : « Charles regardait sa
grande sœur Mary comme sa mère.
Elle l'emmenait partout avec elle... On
raconte qu'un jour, — Charles avait
quatre ans, — elle le tenait par la
main en traversant un cimetière et s'ar-
rêtait à lire les épitaphes louangeuses
qui décoraient les tombes, quand tout
à coup l'enfant, avec un éclair de ma-
lice, l'interrompit pour demander « où
donc était le cimetière consacré aux
méchantes gens 2 ».
Cette raillerie précoce qu'éveillait
chez l'humoriste enfant la banalité lau-
dative des inscriptions funéraires eût
trouvé à s'exercer au Salon de sculp-
ture. Nous nous imaginons le petit
Lamb passant la revue des bustes du jardin et demandant à sa grande soeur : Où donc sont les
portraits des gens insignifiants ?
C'est qu'en effet ces bustes, s'ils ne sont pas tous beaux, sont pour la plupart importantr,
solennels, pénétrés de leur rare mérite. Ni hommes, ni femmes, tous personnages, non-seulement
doués d'une remarquable intelligence, mais encore occupant dans le monde une haute situation.
Les hommes, à quelque couche sociale qu'ils appartiennent en réalité, et quelle que soit au fond
leur valeur personnelle, sont généralement des ambassadeurs, des ministres à portefeuille, tout au
moins des conseillers d'Etat ; les femmes, des princesses, de grandes dames, jolies autant que
possible, mais grandes dames toujours. Il n'est pas jusqu'aux enfants dont les traits ne soient
marqués d'une sorte de prédestination géniale. Enfin, c'est à ce point qu'un statuaire, M. Amy,
ayant eu la fantaisie de couler en bronze une Tête de chien, n'a pas cru pouvoir se dispenser de
lui donner un faux air de dogue de Venise, de chien providentiel, de prince caniche, vaguement
1. Voir l'Art, y année, tome II, pages 121, 145, 169, 195, 217, 247, 274, joi, et tome III, pages il, ; 1 et 5) et 84.
2. Revue politique et littirc.re, du 14 juillet 1877, page 54, article de M. Léo Quesnel.
\
Lettre tirée d'un alphabet de Théodore de Bry.'